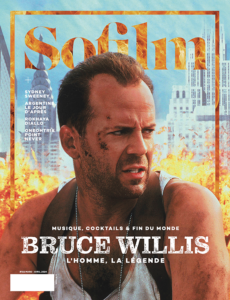En digne annonciateur de Fargo et No Country for old men, le premier long métrage des frères Coen déglamourise littéralement le film noir, le décapant à la sauce gore et grotesque. Son retour en salles en version restaurée est l'une des belles nouvelles de l'été.
Tout en s’inspirant du Facteur sonne toujours deux fois de James MacCain, les deux frérots biberonnés aux romans de Hammett transposent l’univers des femmes fatales et des détectives privés en plein Texas, dans le monde brutal des rednecks. Abby (Frances MacDormond, qui fait alors la connaissance de son futur époux Joel Coen) trompe son mari Julian, qui tient un bar miteux, avec Ray, un employé. Le patron décide alors d’éliminer les amants en employant un détective privé véreux, Loren Visser (Emmet Walsh). Ici donc, pas de vampe, mais une jeune épouse inoffensive et, dans le rôle du privé élégant, un gros type clownesque, transpirant dans son costume jaune canari et roulant en Coccinelle. À la place du désir et de la séduction, Blood simple (comme son titre l’indique) dévoile une frénésie meurtrière et contagieuse, s’insinuant dans le quotidien banal des personnages comme un serpent qui rampe. Personne n’en réchappe, au point que le climax horrifique du film, où quelqu’un se fait enterrer vivant (trace fugace de l’influence d’Evil Dead, que Joel Coen vient de monter pour son ami Sam Raimi), est l'oeuvre d'un personnage complètement innocent au départ.

Cette banalisation du Mal contamine carrément toute la mise en scène des frères Coen, qui choisissent alors de filmer la violence comme un détail trivial parmi d’autres. La caméra de Barry Sonnenfeld s’attarde en effet avec une frontalité placide, sans lyrisme ni musique, sur le sang noir qui dégoutte d’un macchabée tout frais, le lent enterrement d’un type vivant, ou sur une paire de doigts cloués. Dans l’un des plus beaux plans du film, un mur plongé dans la nuit est soudainement percé par les trouées lumineuses de tirs au revolver – comme si la violence existait détachée de son auteur, se produisant de manière complètement automatique.
Comme dans tout film noir, les personnages semblent donc impuissants face au destin qui les entraîne. Mais ici aussi le poids tragique du « fatum » perd de sa superbe et se réduit à l’ironie cruelle du hasard. Clin d’œil au polar hitchcockien, ce sont en effet les objets qui condamnent les personnages. Visser commence par incriminer Abby en déposant le revolver de celle-ci sur une scène de crime, mais un briquet oublié manque de perdre l’assassin. La caméra, irrésistiblement, s’attache elle aussi aux détails les plus kitschs et les plus sordides comme s’ils définissaient la destinée des personnages : une poupée aux seins qui clignotent pendue comme un pantin à un rétroviseur, un duo de poissons fraîchement pêchés, baignant dans une mare de sang. En fait, ce retour incessant au prosaïsme (et donc aux antipodes du glamour) prend ici un sens philosophique. Pour le héros coenien, il n’y aura pas de transcendance, pas de justice, pas de morale. Seulement le cours désespérément arbitraire des événements sur lesquels personne n’a au fond aucune prise, comme dans le surprenant final de No Country for old men. Dans le cinéma des frères Coen, l’existence est donc à l’image de cette route perdue dans l’obscurité qui ponctue plusieurs fois Blood Simple, ou comme ce chemin noyé dans le brouillard neigeux de Fargo – une vaste errance dans l’inconnu, effrayant écho de notre finitude. – Juliette Goffart