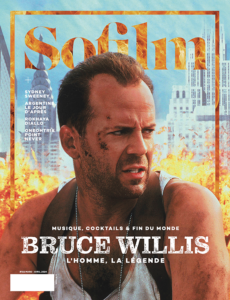Disco Boy : « J’aime quand on peut flotter »
Pour ce premier long ambitieux (en salles ce 3 mai), Giacomo Abbruzzese mêle le mystique au politique. Quelque part entre Beau Travail et Apocalypse Now, l’Italien suit le périple d’un jeune Biélorusse engagé dans la Légion étrangère et qui croise la route de Jomo, jeune révolutionnaire en lutte contre les compagnies pétrolières dans le delta du Niger. Un trip fantastique et hypnotique, dont il nous raconte les coulisses.
Disco Boy est une sorte de film de guerre avec un double point de vue. Pas un gentil et un méchant, mais deux personnages qui vont se rapprocher…
C’était le parti pris du film dès le début. Il y a 10 ans quand j’ai commencé à travailler sur le projet, il y avait cette idée de commencer avec le personnage d’Aleksei, et de l’accompagner jusqu’à son entrée à la légion. Puis de partir sur l’histoire de Jomo, et une fois qu’on rentre un peu dans la jungle avoir le croisement des deux histoires. J’ai dû beaucoup le défendre d’ailleurs. Avec les commissions, les financeurs privés, les changements de producteurs… Souvent on me « conseillait » de faire un montage parallèle, mais ça a été fait 1000 fois. Je préférais ce challenge, aller vers une forme de narration nouvelle.
Vous assumez de mêler le réalisme et l’onirisme dans un même flux visuel. Cela participe à cette expérimentation ?
Avec la monteuse, on savait que la dimension du rêve et l’onirisme avait une grande place dans le récit. Pour moi, il n’y a même pas de frontière. Le réel intègre le virtuel, l’invisible est déjà là et l’une des puissances du cinéma c’est d’essayer de filmer cet invisible. Donc j’aime bien quand il n’y a pas de distinctions claires. Je n’aime pas trop les films avec des flashbacks, ou des séquences de rêves hypers appuyées. J’aime quand on peut flotter, quand y a une porosité entre les états et les environnements.

Cette porosité se retrouve dans un casting étonnant, où les acteurs et actrices ne parlent pas les langues de leurs personnages. Comment vous avez mis ça en place ?
Je ne fais pas mon casting en regardant les passeports, que ce soit pour des questions de coproduction ou de vraisemblance. J’ai certes fait beaucoup de castings en Russie et en Biélorussie. J’avais des acteurs convaincants mais je sentais dans un coin de ma tête que Franz Rogowski était le meilleur choix pour le rôle d’Aleksei. Il y avait quelque chose dans sa parole et dans son corps d’un peu cassé. Je ne voulais pas être trop psychologisant, ni tout raconter de son passé, donc c’était essentiel d’avoir un acteur qui a cette épaisseur. À partir du moment où j’avais fait ce choix avec le personnage principal, je me suis senti très libre pour tous les autres aussi.
Comment ça s’organise d’un point de vue pratique ?
Il faut des consultants de langue. Des coachs pour aider les acteurs, ça c’est très important. J’avais un consultant qui m’aidait au moment des prises à marquer celles qui étaient problématiques. Je ne parle pas russe, polonais ou igbo, donc j’avais besoin qu’on me dise « là on ne comprend rien ». Après, j’ai une attention à la musicalité du texte donc je pouvais intervenir sur le jeu de l’acteur même si je ne connaissais pas la langue. Pour d’autres de mes films, j’avais déjà triché avec ça ; je savais que c’était possible.

Le film gravite autour d’une séquence de lutte à mort filmée à la caméra thermique. L’idée vous est venue comment ?
Déjà, on n’est pas dans Rambo. Je ne me voyais pas filmer ça comme un combat classique avec un gars en tenue de légionnaire, l’autre torse nu. À l’image, je m’autorise à aller ailleurs. Et pour moi aller ailleurs, c’était trouver une image qui puisse contaminer les deux corps dans cet affrontement. Que cette scène soit déjà une forme de danse. En tant que cinéaste, je ne voulais pas esquiver la violence, parce que ça reste un film de guerre, mais j’ai confiné cette violence au son, ce qui n’enlève rien à sa cruauté. Quand il y a un coup de poignard, tu sens vraiment le coup de la lame. En fait je crois que l’enjeu derrière, c’était vraiment de questionner la pornographie de la violence des images dans le cinéma d’aujourd’hui. Même chez des cinéastes que j’admire énormément, il y a une frontalité absolue, à une époque où cette frontalité est banalisée par les médias. Si on pense aux images de guerre aujourd’hui… On n’a aucune pudeur à montrer les corps des morts. Même des enfants. Je pense que, même si ces images sont parfois utilisées pour de bonnes raisons, cela reste limite et discutable. Si un de mes enfants décédait, je ne voudrais pas que son image de lui, noyé sur une plage, devienne un symbole. Il y a un truc dans le respect de l’autre qui s’est évaporé, sans doute à cause de cette profusion d’images permanente.
À partir de là, vous introduisez la notion de possession sous un angle très politique…
Oui, Aleksei vit plusieurs métamorphoses dans le film. Le corps de Franz change au fur et à mesure. On a beaucoup bossé ça avec lui, c’est un acteur avec qui tu peux travailler comme un sculpteur. Comment s’assoir, marcher ou boire… Il y a un véritable changement au fur et à mesure. Il porte en lui les morts, les assassinés, sans qu’on en parle vraiment. Il a un côté éponge. Donc la possession m’intéressait pour raconter cette rencontre avec Jomo et la faire habiter en lui.
Morr N’Diaye (qui joue Jomo) a une histoire personnelle très difficile. Il a connu la captivité en Libye, et ses bourreaux étaient nigérians. Pourtant dans le film, il joue justement un nigérian. Comment vous avez abordé le travail avec lui ?
J’étais très marqué par un documentaire dont il était un des personnages. Les auteurs avaient donné des caméras à des réfugiés mineurs dans un centre de détention. Dans sa façon de filmer et de parler, il avait quelque chose de spécial. Il rêvait d’être acteur et à la base j’ai pensé à lui pour un petit rôle. Mais au fur et à mesure du casting, j’ai vu son potentiel. Il avait cette force, ce charisme… Au début il refusait de jouer un Nigérian mais on en a discuté, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, quel type de Nigérian était Jomo aussi…

La bande originale porte tout le film. Comment s’est passée votre collaboration avec Vitalic ?
C’était mon premier choix, parce que je trouve que dans sa techno, il y a quelque chose de mélancolique, de lyrique, de sacré. Et ça m’intéresse de trouver du sacré là où on ne s’y attend pas. Il m’a proposé des morceaux avant le tournage qui étaient vraiment dans le mood. Je les ai partagés avec ma chef op et mes comédiens pour qu’ils puissent s’imprégner de tout ça et éviter d’avoir au montage un effet un peu clip avec juste la musique qui te tombe dessus. La chorégraphie des scènes de danse a aussi été travaillée sur les morceaux de Vitalic… C’était important que tout reste organique.
Dans Disco Boy, on passe de scènes de guerre à la nuit parisienne… D’où vient la première idée ?Tout vient d’une rencontre que j’ai faite dans une boite de nuit dans les Pouilles, en Italie, avec un danseur qui avait été soldat. Je trouve qu’il y a quelque chose entre le corps du danseur et le corps du soldat qui communique. Jusqu’à ce que ces deux corps deviennent la même chose. Jomo c’est un danseur et un soldat. Avant, il y avait moins de distinction. Quand tu penses à tous ces soldats qui dansaient lors de cérémonies avant d’aller au combat… Aujourd’hui, tu es soit danseur, soit soldat. La poésie, c’est mettre en communication deux choses, trouver cette étincelle entre deux mondes, deux univers. Moi ça part de cette expérience des clubs. Je ressentais quelque chose de mystique, avec ces corps qui bougent, ces gens qui s’abandonnent, la lumière sombre, la musique… C’est pour ça que la boite de nuit est située dans une ancienne église. Parfois les métaphores peuvent être lourdes, mais je voulais être un peu littéral avec ça.
Vous avez dû vous battre pour imposer des lieux de tournage ?
Il y a cette tendance au cinéma à faire des films où on peut garer des camions. Parfois, si tu veux tourner dans un endroit où il n’y a pas de parking, on te fait chier : « ah non, là on ne peut pas tourner parce qu’on ne peut pas garer les camions ! » À un moment, il faut dépasser ces contraintes-là, et lutter contre ce genre de choses. Bien sûr, il y a un principe de réalité, sinon tu ne fais pas ce métier, je pense. Mais quand tu sais que ça sert ton film, il faut se battre. C’est une lutte.