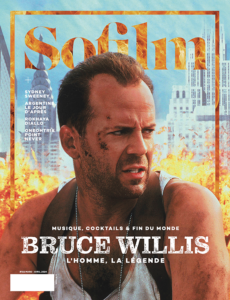UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT de Bi Gan
– En salles : UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT –
Très attendu après l’accueil dithyrambique de Kaili Blues, le deuxième long du cinéaste chinois de 29 ans agit comme un trip surnaturel à demi occulte, même si les artifices sont parfois plus profonds qu’il n’y paraît.
Ce serait un film banal, dit Bi Gan, peut-être un film noir, peut-être aussi un film d’amour, mais un film banal. Jugeons : Luo, beau type ténébreux, ancien tueur à gages, retourne à Kaili, sa ville natale, à la recherche d’une femme qu’il a aimée. Soit. Le récit, crevé à plein d’endroits, transforme l’ordinaire de cette quête en nocturne noir et mystérieux. Peut-être tragique aussi, derrière la « magie » (un mot de Bi Gan, présentant son film à Cannes). Un film coupé en deux, composé suivant les mots du poète Paul Celan, Pavot et mémoire, mais dans l’autre sens. Ce fut même le titre initial du film pour Bi Gan. De là, difficile de ne pas voir l’influence proliférante de Celan : l’ombre portée du poète sur le film est énorme – peut-il s’y soustraire ? –, qui projette un hors-champ politique et historique, l’une des forces du film. Alors, oui, dans la première partie, « Mémoire », il y a des figures connues (ruines familières, mafieux chantant au karaoké, tunnels et formes en décomposition). Un film noir et tortueux aux cartes bizarres ; ici, cachée dans une horloge, la photo calcinée d’une femme disparue ; là, une inondation ; ailleurs, des pommes qui pourrissent, de la rouille. La fille lui promet un baiser s’il trouve des pomelos, même si ce n’est pas la saison et on s’étonne que, hors saison ou pas, les arbres continuent à fleurir. Et puis, même s’il en trouve et même si des choses se passent, importantes et lointaines, comme les scènes d’un rêve qui nous file entre les doigts, le deuxième film commence. Il vient cristalliser, pendant près de cinquante minutes et en trois dimensions, les songes épars du premier.
 « Ceci n'est pas un film en 3D »
« Ceci n'est pas un film en 3D »
Il ne faut pas trop en dire, si ce n’est qu’au début un carton prévenait : « Ceci n’est pas un film en 3D, suivez notre héros pour savoir quand mettre vos lunettes… » Après plus d’une heure, Luo est arrivé dans une ville sur le point d’être détruite. Des spectacles s’y jouent et la femme qu’il cherche y serait. En attendant le soir, notre héros entre donc dans une salle de cinéma, où il chausse les fameuses lunettes. Sur l’écran commence alors Un grand voyage vers la nuit, ou « Pavot ». Peu importe que le plan-séquence hallucinant qui suit soit un trompe-l’œil clinquant ou une succession de prouesses techniques. Il s’agit d’une plongée, non pas dans un rêve mais dans une mémoire, commune et en relief. La rencontre avec une femme, la descente dans la « ville », les corps qui volent, tout est trop manifestement somptueux même si une menace lugubre semble peser sur les gens qui restent et sur le lieu, une scène de fortune devant un bâtiment soviétique agonisant. L’ostentatoire beauté plastique peut déranger. Réduire le film à une performance, avec son très long plan-séquence comme morceau de bravoure, c’est peut-être passer à côté. Si la 3D rapproche esthétiquement le film du jeu vidéo, le caractère immersif fait aussi sourdre quelque chose du jeu de guerre, question de lumière. La vitrine est attirante mais à y regarder de près, on est loin de l’enchantement féérique. Avec l’enquête de Luo, trois fois marquée par la perte (de la mère, de la femme, de l’enfant), le film dit quelque chose de l’absence, un « nous ne guérirons pas » réel qui ne produit ni pathos, ni lamentation. S’il y a une incantation pour des baisers de cinéma, des formules magiques qui font tourner les maisons, c’est le passé qui fait tournoyer les corps vers le ciel. Bi Gan aussi a l’élégance de faire semblant de n’avoir que des problèmes esthétiques. Il nous attire comme dans un piège. La première fois, on ne voit pas bien qu’il y a un cadavre sur un chariot, qu’il faut boire les cendres du puits, que partout des pommes pourrissent (on pense aux pommes grises de Volodine), que les lampions sont sur des décombres, que les maisons sont vides et inondées. Dans le poème « Corona », la formule « pavot et mémoire » est une manière de s’aimer : « Nous nous disons des choses sombres. Nous nous aimons comme pavot et mémoire. » Mais c’est toujours pour rien, juste avant d’oublier, comme on fait des nœuds à son mouchoir, toujours pour rien qu’on allume des feux de Bengale.
Peut-être que cette séquence en 3D agit comme un enchantement subtropical, qui nous attire dans ces lieux en voie de démolition, sinon on n’y serait pas allé. On a pourtant envie d’y revenir puisqu’on y descend en tyrolienne. La beauté un peu débauchée du film est peut-être sa seule possibilité et son seul moyen. C’est cet excès qui émeut, comme une jeune fille malade trop maquillée. Les rêves ne parlent pas franchement et, comme Celan, Bi Gan sait qu’ils sont toujours « une rude monnaie ». Johanna Chambon Reclus
Il ne faut pas trop en dire, si ce n’est qu’au début un carton prévenait : « Ceci n’est pas un film en 3D, suivez notre héros pour savoir quand mettre vos lunettes… » Après plus d’une heure, Luo est arrivé dans une ville sur le point d’être détruite. Des spectacles s’y jouent et la femme qu’il cherche y serait. En attendant le soir, notre héros entre donc dans une salle de cinéma, où il chausse les fameuses lunettes. Sur l’écran commence alors Un grand voyage vers la nuit, ou « Pavot ». Peu importe que le plan-séquence hallucinant qui suit soit un trompe-l’œil clinquant ou une succession de prouesses techniques. Il s’agit d’une plongée, non pas dans un rêve mais dans une mémoire, commune et en relief. La rencontre avec une femme, la descente dans la « ville », les corps qui volent, tout est trop manifestement somptueux même si une menace lugubre semble peser sur les gens qui restent et sur le lieu, une scène de fortune devant un bâtiment soviétique agonisant. L’ostentatoire beauté plastique peut déranger. Réduire le film à une performance, avec son très long plan-séquence comme morceau de bravoure, c’est peut-être passer à côté. Si la 3D rapproche esthétiquement le film du jeu vidéo, le caractère immersif fait aussi sourdre quelque chose du jeu de guerre, question de lumière. La vitrine est attirante mais à y regarder de près, on est loin de l’enchantement féérique. Avec l’enquête de Luo, trois fois marquée par la perte (de la mère, de la femme, de l’enfant), le film dit quelque chose de l’absence, un « nous ne guérirons pas » réel qui ne produit ni pathos, ni lamentation. S’il y a une incantation pour des baisers de cinéma, des formules magiques qui font tourner les maisons, c’est le passé qui fait tournoyer les corps vers le ciel. Bi Gan aussi a l’élégance de faire semblant de n’avoir que des problèmes esthétiques. Il nous attire comme dans un piège. La première fois, on ne voit pas bien qu’il y a un cadavre sur un chariot, qu’il faut boire les cendres du puits, que partout des pommes pourrissent (on pense aux pommes grises de Volodine), que les lampions sont sur des décombres, que les maisons sont vides et inondées. Dans le poème « Corona », la formule « pavot et mémoire » est une manière de s’aimer : « Nous nous disons des choses sombres. Nous nous aimons comme pavot et mémoire. » Mais c’est toujours pour rien, juste avant d’oublier, comme on fait des nœuds à son mouchoir, toujours pour rien qu’on allume des feux de Bengale.