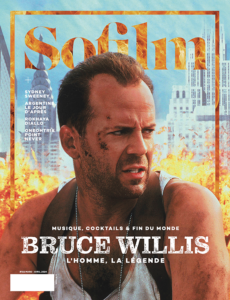CANIBA de V. Paravel et L. Castaing-Taylor
– LE FILM DE LA SEMAINE : CANIBA –
De Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor, on se souvient du mémorable Léviathan, immersion inouïe à bord d’un chalutier, au large de la côte-est des États-Unis. Avec Caniba, ils tentent le portrait impossible d’Issei Sagawa, Japonais qui avait tué et mangé une jeune femme à Paris, en 1981.Fidèles à leur recherche sensorielle, ils signent un documentaire remarquable et éprouvant. Reparti du dernier festival de Venise avec le prix spécial du jury, le film sort ce mercredi frappé d’une interdiction aux moins de 18 ans.
En 1981, Issei Sagawa, étudiant japonais à Paris, dévore le corps d’une de ses camarades de la Sorbonne, Renée Hartevelt. Déclaré irresponsable, il est extradé au Japon deux ans plus tard. Il a vécu depuis librement, profitant de sa sinistre notoriété, jouant dans des films érotiques pinku. Aujourd’hui malade et affaibli par un AVC, il vit près de son frère, Jun Sagawa, qui s’occupe de lui. Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor ont filmé les deux hommes, à l’étroit dans un minuscule appartement. Le problème posé par le crime et le désir d’Issei Sagawa, par nature rétif, ne trouve aucune réponse. C’est la grande force de ce film, face-à-face singulier, de ne tempérer ni par l’explication, ni par aucune mise à distance, l’effroyable folie de cet homme.
Filmé en très gros plan, Issei Sagawa s’exprime avec difficulté. Voix d’outre-tombe, temps infiniment long entre chaque bribe de phrases. Des phrases assez dures à entendre. L’inouï ici, le délire de cet homme, a pris chair sur une peau abimée, matière du film. Parlant, répondant à son frère, il mange, boit de l’eau. Le sujet, c’est la peau, la bouche, qui mastique, les dents qui broient, la gorge qui déglutit. Quelque chose s’agite vaguement sur la ligne d’horizon d’un visage qui se charge de questions indéchiffrables. Derrière il y a le frère flou. Il écoute, commente. À un moment c’est à son tour de prendre la parole, pour dire lui aussi ses désirs spéciaux ; sur son bras, organe sexuel, à la recherche de la « douleur parfaite ». Et de les faire voir. On comprend que les deux cinéastes qui rêvent depuis longtemps d’ «adapter » le De Humanis Corporis Fabrica de Versalius, première encyclopédie anatomique, aient conçu ce film comme une rencontre organique, partant du corps et revenant au corps. « Un paysage brumeux de chair », ce sont leurs mots pour évoquer le visage de ce sujet qui déborde parfois du cadre. Allant comme pour visiter la peau, leur caméra passe d’un frère à l’autre, du net au flou, ménage des intervalles, fondus au noir, témoignage de l’un et interprétation de l’autre, passages entre apparition et disparition.

À cette intimité éprouvante se joignent d’autres images, dont il ne faut pas attendre de salut, elles n’atténuent ni n’éclaircissent rien. Jun Sagawa découvre l’hallucinant manga dessiné par son frère, quelques années après son crime. Ultra-explicite, il ajoute aux événements déjà racontés par la parole, une représentation dessinée de ce qu’on aurait cru irreprésentable. « C’est une erreur que cela existe aux yeux du monde » rejette le frère. Traces du lien fraternel : les peluches dont Issei Sagawa est entouré, un petit chien, ou « Monsieur Castor » offert par son cadet à son retour de France « pour le consoler ». Sur la toile de fond de leur délire, ces résidus d’enfance très latents (les deux adorent Disney) sont plutôt glaçants. Le passage à des images de leur enfance, archives d’abord en noir et blanc, fait basculer le film. Deux petits garçons fusionnels dansent, jouent, dans un jardin, sur un manège, une balançoire. Liées aux images qui ont précédé, ces images a priori innocentes se chargent d’une opacité assez monstrueuse. Même angéliques, ces souvenirs sont irrémédiablement hantés par le futur, et c’est bouleversant de voir ces images se transformer sous nos yeux, passer de la clarté à l’inexplicable.
Quelque chose nous arrive en même temps qu’à ces images et il est difficile de ne pas vivre ce film autrement que sur le mode de l’accident. Partant que le délire est toujours un cataclysme, il faut reconnaître ici la réussite du film à rendre présent l’incompréhensible. En s’ouvrant ainsi à l’autre, aussi abject soit-il, les réalisateurs partagent avec ce film ce qu’on n’aurait pas imaginé être partageable, expérience si troublante qu’elle métamorphose, pour longtemps, des petits garçons en ombres maudites. Déplacés par ces images, nous marchons parmi ces fantômes, sur un fil tiré entre la sensation et ce qui est figurable. – Johanna Chambon Reclus
Caniba, de Verena Paravel et Lucien Castaing Taylor, en salles le 22 août