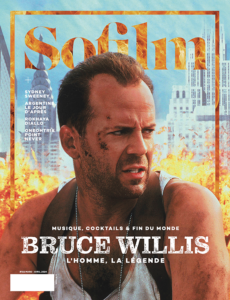GREEN ROOM de Jeremy Saulnier
– LE FILM DE LA SEMAINE : GREEN ROOM –
Après le succès de Blue Ruin, le nouveau film de Jeremy Saulnier était très attendu. Et Green Room n’y va pas par quatre chemins : un groupe de jeunes punks s’y trouve traqué et massacré par une horde de néonazis. Le pitch est simple, l’œuvre beaucoup moins. Et emprunte finalement plus à John Hughes qu’à Rob Zombie.
Photos : © Broad Green Pictures
Photos : © Broad Green Pictures
Green Room est un survival dément. Celui que l’on n’attendait plus. À la fois dans la lignée des Chiens de paille de Peckinpah ou d’Assaut de Carpenter – sans les déshonorer – et des meilleurs slashers. La violence y est frontale, inconvenante et certaines scènes d’un gore abouti au point d’en être surprenantes ; comme dans un film de guerre où les corps seraient déchiquetés comme du papier mâché, comme si le conflit se déroulait, cette fois, à la maison. Saulnier, en bon enfant des seventies, a été abreuvé des trucages old school, façonnés à la main et jamais derrière un ordinateur. « Ce qui me plait dans les effets spéciaux, c’est leur aspect physique et très réel. (…) Quand quelqu’un meurt, je veux que cela fasse mal », confie-t-il sans ambages. Au rayon des inspirations, on trouve donc évidemment le travail de Rob Bottin, ce maquilleur de génie qui officia sur Piranhas, Maniac, Hurlements ou The Thing : très peu de CGI et un maximum d’artisanat manuel, pour un rendu que l’on avait presque oublié à l’ère du polissage décérébré. Green Room, pour ne rien gâcher, est aussi très drôle. Pas un gloussement de connivence, comme dans Scream, qui joue la carte de l’autocitation et de la mise en abyme ; pas un ricanement parodique détestable désamorçant toute tentative de sérieux, tel qu’on l’a vu fleurir ces dernières années. Bien au contraire : le rire est ici devenu naturel, réponse logique et presque involontaire, chimique, à l’absurdité de la situation et de la violence du monde. Sans jamais faire retomber la tension.

La destruction d’un idéal
Cela suffit à en faire un très bon film de genre, déjà supérieur à Blue Ruin, le précédent Saulnier auréolé d’une belle réputation, bien qu’encore un peu hésitant. Mais Green Room va encore plus loin et c’est finalement ce qui le singularise pleinement : il est incroyablement tendre. Même les pitbulls tueurs y sont finalement magnifiés, tandis que les néonazis recèlent leur part d’incertitudes et de complexité. Tout le monde peut être sauvé et la beauté se cache parfois dans les recoins les plus sombres, raconte Saulnier en filigrane. C’est d’ailleurs le cœur du film, ce qui lui permet de se placer très clairement au-dessus de la mêlée. Il n’est même plus question d’un clan d’extrême droite qui massacre un groupe de punk composé de post-ados, mais de jeunes fauchés et innocents qui enchaînent les concerts, tracent la route pour fuir la norme avant de se prendre un mur en pleine face. Des types aux cheveux peroxydés qui se réclament de Black Sabbath et Led Zeppelin, mais respirent Neil Young ou Simon & Garfunkel ; plus John Hughes que Rob Zombie, finalement. Les premiers plans du film annoncent d’ailleurs la couleur : la petite troupe se réveille sur les sièges d’une voiture de fortune, bercés par une lumière diaphane. Ils ont les cheveux gras, la bouche pâteuse et l’apparence de ceux qui ne se lavent pas beaucoup, mais conservent la pureté des poupins en cherchant leur voie dans la plus grande des candeurs. Au-delà du simple dézingage de jeunes un peu paumés, c’est la tentative de destruction de cet idéal que filme Saulnier ; et c’est le constat de son immortalité qui fait de Green Room un film définitivement, furieusement à part. – Axel Cadieux
Green Room
de Jeremy Saulnier, avec Anton Yelchin, Imogen Poots, Patrick Stewart. Actuellement en salle.