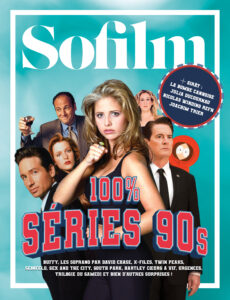Super Happy Forever de Kohei Igarashi
Par Éric Vernay.
L’objet perdu : une casquette de couleur rouge égarée en 2018. « Il y a cinq ans », précise Sano à un maître d’hôtel circonspect. Nous sommes au Japon, sur la péninsule d’Izu, dans une ville côtière démodée. Et si la casquette rouge est cruciale pour ce jeune homme en tee-shirt Umbro, nous ignorons d’abord pourquoi. En conteur avisé, Kohei Igarashi sait ménager le mystère. Remarqué en France avec Takara, la nuit où j’ai nagé (coréalisé avec Damien Manivel, qui a comonté Super Happy Forever), le cinéaste enchevêtre ellipses et strates temporelles avec fluidité. La première partie de ce beau film miroitant se conjugue au présent. On y suit donc Sano, épaulé par son ami Miyata, dans sa micro-odyssée erratique, entrecoupée d’événements plus ou moins triviaux ou accablants, comme l’arrêt cardiaque en bord de piscine d’un vieil inconnu. La vie tient à peu de chose, et malgré la sérénade des cigales, l’ambiance est morose dans les couloirs décatis du grand hôtel où les deux garçons résident. Quasi désert, le lieu va bientôt fermer. Dans ce cadre décourageant, Sano se montre impoli, alpaguant les gens avec rudesse. Un appel téléphonique concernant sa femme l’agace tant qu’il jette son portable à la mer. On comprend peu après que sa compagne est récemment décédée, à la fois brusquement et en douceur : dans son sommeil. Ce qui donne un aspect cruellement irréel a sa tragédie : comme hanté par le fantôme de cette histoire avortée, l’endeuillé Sano ne croit plus en rien et réagit en malmenant son entourage, notamment Miyata. « Tu dégages une mauvaise énergie », finit par rétorquer le souffre-douleur, très versé sur les « auras » et autres « messages » envoyés par le cosmos – « Super Happy Forever » est d’ailleurs le nom d’un séminaire New Age auquel il veut assister à Izu. Si la fixette de Sano sur la casquette écarlate lui semble trop matérialiste, il y a pourtant quelque chose de proustien dans sa recherche : il s’agit moins de retrouver le couvre-chef que le temps perdu.
À recherche de la casquette perdue
Ce passé ne ressurgit pas avec la casquette mais par le biais d’une chanson, madeleine qui génère la deuxième partie du film. En écoutant la femme de chambre fredonner une reprise de Charles Trenet, Sano part dans une rêverie qui nous propulse à l’époque de sa rencontre avec la regrettée Nagi. Dès lors – et là réside toute l’élégance d’Igarashi, qui refuse de figer le film dans une nostalgie sanglotante –, c’est la jeune femme qui prend les rênes du récit, comme si elle continuait à vivre une existence propre. Ce retour en arrière ne ressemble donc pas à un long flashback écrit d’avance : il a le pouls palpitant et maladroit des débuts amoureux ; et avec lui, le film de deuil annoncé se reboote complètement, réincarné en une romance pleine d’allant. Revisités par les tourtereaux, et même s’ils ont peu changé en une demi-décennie, les lieux si décrépits de la première partie semblent retrouver leur éclat, tout comme les personnages : par les yeux de Nagi, on apprend à donner une deuxième chance à l’irritant Sano, qui se révèle – ce n’est pas difficile – plus charmant. Et la casquette dans tout ça ? Elle finit sur la tête d’un personnage féminin secondaire, qui passe alors au premier plan pour boucler la boucle temporelle, ouvrant un nouvel embranchement vertigineux : le futur, riche du passé retrouvé, encore en brouillon.
Super Happy Forever, en salles le 16 juillet.