Nadav Lapid / Jean Narboni : « Mon cinéma parle d’une société malade »
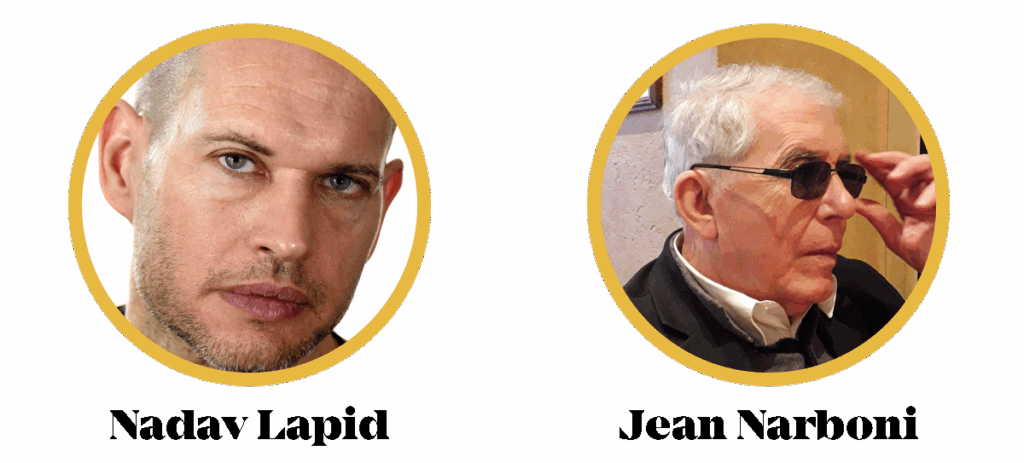
Ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma et membre du Groupe cinéma de l’université de Vincennes – avec lequel il co-réalisa L’Olivier entre 1973 et 1975 –, Jean Narboni s’est longtemps attaché à faire entendre la voix du peuple palestinien, à une époque où la cause était encore largement ignorée en Occident. Né à Tel-Aviv en 1975, Ours d’or de la Berlinale pour Synonymes en 2019 et Prix du jury du Festival de Cannes en 2021 pour Le Genou d’Ahed, Nadav Lapid ne cesse d’ausculter les déboires de la société israélienne, empoisonnée par le nationalisme et le désir de vengeance. Alors qu’une manifestation en soutien à Gaza se prépare sur la place de la Bastille, près de laquelle ils se sont donné rendez-vous, les deux décortiquent le cinquième long-métrage du réalisateur israélien, Oui (en salles depuis le 17 septembre), qui met en scène les atermoiements d’un artiste contraint de composer un hymne pour la propagande de son pays.
Jean Narboni : Votre projet de film initial a été percuté par un événement majeur, le 7 octobre – la razzia meurtrière du Hamas et la réponse vengeresse d’Israël –, mais au lieu d’en être stoppé net, il s’en est nourri. Pouvez-vous nous le raconter ?
Nadav Lapid : Mon film est né deux fois. Dans mon esprit, il est mort le 7 octobre et a rejailli les jours d’après. Je suis un fanatique du présent. Je pense que, s’il est largement inférieur à la littérature pour parler du passé, il n’y a rien de tel que le cinéma pour parler du présent. Le film initial rassemblait donc toutes sortes de questions que je me posais, par rapport à moi-même, et plus particulièrement par rapport à cette posture de l’artiste qui dit non. Le cinéma est fort pour créer des héros qui disent non. Il y a cet héritage du western américain, avec le justicier qui quitte son village en lui tournant le dos. À bien des égards, ce « non », et la capacité de l’artiste à dire non à la société, me semblent être aujourd’hui un peu archaïques. Il faut avoir un certain orgueil pour se positionner contre, pour s’exclure, cet orgueil paraît même démodé. De nos jours, le nouveau mot serait donc : « oui ».
Quels étaient les contours du projet initial ? La langue, le lieu de tournage ?
Il était question de tourner aux États-Unis. Ou n’importe où d’ailleurs. J’avais l’impression que cette soumission des artistes pouvait être valable dans bien d’autres pays, hormis la France, où vous avez encore une vision très haute du rôle de l’art. En Israël, être cinéaste, c’est tout sauf quelque chose qui fait rêver. Évidemment, le film aurait été très différent s’il avait été tourné ailleurs, et si le 7-Octobre n’était pas arrivé. Il aurait davantage ressemblé à une sorte d’errance autour de la crise existentielle, personnelle, artistique que vit Y.
Le « oui » a quelque chose de glorieux, de positif, d’éclatant. J’ai le sentiment qu’ici la chose est plus compliquée, il y a plusieurs nuances de oui. Un miroitement qui va du plus anodin et ludique – la promenade de Y dans Tel-Aviv avec son fils – à la soumission totale, quand il accepte de composer la musique de l’hymne meurtrier.
Son « oui » a une dimension très enfantine. Y dit oui presque par jeu, ou pour éviter d’avoir à prendre position, plutôt que par opportunisme, ou par volonté de se glisser en haut d’une échelle sociale. En ce sens, je crois qu’il est très différent de sa femme.
Vous semblez plus indulgent pour votre personnage que sa femme avec lui à mesure que le film avance…
Parce que, d’une certaine manière, sa femme est beaucoup plus mûre que lui.
Je vois la troisième partie de Oui comme une variation sur Le Mépris. Le milliardaire russe de votre film, c’est Jack Palance, un potentat qui passe commande de choses détestables à quelqu’un qui, par appât du gain, lâcheté, mais surtout pour éblouir sa femme, accepte tout, devient un véritable yesman. Au risque de se faire mépriser et quitter par elle.
C’est très intéressant parce que j’ai beaucoup hésité à ce que le milliardaire russe soit américain. J’ai lu quelque part que le film ressemblait à une sorte de Sailor et Lula à Tel-Aviv. Le Mépris me semble beaucoup plus juste. Mon film commence par une déclaration d’amour absolu au milieu d’une fête, de ce couple isolé du monde, comme Brigitte Bardot et Michel Piccoli sont isolés dans leur lit. Quand on vit dans une société polluée par le capitalisme ou la violence comme en Israël, c’est beau de penser qu’on peut se créer des îlots de beauté, à l’intérieur de la société. C’est ça, l’amour. Bien que ces gestes finissent toujours par être salis par le monde.
On a parlé de votre film comme d’une comédie musicale. Je le ressens comme à la fois une comédie musicale et son cauchemar. Il m’a fait penser à une pièce de Ravel, une danse justement, La Valse, très marquée par la Première Guerre mondiale. Elle commence comme une valse viennoise, que Ravel adorait, et peu à peu elle s’assombrit, se tend, se déforme, se défigure, sonne faux et culmine en une apothéose sinistre. La première scène de Oui affiche une gaieté et une frénésie qu’on sent factices, qui s’exacerbent pour laisser place aux hurlements, à la surenchère dans la pitrerie et la vulgarité de corps de garde. Comme si la débauche d’énergie des participants de cette fête était celle du désespoir et qu’ils ne voulaient pas s’avouer qu’ils dansent sur un volcan.
Mes personnages dansent parce que le silence, l’immobilité, les obligeraient à affronter tout ce qu’ils sont en train de fuir. La comédie musicale, c’est une sorte de drogue, d’hallucination. Mais comme vous le dites, le désespoir pénètre leurs mouvements, leurs expressions. J’ai voulu monter la deuxième scène comme si Leni Riefenstahl avait fait une comédie musicale. Une comédie musicale fasciste, où tout le monde est en rang, où s’exprime le cliché du peuple.

La deuxième partie du film, très belle, contraste violemment avec la première : moins agitée, plus sourde, profonde et grave : regret d’un amour qui aurait pu être entre Y et Leah, impuissance devant ce qui se perpètre à Gaza. Le moment le plus intense de tout le film est celui où ils sont en voiture. Leah évoque d’abord les chiens qui à Gaza dévorent les cadavres qu’on n’a pas eu le temps d’enterrer ; puis vient le long plan fixe de plusieurs minutes où elle énumère les abominations du 7 octobre. André Bazin se disait bouleversé par le moment, dans le long discours final du Dictateur, où le masque de Charlot se fissurait pour laisser peu à peu apparaître le visage de Charles Spencer Chaplin. Dans votre film, Leah commence par détailler un peu mécaniquement ce qui s’est passé le 7 octobre, et dans un débit de plus en plus précipité montent sa colère et sa douleur irrépressibles. On ne sait plus si c’est le personnage ou l’actrice qui parle, elles ne font plus qu’un ou une.
Je dois dire qu’à aucun endroit, dans le scénario ou dans nos discussions, il était inscrit qu’il fallait qu’elle pleure, ou que sa voix tremble. Je n’avais donné aucune indication. C’est l’un de ces moments où la vérité prend le pas sur la scène que vous aviez imaginée. En tant que cinéaste, on aspire toujours à faire un film qui sera plus que le film. Je lui ai dit : « Récite ton texte et on verra bien ce qu’il va se passer. » On a roulé sur une route cahoteuse, qui donne un tremblement à sa voix. Ça non plus, je ne pouvais pas le prévoir. Ce sont des moments où on perd le contrôle, ou tout devient vie.
Vous avez fait combien de prises ?
Trois ou quatre prises entières, pas plus. Et j’ai gardé la dernière. J’aurais aimé vous dire que la première était la plus belle, par goût du naturalisme, mais vous savez, pour faire du cinéma, il faut commettre beaucoup d’actes mensongers. On cherche le point de rencontre entre le mensonge et la vérité.
Dans la première scène du film, vos personnages donnaient l’impression de danser sur un volcan. Quand Y et Leah s’embrassent sur la « colline de l’amour » qui surplombe Gaza, j’éprouve un peu le même sentiment : un baiser devant des décombres. C’est assez insoutenable. Combien de temps êtes-vous restés là puisque, comme le dit Leah, si nous regardons Gaza, Gaza aussi nous voit ?
On n’avait pas l’autorisation de monter sur la colline, l’armée estime qu’il y a un danger de tirs de missiles. On l’a donc fait en mode guérilla, avec l’équipe la plus réduite possible, comme une véritable opération. Au bout de cinq minutes, mon assistant, resté en bas, m’informe qu’un véhicule de l’armée arrive et qu’il faut tout arrêter. Je lui demande de parler avec eux, en utilisant des phrases très longues et des formes indirectes pour nous faire gagner du temps. Trente minutes, quarante minutes passent sans qu’il se passe rien, et je décide de le rappeler. Il m’informe qu’on a eu une chance folle, que l’officier s’intéresse beaucoup au cinéma et qu’il leur a demandé : « Comment vous savez où placer la caméra lorsque vous tournez ? » Ce qui est peut-être la plus grande question du cinéma. Ils ont donc discuté là pendant une heure. Il n’a pas obéi à ses supérieurs et a même rembarré un policier qui venait voir ce qu’il se passait. Sa cinéphilie nous a sauvés.
« Il faudrait que je me prive de regarder les films de Godard pendant au moins cinq ans »
Nadav Lapid
J’ai entendu dire que des gens allaient pique-niquer sur cette colline ou observer les bombardements avec des jumelles, est-ce vrai ?
Avant le 7 octobre, c’était un lieu de rencontre romantique, les gens du coin et les militaires venaient ici avec leurs copines. C’est horrible, triste, et c’est aussi le signe d’un appauvrissement culturel dans le pays. Ces gens vivent dans des villes où il n’y a plus de salles de cinéma, ils viennent ici comme à un spectacle, avec leurs familles, leurs enfants… Il faut le dire, ils sont aussi animés par le sentiment de vengeance.
Votre premier montage ne comportait pas la scène délirante où vous filmez, littéralement et longuement, ce qu’on appelle un léchage de bottes. Pourquoi avoir décidé de la réintégrer dans la version finale ?
Je vais être honnête… Dans un moment de faiblesse, j’ai accepté de couper la scène pour satisfaire le comité de sélection du festival. Ils sont, en quelque sorte, nos oligarques à nous. J’ai dit « oui ». Sans quoi je n’aurais jamais pensé à la retirer. C’est un moment très important, qui montre Y complètement désabusé, désillusionné, qui justifie sa tentative de suicide. C’est aussi une manière de se révolter. Il va jusqu’au bout de l’humiliation plutôt que d’exprimer son indignation. Son seul geste de révolte, c’est qu’il embrasse le Russe. Il lui fait goûter, à travers un baiser, le goût des souliers.
Cette scène m’a fait elle aussi penser à Godard. Comme une version transgenre du grand agencement machinique sexuel de Sauve qui peut (la vie) : l’oligarque maître de cérémonie relayant Roland Amstutz et Isabelle Huppert ayant fait sa transition en Y, plus quelques comparses.
Encore une fois, c’est quelque chose de tout à fait inconscient. Mais vous avez certainement raison. Peut-être qu’il faudrait que je me prive de regarder ses films pendant au moins cinq ans… C’est le seul moment du film qui regarde du côté du documentaire, pour contrer la dimension allégorique de la scène. C’est ce qui situe le film entre la fable, la féérie, et de l’autre côté une forme plus néoréaliste.
On pense aussi au cinéma burlesque primitif, avec sa dimension obscène, presque scatologique…
Pour moi, c’est presque une scène de cinéma muet. C’était très important pour moi que le film « joue » constamment, avec différents thèmes – l’amour, la mort –, et qu’il passe par différentes formes.

On est surpris par le happy end, avec ce« sauve qui peut la vie » de l’épouse qui évite à Y de mourir renversé, et la fin chaplinienne. Pourquoi ce renversement final ?
Certaines personnes m’ont fait la remarque : « Mais je ne comprends pas, ce mec, il est tellement indécent, il mériterait de se faire écraser par une voiture. » Pourquoi le sauver ? D’abord, parce que ça ne m’intéressait pas de faire un conte moral. Je ne voulais surtout pas me retrouver dans une position réprobatrice par rapport à Y. Y, c’est moi, c’est nous. J’aime l’idée qu’il soit sauvé par l’amour, comme une force sauvage au-delà du bien et du mal. À partir du moment où vous êtes suffisamment aimé par quelqu’un, vous méritez de rester en vie. Vous évoquiez Chaplin, cette fin me fait penser à celle des Temps modernes, où ce couple marche ensemble, vers nulle part. C’est le geste le plus romantique qui soit, dans notre ère désespérée. Cette fin rend le film beaucoup plus sauvage que s’il avait payé pour ses crimes.
Votre cinéma est à l’opposé de ce qu’on appelait péjorativement autrefois « la fiction de gauche », confortablement surplombante, la position du pur contre les impurs. Vous ne vous montrez pas indemne de la boue que vous décrivez. Un peu comme dans le poème de Baudelaire : « Je suis la plaie et le couteau ! / Je suis le soufflet et la joue ! / Je suis les membres et la roue / Et la victime et le bourreau ! »
J’ai parfois l’impression d’être atteint par les mêmes maladies que je dénonce. Je ne veux pas me placer du côté du bien ou du mal. C’est justement cette friction qui fait la vivacité du film. Je n’allais pas mettre Y sur une chaise électrique.
J’ai lu le livre Description d’un combat que vous ont consacré les éditions de l’Œil. Vous dites à un moment qu’après le 7-Octobre vous avez senti qu’il vous fallait « retourner en Israël comme Isaac ». Pourquoi Isaac, plutôt qu’Ulysse ou un autre ? Parce qu’il a failli mourir par son père et qu’il a été sauvé de justesse, comme Y ? À un moment, il hallucine que sa mère, conscience morale, veut sa perte en lui jetant des pierres.
En tant qu’Israéliens, on est conditionnés à l’idée de retourner en Israël. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste devient marginal. Ce pays, c’est à la fois notre lune et notre soleil. En ce sens, je me sentais obligé de revenir. Comme Isaac, je n’avais pas l’option du refus.
« J’ai parfois l’impression d’être atteint par les mêmes maladies que je dénonce »
Nadav Lapid
Je sais d’expérience que parmi ceux qui s’enthousiasment pour vos films, certains, je dis bien certains, déduisent de votre dénonciation de la politique criminelle de Netanyahou et des ministres encore plus extrémistes que lui auxquels il doit sa survie politique, une remise en cause de l’État d’Israël « en soi » : catastrophe, monstruosité, survivance coloniale… Ou – comme je l’ai entendu dire un jour de façon glaçante par quelqu’un avec qui je croyais mener le même combat – entité « intrinsèquement perverse ».Le fait que votre cinéma puisse être abusivement capté dans ce sens vous trouble-t-il, ou le cinéaste et non le politique que vous êtes, y est indifférent ?
Je ne m’en moque pas du tout. J’ai lu des critiques très élogieuses qui appelaient le film un brûlot. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Ce serait oublier sa dimension amoureuse. Si je voulais dénoncer tout un peuple, je ne lui aurais pas fait cadeau de l’amour. Bien sûr, mon cinéma parle d’une société malade. Mais il traite moins de problèmes politiques concrets, comme Netanyahou, l’occupation, les checkpoints, que de quelque chose de malsain qui a pénétré notre vie de tous les jours, qui salit les choses les plus intimes, qui pervertit les âmes. Parler de mon film comme d’un manifeste anti-israélien, c’est tellement l’appauvrir. J’étais à Paris lors du 7-Octobre, et je dois dire que j’ai trouvé la grande majorité des réactions totalement mécaniques et superficielles. Le débat sémantique pour savoir s’il fallait nommer le Hamas comme un groupe terroriste, ou non, était sans intérêt. Pour parler du conflit, il faut parler de toutes les dimensions. Des passions qui animent chacun comme de la mort. C’est ce que le cinéma permet. D’aller chercher une forme de vérité politique telle que je la vois.
CET ENTRETIEN A ÉTÉ PRÉPARÉ À L’AIDE DU RECUEIL NADAV LAPID, DESCRIPTION D’UN COMBAT, PARU LE 15 SEPTEMBRE AUX ÉDITIONS DE L’ŒIL.
Oui, en salles le 17 septembre.
