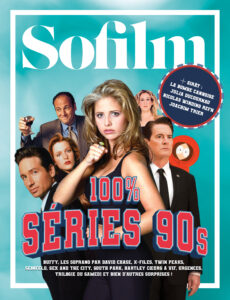AFTERSUN de Charlotte Wells
Un an après la sortie des deux volets des Souvenir de Joanna Hogg, c’est au tour d’une cinéaste écossaise de livrer un élégant récit rétrospectif. Nulle liaison toxique à l’horizon, Charlotte Wells raconte une relation père-fille le temps d’un séjour all inclusive en Turquie pendant les années 1990.
Sous le soleil qui nimbe le resort, Sophie, 11 ans, et son papa Calum n’appartiennent pas tout à fait à la communauté touristique. Ils s’amusent des clients de ce simili Club Med et se réfugient dans une bulle que les bruyants adolescents qui les entourent ne parviennent pas à faire éclater. Ayant emporté avec eux une caméra DV, ils se filment à tour de rôle et fabriquent avec ces vidéos un cocon dans lequel Sophie, devenue adulte, s’immiscera à nouveau. Aftersun est une parenthèse estivale qu’on découvre être le souvenir de sa protagoniste au détour de quelques flashforwards éparts.
Sourire enfoui
Entre physique de dieu grec et slow ninja moves, c’est Paul Mescal qui incarne ici le jeune papa. Rendu célèbre par la série Normal People, il donne au personnage la gravité d’un trentenaire ayant grandi trop vite, ancré mais toujours perdu. Il est irrémédiablement ailleurs, et sa fille Sophie se charge de le ramener à la réalité. Elle compare son âge au sien et tente de partager avec lui une motivation, un allant qui lui manque. Comme ces deltaplanes qui glissent au-dessus de leurs têtes, Calum est un corps flottant qu’un plâtre empêche de se baigner dans la piscine de l’hôtel. Après l’avoir retiré seul dans sa salle de bain (l’un des plus beaux plans du film), il s’aventure en mer. En stage de plongée avec sa fille, alors qu’un masque coule et qu’il tente vainement de le récupérer, on comprend l’attraction du personnage pour les profondeurs. On saisit petit à petit l’abîme intérieur auquel Sophie ne peut rien opposer et qui pousse son père à se soustraire perpétuellement à la compagnie des autres. Les plans en contre-plongée l’isolent, découpant sa silhouette sculpturale sur fond de ciel, sous l’eau, en haut d’un amphithéâtre, ou en équilibre sur la balustrade d’un balcon. Les bras tendus à l’horizontale, on dirait un ange.

Pour filmer ce personnage hors du monde, Charlotte Wells recourt sans arrêt à des intermédiaires : le caméscope de Sophie ou les miroirs de leur chambre d’hôtel. Wells découpe l’espace et joue sur les surfaces de réflexion : un écran de télé sert aussi bien à montrer ce qu’on y diffuse que ce qu’il reflète. À côté de ce poste, la caméra s’attarde sur une pile de livres, où figure un recueil de Margaret Tait. On doit à cette artiste écossaise un unique long métrage, Blue Black Permanent, dont les flash-backs de vacances ont dû influencer la composition d’Aftersun. Un père soudainement en charge de sa fille de 11 ans, un plâtre, des plans sous-marins dans une piscine : il n’est pas incongru de penser également à Somewhere de Sofia Coppola. Mais loin d’être centré sur la trajectoire d’un homme qui redécouvre la paternité, Aftersun accompagne une jeune fille qui voit son père dériver. Charlotte Wells nous rappelle épisodiquement que cette virée estivale quasi insulaire est remémorée vingt ans plus tard. Alors que Calum abandonne sa fille un soir pour aller danser, les lumières stroboscopiques de scènes de club créent un pont visuel entre lui, et Sophie adulte. Un final dansé au son de « Under Pressure » renforce le parallèle temporel. C’est dans cette brèche que se terre l’émotion de l’amour filial. La fille, qu’une scène révèle devenue mère, prend la relève de son père qui avouait : «I can’t see myself at forty, to be honest » (« Honnêtement, je ne me vois pas à 40 ans »).