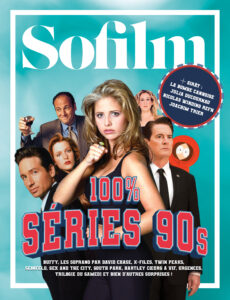Scandar Copti (Chroniques d’Haïfa) : « Aujourd’hui, ma priorité n’est pas d’être réalisateur »
Tourné en 2022, Chroniques d’Haïfa – Histoires palestiniennes (actuellement en salles) tire le portrait d’une riche famille palestinienne, insérée dans la société israélienne à grand renfort de non-dits et d’arrangements avec la réalité. Un film-choral, diffracté entre les points de vue et les problématiques de chacun des membres de la famille : la relation cachée du fils avec une juive, la fille qui se débat contre les carcans religieux et familiaux, les angoisses financières du père, la mère qui essaye de maintenir la réputation de sa famille… Le réalisateur palestinien installé en Israël Scandar Copti recolle les morceaux.
Propos recueillis par Alice de Brancion
Pourquoi avoir choisi de rythmer le quotidien de cette famille arabe, par le biais de fêtes juives ?
Le thème principal du film, c’est l’endoctrinement, qui se fait depuis le plus jeune âge et à différents niveaux en Israël. À travers le système éducatif, la famille et donc, à travers les fêtes, qui sont des événements très construits politiquement, socialement et culturellement. Le film s’ouvre avec la fête de Pourim, qui commémore la reine Esther protégeant le peuple juif des attaques d’un roi perse, en le tuant, lui et ses enfants. Comme elle, beaucoup de fêtes – comme le jour du souvenir ou le Memorial day, qui commémore les victimes de la Seconde Guerre mondiale – prennent racines dans ce sentiment de persécution du peuple juif. Tout le narratif d’Israël est de construire un récit rappelant sans cesse l’existence d’une menace extérieure, bien souvent arabe.
Bien que bourgeoise, la famille que vous dessinez a le plus grand mal à s’insérer en Israël. Comment le vivent-ils ?
Mal ! Les enfants, notamment, vivent dans une sorte de double système d’oppression : ils doivent à la fois obéir aux règles strictes de leur famille et tenter de s’intégrer dans la société israélienne. À cela s’ajoute un sentiment de culpabilité face à la condition de la majorité des Palestiniens, et l’impossibilité de réagir face à ça. Pour ma part, je viens d’une famille très politisée et, comme certains de mes amis, j’ai décidé de ne pas rester silencieux, de parler à travers mes films. Le risque est de tout perdre… Mais je ne juge pas pour autant les gens qui ne prennent pas position, d’une certaine manière, je comprends leur situation.
Pourquoi avoir choisi de travailler exclusivement avec des acteurs non-professionnels ?
C’est leur imperfection qui m’intéresse. J’ai le sentiment d’avoir plus de facilité à m’identifier devant les documentaires que devant les films. Les personnes, dans la réalité, ont plus d’imperfections, plus de naturel. Dès le début, j’avais en tête de travailler avec de vrais docteurs, de vraies infirmières, des mères de famille. Ensuite, je leur ai simplement appris à improviser.

Suivez-vous tout de même un script ?
Le script me sert principalement à demander des financements. Pour le reste, je pars de séquences documentaires, que je rejoue en présence de mes acteurs non-professionnels. Je pense par exemple à cette scène dans la maternelle où des enfants dessinent des soldats pendant que leur institutrice leur parle de la grandeur d’Israël, en présence d’une assistante palestinienne. Lorsque que je demande à Manar Shehab, qui est réellement assistante maternelle dans la vie, de jouer ce rôle, elle n’a qu’à amener ses vraies émotions. C’est elles que je cherche, pour faire ressortir alors toute la violence ordinaire que subissent les Palestiniens.
Dans ce dispositif, tout peut arriver ?
Tout à fait. Je ne dirige pas les comédiens, je les laisse évoluer dans l’espace comme ils le souhaitent. Pour pouvoir les suivre, j’ai deux chefs opérateurs et je filme avec deux caméras que je dirige tout le temps. Tout est en lumière naturelle, il n’y a pas non plus de perches de son, tout le monde installe ses micros-cravates le matin, et c’est tout.
Pourquoi ne pas avoir tourné un documentaire ?
Mon prochain film est un documentaire ! Mais j’apprécie le fait d’écrire des histoires qui ne sont pas directes, qui peuvent tout de même être un peu plus subtiles que la réalité, qui forcent certaines réflexions.
Votre film aurait-il été différent s’il avait été tourné après le 7 octobre ?
Évidemment, mon état d’esprit n’aurait pas été le même au regard du génocide. Tourner une chronique familiale au moment où des enfants se font massacrer, cela aurait été difficile, peut-être même impensable. Tout comme aujourd’hui, ma priorité n’est pas d’être réalisateur, c’est d’être Palestien. Paradoxalement ça m’enlève toute pression d’être un bon réalisateur. Je veux surtout être un bon humain, un bon Palestinien.
Chroniques d’Haïfa – Histoires palestiniennes, actuellement en salles.