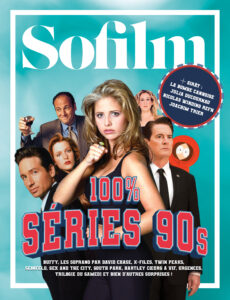Jeff Nichols : « Il faut aimer ses personnages, pour qu’ils existent en retour »
Jeff Nichols, un cinéaste à part. Un pied à Hollywood, l’autre dans le Midwest. Tout au long de ses cinq premiers films, de Shotgun Stories à Loving en passant par Mud et Take Shelter, le petit prince de l’Arkansas a oscillé entre tendresse et tragédies, fresques familiales en mobil-homes et balades oniriques. Pour son sixième long-métrage, The Bikeriders (avec Jodie Comer, Tom Hardy et Austin Butler), le voilà pour la première fois loin de son Sud natal, aux prises avec un gang de motards dans les années 60. Rupture ou continuité avec le reste de son œuvre ? Voici la retranscription de la masterclass que Jeff Nichols nous a accordée, en public au Max Linder, lors de son passage à Paris.
Par Axel Cadieux.
Cet entretien a été réalisé dans le cadre d’une collaboration entre SoFilm et Mediawan. La masterclass peut être visionnée en intégralité sur le service de streaming Explore.
The Bikeriders s’inspire d’un roman photo des années 60 de Danny Lyon. Comment passe-t-on d’un tel objet, non-narratif, à un scénario de cinéma ?
Ça n’a pas été facile. Le livre de Danny Lyon m’est apparu comme une boîte à outils me permettant de comprendre tous les détails de ce monde auquel j’étais étranger – leurs habits, leur langage. Ce qui a été très important, c’est les enregistrements audios des interviews qu’il a faites. Je les écoutais en boucle dans ma voiture. Encore aujourd’hui, j’ai du mal à distinguer les répliques que j’ai écrites de celles tirées de ces enregistrements, tellement elles font partie de moi. Mais j’avais quand même besoin d’une intrigue. Pour cette raison, toute la première heure n’a pas vraiment d’histoire élaborée, elle sert à planter le décor et à introduire cette sous-culture. Ensuite, on bifurque vers une narration plus traditionnelle, avec notamment le triangle amoureux entre Benny, Johnny et Kathy. Là, ça s’est décoincé.
Vous avez une technique d’écriture assez spéciale, qui consiste à écrire les scènes sur des post-it, afin de composer une sorte de puzzle. Est-ce que ça a été encore le cas ici ?
Non, j’ai tout changé. En temps normal, mon seul moyen de visualiser un film dans son entièreté, c’est de le fragmenter sur des notes, des cartes, des post-it… J’ai un tableau en liège dans mon bureau sur lequel je place toutes ces pièces de puzzle. Ici, du fait de la première heure assez spéciale, j’ai écrit de manière plus libre, au fil de l’eau ; ce qui s’apparentait à faire du vélo avec des petites roues. La première scène qui m’est venue est celle de la rencontre entre Benny et Kathy. 90% des dialogues du film sont tirés de l’histoire vraie de cette femme. C’est seulement à l’issue de cette scène que j’ai pu en écrire une autre, puis une autre… Je ne savais jamais quelle serait la suivante.
Vous avez grandi au cœur de l’Arkansas, dans un contexte proche de celui qu’on découvre dans vos premiers films, Shotgun Stories ou Take Shelter. Diriez-vous que la tendresse que l’on retrouve dans vos films, vis-à-vis de personnages parfois marginaux, vient de votre enfance ?
Mon père tenait un magasin de meubles à Little Rock. Je connais ce milieu de manière intime. Je ne sais pas si c’est pour cette raison, mais je suis particulièrement intéressé par les gens qui appartiennent à la classe ouvrière, qui viennent de milieux populaires. Danny Lyon a dit en interview qu’il faut aimer ses personnages, pour qu’ils existent en retour. Je crois que j’aime mes personnages. Je me soucie profondément d’eux.
Au sortir de l’adolescence, vous suivez une école de cinéma à la University of North Carolina School of the Arts. Est-ce là que vous avez forgé votre cinéphilie ?
J’ai été élevé simultanément par le cinéma hollywoodien traditionnel, et par des films plus indépendants comme Sling Blade, Mystery Train ou Pulp Fiction. Ces films-là se sont frayés un chemin jusqu’en Arkansas, et ça a immédiatement ouvert quelque chose dans mon esprit. Ensuite, en arrivant à l’université, deux événements marquants ont eu lieu : d’abord, j’ai vu La Balade sauvage. Je me souviens d’avoir appelé mon frère juste après la projection : « J’ai vu ce film, wow… » Je ne savais pas qu’on pouvait faire du cinéma comme ça. L’impact a été considérable. Ensuite, l’un de mes professeurs m’a fait découvrir la littérature contemporaine du Sud : Larry Brown, Harry Crews… J’avais déjà lu Flannery O’Connor, je ne comprenais pas encore très bien William Faulkner, mais je suis allé plus loin avec Brown et Crews. Cette combinaison a vraiment forgé les bases de mon cinéma.

Vous évoquiez ce jeune cinéma indépendant américain des années 90. Avez-vous essayé de vous inscrire dans cette lignée ?
Pas du tout. Lorsque j’étais à l’université, il y avait en effet une tendance aux films bricolés, faits maison, façon Clerks ou Slacker. Je n’avais pas envie de ça. J’ai très vite rencontré David Gordon Green, aujourd’hui cinéaste, et on avait tous les deux envie de faire des films qui soient beaux et ambitieux, type La Ligne rouge ou Lawrence d’Arabie. On pensait qu’il était possible de faire un cinéma indépendant qui aurait de l’ampleur, à la fois visuelle et émotionnelle.
Dès Shotgun Stories, vous faites ce choix très singulier d’ellipser une bagarre mortelle. Vous utilisez le même procédé avec The Bikeriders, en coupant juste avant un coup de pelle contre un crâne. Éprouvez-vous une certaine réticence à aborder la violence de manière frontale ?
Dans Shotgun Stories, la raison première c’est qu’on avait peu de moyens et encore moins de temps. Mais j’aimais l’idée de montrer une violence maladroite, avec des personnages qui ne savent pas donner un coup de poing, par exemple. Il y a une dimension absurde. Pour The Bikeriders, c’est différent. Il y a dans le film deux formes de violences bien distinctes : dans la première moitié, elle est presque romantique, légère… Dans la deuxième, au contraire, elle devient beaucoup plus cruelle, menaçante et dangereuse. Au début, la violence est chorégraphiée. Ensuite, elle est âpre : il y a un coup de feu, un personnage meurt. Period. Ça correspond à l’évolution de l’époque et des personnages.
Loving, c’est une histoire d’amour sans aucune scène de sexe. Les évitez-vous lors de l’écriture ? Vous définiriez-vous comme un cinéaste pudique ?
Je suis Américain (rires) ! J’ai eu un professeur à l’université, un vrai con (rires), qui était aussi un mentor. Un jour, il m’a dit : « Jeff, tu ne feras jamais de bons films tant que ta mère sera vivante, car ça t’empêche de filmer des scènes de sexe. » Ma mère est toujours vivante (rires) ! Au-delà de Loving, pour The Bikeriders, le studio m’a fait remarquer qu’il n’y avait pas un seul baiser entre Austin et Jodie. Je ne m’en étais même pas rendu compte. Mais c’est vrai que, pour moi, la scène la plus sensuelle de The Bikeriders est celle qui se déroule entre Tom Hardy et Austin Butler… En ce qui concerne Loving, je crois que j’avais trop de respect pour Mildred et Richard pour les filmer en plein acte. Ça ne me semblait absolument pas nécessaire. Je suis peut-être un cinéaste pudique, c’est vrai. Souvenez-vous que ma mère est toujours en vie (rires) !
Je repense au carton de fin de Loving, quand on apprend la mort de Richard, des années après la fin du récit. Ce carton cite Mildred : « Il me manque. Il prenait soin de moi. » Il y a, là encore, une forme de retenue dans les termes employés qui caractérise bien votre approche des sentiments…
Dans Shotgun Stories, le personnage de Michael Shannon est blessé par balles dans le dos, et on ne sait pas comment c’est arrivé. Dans les premières versions du scénario, le personnage l’expliquait. Juste avant de tourner j’ai effacé ce passage, qui ne me paraissait pas du tout naturel. Le personnage n’aurait jamais raconté une telle histoire. C’est une leçon que j’ai retenue, dans ma manière d’approcher le récit et l’émotion : si je dois expliquer les choses via un dialogue, c’est que j’ai mal fait mon travail. Je suis convaincu que la narration peut passer par autre chose pour émouvoir. Dans Loving, ce carton me bouleverse complètement. La phrase m’a poussé à imaginer cette scène où il est assis au bord du lit, complètement saoul. Il dit à sa femme qu’il peut prendre soin d’elle, qu’il en est capable. En réalité, il sait qu’il en est incapable. Il le dit en dépit de tout. Je suis ému rien qu’en y repensant.

Il existe une théorie selon laquelle une grande mise en scène, c’est une mise en scène qui ne se voit pas. Êtes-vous d’accord ? Tendez-vous vers l’épure, le plus grand classicisme ?
Oui. En tant que cinéaste, je crois qu’un mouvement de caméra non justifié est inacceptable. Chaque mouvement doit faire sens. Dans Loving, lorsque Richard demande la main de sa fiancée, il y a ce plan où la caméra se rapproche lentement du visage de Mildred. Ici, on peut débattre. Ça pourrait paraitre gratuit, mais en termes d’émotions, ça se justifie totalement. Lorsque j’ai commencé à écrire Take Shelter, on avait très peu de temps et de moyens. Je regardais Shining pour me préparer et il y a cette scène, avec un léger travelling avant vers le dos de Jack Nicholson. Au début, je ne comprenais pas. Puis ça m’est apparu : c’est l’esprit de l’Overlook Hotel qui envahit peu à peu le personnage. J’ai volé ce plan pour Take Shelter. Même chose pour le plan d’ouverture de Rosemary’s Baby : un plan d’hélico, qui s’approche d’un immeuble. Gratuit, banal ? Non. C’est le diable qui atterrit sur le toit de l’immeuble. C’est si intelligent !
Toujours en termes de procédés de mise en scène, dans Loving vous commencez de nombreuses scènes avec une fleur ou une feuille en amorce. C’est très singulier…
Le but de ces plans, c’est de montrer que le personnage de Mildred est lié à la nature. Quand elle est arrachée à cette nature, qu’elle est emmenée de force en ville, il y a quelque chose qui meurt en elle et qui ne renaîtra que lorsqu’elle y retournera. Ces plans ont pour vocation de tisser la nature, de la lier à l’intrigue.
Dans Take Shelter, Curtis est la manifestation d’un homme qui ne parvient plus à être au niveau de ce que la société attend de lui, en tant qu’homme et père de famille. Quel rapport entretenez-vous avec cette masculinité ? Dans la plupart de vos films, vous semblez en pointer les biais…
Dans mes cinq premiers films, je crois en effet m’intéresser à la masculinité et à la responsabilité que ça implique dans notre société : on porte le fardeau de la protection, qu’on le fasse bien ou mal. Ma femme est bien meilleure que moi à cela, par exemple, donc c’est absurde mais ça reste une responsabilité que je ressens. Dans The Bikeriders, l’approche est différente. C’est le premier film que je fais où les personnages ne se soucient pas de leur famille. Ils en préfèrent une fausse, leur gang. Cette vision s’éloigne totalement de mon mode de fonctionnement. Il y a beaucoup à dire sur la masculinité de ces motards.

Michael Shannon joue dans tous vos films. Comment dirige-t-on un acteur de ce type, et en retour, vous a-t-il aussi appris à diriger ?
À 100% ! Il m’a appris à diriger, point final. J’ai réalisé que sur mes tournages, tout le monde est toujours très concentré ; et cette concentration vient directement de Shannon, car il est intimidant. J’ai aussi appris grâce à lui que mes acteurs sont toujours plus intelligents que moi. Il ne faut pas essayer de les manipuler. Si j’ai un changement à faire, je dois le lui exposer de manière très pragmatique et directe : « C’est ce que j’ai écrit et ce à quoi j’ai pensé en le faisant. Voici mon objectif et la manière dont tu pourrais m’aider à l’atteindre. » Il faut jouer franc-jeu. Et parfois, ça marche dans l’autre sens. Michael, ou un autre acteur bien sûr, peut proposer une chose à laquelle je n’avais pas pensé et tout éclairer. Il y a une scène dans The Bikeriders, près du feu de camp, où le personnage de Michael Shannon raconte qu’il n’a pas réussi le test pour partir au Vietnam. Avant qu’on ne filme, il vient me voir et me dit : « Nichols, tu le trouves bien ce monologue ? » Pour moi, il l’était. Pas pour lui. J’ai dit : « Ok, montre-moi alors. » On commence, et tous les autres acteurs sont hypnotisés. Il les fait rire, comme prévu, la scène devait être comique ; et d’un seul coup il les scotche en évoquant la manière dont il n’a pas été désiré par l’armée. À ce moment, les sourires s’effacent. Michael Shannon a pris un monologue que j’ai écrit, que je pensais avoir compris, et en a fait la base permettant de comprendre la psychologie du gang. Tout ça, la première semaine de tournage ! Il a placé la barre très haut. Je ne serais pas là où j’en suis sans son exigence.
Diriez-vous que The Bikeriders ouvre un nouveau chapitre dans votre filmographie ?
Je ne sais pas si c’est un nouveau chapitre. Il y a une émotion particulière dans ce film, que j’apprécie énormément, mais qui ne représente pas réellement qui je suis. Je ne m’identifie pas aux personnages masculins du film, je m’identifie à Kathy. Quand j’ai proposé le film à Tom Hardy, il m’a demandé s’il pouvait jouer Kathy (rires), et j’ai parfaitement compris ce qu’il voulait dire. Elle a cette humanité qui me parle, quand les personnages d’Austin Butler et de Tom Hardy, eux, me passent au travers. Je suis quand même fier de The Bikeriders, mais l’émotion n’y est pas aussi personnelle que dans mes autres films. Dans le futur, j’établirai des connexions plus frontales avec mes personnages.
Le service de streaming Explore est disponible chez Free, Orange, Amazon prime video channels et Apple TV+.