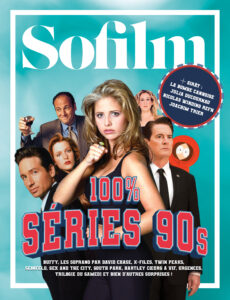Nader Saeivar : « En Iran, il suffit de protester contre un embouteillage pour être catalogué comme opposant politique »
Avec un troisième long métrage qui s’attèle, plan par plan, à mettre au jour la violence acharnée du régime iranien, dont la mécanique se voit lentement enrayée par le courage de femmes qui lui opposent gestes, parole et liberté, Nader Saeivar assoit un cinéma irrigué par le réel. Brillant objet formel autant que bouleversant manifeste, La Femme qui en savait trop (en salles le 27 août) était présenté en avant-première au FEMA La Rochelle, où nous avons rencontré le cinéaste.
Propos recueillis par Laura Pertuy.
La Femme qui en savait trop s’appuie sur un scénario de Jafar Panahi. À quoi ressemble votre collaboration et qu’est-ce qui, en tant que réalisateur, vous anime dans son écriture ?
Jafar Panahi a toujours été, pour nous tous, un grand réalisateur indépendant, courageux et intransigeant face à la censure. Je regarde ses films depuis mes débuts au cinéma. En 2016, j’ai eu la chance de le rencontrer lors de la préparation de Trois visages et j’ai pu l’accompagner de la phase d’écriture jusqu’aux dernières étapes du montage.
Ma perception de la forme cinématographique a profondément changé à ses côtés : j’ai compris que Panahi est non seulement remarquable pour l’audace de ses idées, mais aussi pour la forme unique de ses films. C’est pourquoi je lui avais demandé d’accompagner mon premier long métrage (Namo, 2020), ce qu’il avait généreusement accepté.
En général, je développe plusieurs idées inspirées de l’actualité sociale iranienne, en y mêlant toujours mes préoccupations personnelles. Quand l’une de ces propositions retient l’attention de Panahi, alors le travail sur le scénario commence, processus qui dure souvent de huit mois à un an. Le scénario de La femme qui en savait trop est une réaction artistique aux événements actuels ; la plupart des personnages sont inspirés de personnes réelles, et la majorité des situations sont des reconstitutions d’événements authentiques. Il était essentiel pour nous de documenter cette tranche de notre histoire que le pouvoir souhaite effacer, de peur de fragiliser les fondements de son autoritarisme, car il a commis des atrocités qu’il craignait de voir dévoilées.
Le film joue beaucoup sur les rapports d’échelle, sur les déplacements dans l’espace, sur la place qu’occupent les personnages par rapport à la personne avec laquelle ils s’entretiennent. Quels motifs vous intéressaient le plus à la mise en scène ?
Chez moi, le style naît du contenu : si l’intrigue tourne en boucle autour de la quête de vérité ou de justice, le cadrage adopte, lui aussi, une structure circulaire. La caméra semble perdue, tournant sur elle-même, jusqu’au moment où le personnage décide d’agir. De là, les plans et les mouvements de caméra deviennent linéaires, et se dirigent vers l’avant ou vers l’arrière. Ces choix sont soigneusement préparés ; je passe des heures à en discuter avec Jafar Panahi. Qui raconte l’histoire et à travers quel regard suit-on les événements ? Sommes-nous omniscients ou limités à la perspective d’un personnage ? Ce travail préparatoire est crucial pour éviter que le film ne devienne confus formellement ou chaotique en termes esthétiques.
On pénètre dans le film en s’accrochant au regard de Tarlan, cette femme en lutte qui va nous guider tout du long, malgré les tentatives d’intimidation répétées que lui opposent plusieurs hommes de son entourage. Parlez-nous du travail de préparation des actrices et acteurs au regard de ces altercations qui peuvent être relativement violentes.
Beaucoup des moments les plus forts – souvent invisibles dans les dialogues écrits – émergent des silences, et je ne peux les découvrir qu’en répétition avec les actrices et acteurs. Ce temps de préparation leur permet aussi de s’approprier pleinement leur rôle et d’en saisir la complexité. Par ailleurs, mes films ayant un fort ancrage réaliste, les actrices et acteurs n’éprouvent aucune difficulté à comprendre la situation car ils ont déjà vécu des expériences similaires. C’est le cas de Maryam Boubani, qui incarne Tarlan ; elle a subi plusieurs interrogatoires par des officiers de la police secrète dans sa vie et, lors du tournage, elle a apporté des idées de jeu et de dialogues inspirés de ces moments.
Ce qu’un public européen pourrait voir comme une scène « forte » s’appuie malheureusement sur le quotidien de beaucoup d’Iraniens, et surtout d’Iraniennes : interrogatoires, tensions et stress sont devenus la norme. En Iran, il suffit parfois de protester contre un panneau public, contre la pollution ou un embouteillage pour être catalogué comme opposant politique ou comme espion occidental accusé de vouloir renverser le régime.
Maryam Boubani, l’actrice principale, est aussi l’une des figures du mouvement « Femme, Vie, Liberté ». Comment avez-vous travaillé avec elle sur ce rôle qui puise dans son engagement politique ? Nous avons choisi Maryam Boubani précisément pour son engagement politique. Elle avait entamé sa propre « révolution » deux ans avant le film, renonçant au hijab et devenant, aux côtés d’autres actrices, un symbole de résistance. Elle a accepté le rôle pour la confiance qu’elle avait en moi ainsi qu’en Jafar Panahi et a refusé de nombreux rôles simplement parce qu’on lui demandait de porter le hijab, ce qu’elle continue à refuser. Je tiens à dire que Maryam Boubani est l’une des artistes les plus intègres d’Iran et c’est un honneur pour moi d’avoir pu travailler avec elle. Elle a immédiatement saisi le personnage de Tarlan, qu’elle sentait profondément lié à sa propre histoire. Son combat personnel contre l’oppression résonne avec l’action de Tarlan pour défendre Zara. Pour nous deux, la réalisation de ce film a été une véritable thérapie.
« Mon actrice principale a subi plusieurs interrogatoires par des officiers de la police secrète dans sa vie »
La danse et le chant occupent une place particulière dans le film ; ce sont des arts qui donnent lieu à des scènes empreintes d’une atmosphère poétique, qui tiennent presque du songe. Comment les avez-vous travaillées avec votre équipe ?
La danse a joué un rôle majeur lors de la révolution iranienne d’il y a trois ans ; c’est la manifestation concrète du mouvement Mahsa Amini. J’ai travaillé avec un excellent chorégraphe pour concevoir ces séquences. Les danses devaient allier tendresse, poésie et aussi représenter les différents groupes ethniques iraniens : l’Iran est composé de plusieurs peuples aux langues et cultures distinctes, et voyager à travers le pays revient à traverser plusieurs pays. Nous voulions que la danse réunisse ces ethnies dans une même scène, avec grâce et beauté, en écho à la posture finale du film : la douceur et la beauté de la vie opposées à la violence des régimes autoritaires.
Vous tissez une filiation éminemment frondeuse entre Tarlan, Rana et Ghazal, qui représentent chacune une génération différente. En quoi était-il important pour vous que l’héroïne soit une femme âgée ?
Le combat pour la liberté des femmes en Iran a une longue histoire. Il a débuté discrètement il y a 200 ans, et s’est manifesté plus ouvertement lors de la révolution populaire de 1978. Malheureusement, l’essence même de cette révolution, en raison de sa forte dépendance à l’idéologie islamique, s’est opposée à ce mouvement de libération des femmes et a été sévèrement réprimée. La grande marche des femmes a été réduite en poussière et en sang, et les femmes ont été étouffées. Mais le souvenir de cette lutte est resté vivant dans l’esprit des Iraniennes. Pendant la guerre de huit ans entre Iran et Irak, le régime autoritaire a trouvé un prétexte pour intensifier la répression, notamment à l’encontre des femmes de la génération suivante. Cependant, avec l’émergence récente des plateformes d’expression telles que Facebook et Instagram, la répression systématique est devenue plus difficile à maintenir. Pour réaliser un film sur la révolution actuelle des femmes en Iran, il serait injuste de passer sous silence ses racines historiques. Nous avons donc mis en scène trois générations : Tarlan est issue de la génération qui a été réprimée après la révolution de 1978, Zara appartient à la génération intermédiaire, qui n’a jamais pu exprimer ses idées et ses aspirations, tandis que Ghazal symbolise la génération actuelle que le régime ne parvient pas à réduire au silence.
La Femme qui en savait trop, en salles le 27 août.