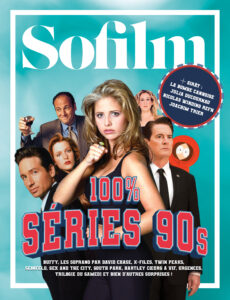La vie après Siham de Namir Abdel Messeeh
Par Alfred Sebald
« Papa, tu fais chier à tout filmer tout le temps ! » L’invective, lancée par le fils excédé du réalisateur à la mi-temps de ce documentaire intimiste, marque une ellipse. L’adorable garçonnet pleurant dans le premier quart d’heure du long-métrage la mort de sa grand-mère dans les bras de son père est devenu un pré-ado grande gueule. Marre que ses moindres faits et gestes soient enregistrés par son père ! Drôle, cette courte scène répond surtout à la question que le spectateur se pose depuis le début de La vie après Siham : les plans tournés par le réalisateur pour mettre en scène sa famille sont-ils un dispositif destiné à traiter une histoire précise, ou Namir Abdel Messeeh filme-t-il compulsivement tout ce qui se présente à son regard ?
Équivalent cinématographique d’un graphomane (un filmomane ?), Namir Abdel Messeeh fait de sa vie entière tout un cinéma. En découle une impression de joyeux brouillon. Le titre a beau avancer un sujet – comment vivre après la mort de Siham, la mère du réalisateur –, le spectateur assiste surtout à une forme de dispersion scénaristique. Pêle-mêle : le rapport d’Abdel Messeeh avec le pays de ses origines ; sa relation avec le cinéma et plus particulièrement le cinéma égyptien ; ses premières années là-bas, éduqué par sa tante ; la jeunesse de ses parents ; leur rencontre et leur installation en France ; la difficile communication entre le père et le fils… Tout cela pourrait manquer de cadre et d’approfondissement. Il n’en est rien. Car le film tient solidement sur un socle – le même que celui de son précédent long-métrage, La vierge, les Coptes et moi. Il s’agit de Namir Abdel Messeeh lui-même.
Me, myself and I
Trip égotique ou volonté de capturer la grâce dans la banalité du quotidien ? Qu’importe. En la personne de son réalisateur, le documentaire travaille en fait une figure plus communément affiliée à la fiction : un héros incarné par un acteur principal. Là réside sans doute la force de ce fim qui, bien qu’avançant par à-coups inégaux, émeut parfois aux larmes et, beaucoup plus souvent, fait rire. Un timbre aigu et malicieux, omniprésent jusque dans la voix off ; un corps long et élégamment mou, mi-Jacques Tati mi-ours Baloo ; un beau visage de star de l’âge d’or hollywoodien qu’un sourire aux incisives écartées vient régulièrement illuminer : c’est aussi injuste qu’indéniable, mais devant sa propre caméra, Namir Abdel Messeeh possède la cinégénie des grands comédiens de cinéma. Namir se raconte, Namir se filme en bon père consolant ses enfants, Namir se montre en fils digne, accompagnant son père sur la tombe de sa défunte épouse, Namir surtout est drôle, très drôle, dans ses joutes tendres et caustiques avec les membres de sa famille. Sans doute est-ce pour cela, bien plus que dans une démarche de réflexion sur le médium, que le cinéaste inonde son œuvre de celles des autres – à de nombreuses reprises, des films égyptiens apparaissent à l’écran. Ses proches, aussi complexes et sympathiques soient-ils, ne sont pas toujours à la hauteur du charme de leur metteur en scène démiurge. Qu’à cela ne tienne, par un habile procédé, aussi simple que saisissant, ce dernier remplace à l’image ses parents par d’autres comédiens ; ceux, magnifiques, des films de Youssef Chahine. La magie fait effet. En communication directe avec son histoire intime et cinématographique, Namir Abdel Messeeh se permet ainsi de rejoindre l’aristocratie du 7e art à laquelle il semble aspirer. Et fait de sa frustration d’acteur raté un bien beau geste de cinéma.

La vie après Siham, en salles prochainement.