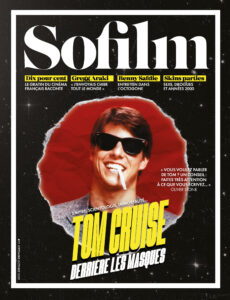Rétrospective Marcel Pagnol : partie 2
Par Emmanuel Burdeau.
« Parlez, continuez à parler… Dites n’importe quoi. Oh, c’est merveilleux, la voix humaine. » C’est dans Manon des sources (1952) qu’on entend ces mots. Le personnage qui les prononce porte un beau nom, il s’appelle Belloiseau. L’interprète de Belloiseau s’appelle quant à lui Robert Vattier, soit Monsieur Brun, l’immortel souffre-douleur de la trilogie marseillaise. Lunettes, barbichette, faux air de Denis Podalydès. Belloiseau est sourd comme un pot mais il vient de s’équiper d’un appareil qui ressemble à un magnétophone muni d’un casque et d’un micro. Voici donc que, soudain, il entend. Et sur la place du village où d’ordinaire on aime à le charrier, il s’extasie. À peine un silence s’installe-t-il que, peut-être pris d’angoisse, Belloiseau se déclare prêt à entendre n’importe quoi. Car même n’importe quoi rendrait grâce au merveilleux de la voix humaine. Celle-ci serait-elle donc moins porteuse de discours que bruit ou souffle – la vie même ?
C’est merveilleux, le cinéma de Marcel Pagnol. En revanche, ce n’est pas anodin. La ressortie d’une demi-douzaine de films par Carlotta, après la dizaine de l’an passé (la partie 1, donc), ne doit pas être considérée comme n’importe quelle reprise. « Ne pas confondre ! », dirait Cigalon, l’électrique restaurateur du film qui porte son nom. C’est un événement. On peut avoir traversé plusieurs décennies de cinéphilie sans s’être vu une seule fois offrir l’occasion de voir en salle Merlusse, Ugolin ou Le Curé de Cucugnan. Imaginons que tout Renoir refasse surface après avoir disparu. Que Guitry se soit tu avant de tout à coup recouvrer l’usage de la parole. Que Grémillon soit inconnu, et que brusquement on le découvre. Pagnol est de cette trempe. L’événement est à cette hauteur. Oubliez les cigales, le Vieux-Port et la partie de cartes : Marcel Pagnol est l’un des trois ou quatre plus grands cinéastes français « classiques ».
Pagnol, c’est la parole
Pagnol, on le sait, c’est la parole. Ses films sont des saouleries de mots, des monologues de plusieurs minutes, un verbe qui sature l’espace. Tapageuses disputes, bisbilles poursuivies sur plusieurs générations et jusqu’à pas d’heure. L’homme de Pagnol ne se contente pas de parler, il loge intégralement dans ce qu’il dit. L’écart cruel entre le corps et la voix ou entre le désir et le discours n’intéresse pas le cinéaste et écrivain. La parole, pour lui, est ce par quoi l’homme s’appartient, est absolument lui-même. Ou ne s’appartient plus, dès lors qu’il s’emporte. Sans cesser – au contraire ! – d’être lui-même. Il y a un délire chez Pagnol. Un vertige de dire : dire tout, dire trop. Une fureur de parler qui finit par épuiser le souci de dire. Le curé parle et maudit ses ouailles, le restaurateur parle et défie sa clientèle, le pion – Merlusse – parle et menace les élèves. Cela va plus loin : ça parle à travers eux. Ça dit n’importe quoi, pourvu que la voix humaine ne se taise pas. Parole personnelle, signée, avec l’accent et tout. Parole impersonnelle, aussi. Comique souvent, tragique parfois. Mystique toujours. Car à l’extase de Belloiseau répond le désespoir de Charpin en père pleurant son fils, dans un film ressorti l’an dernier, La Fille du puisatier : « Tu as entendu ce que j’ai dit ? Moi non. Je parle, je parle comme ça. J’ai l’air de parler, j’ai l’air de continuer à vivre, mais au fond ce n’est pas moi qui parle. Je suis comme une espèce de phonographe qui parle tout seul. »
Rétrospective Marcel Pagnol (partie 2),en salles le 30 Juillet.