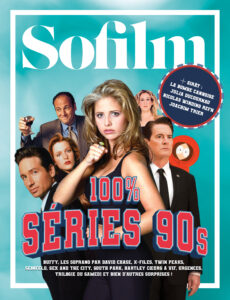Karan Kandhari (Sister Midnight) : « En Inde, vous ne pouvez pas combattre le chaos »
Uma vient d’être mariée à un homme qui fuit le domicile conjugal dès qu’il le peut. Démunie face à cette nouvelle vie d’épouse étriquée, la jeune femme s’aventure nuit après nuit dans les rues de Mumbai, laissant progressivement sa vraie nature, sauvage voire monstrueuse, se révéler… Pour son premier long-métrage, le cinéaste Karan Kandhari transgresse les codes, mixe couleurs de l’Inde et rock à l’ancienne (le titre est emprunté à Iggy Pop), et imagine pour cette très inventive comédie horrifique une héroïne peu conventionnelle, assoiffée de sang, de sexe et de liberté. Rencontre. Par Marine Bohin.
Sister Midnight est un film que l’on qualifie volontiers de punk … C’est quoi, un film punk ?
Je citerai Kurt Cobain : le punk, c’est la liberté. La liberté de remettre en question ce qui n’a pas de sens. Sister Midnight est un film assez anarchiste, donc j’imagine qu’en effet, il se rapproche d’un certain esprit punk !
Le film dynamite les traditions : l’héroïne troque les couleurs indiennes contre du noir, elle renie Dieu… Le cinéma peut être une bonne façon de bousculer les tabous de la société indienne ?
Questionner les choses est naturel chez moi. On parle ici de deux personnes (Uma et son mari, ndlr) qui ne sont pas équipées pour être adultes ou pour vivre en société, et de ce qui se passe lorsqu’une personne inadaptée cherche à aller contre les traditions. Il est également naturel chez moi d’apporter de l’humour pour interroger la société, c’est grâce à l’humour que l’humain peut transcender l’absurdité de la vie. Je ne sais pas comment le film sera reçu en Inde. Mais je ne cherche pas à transmettre un quelconque message, rien n’est plus ennuyeux que quelqu’un qui vous dit quoi ressentir ou penser.
De nombreux films parlent de la condition des femmes indiennes, de façon parfois un peu misérabiliste… Vous avez opté pour la comédie horrifique, c’était votre façon de transcender une réalité difficile ?
C’est intéressant… Mais non. Pour être honnête, je ne connais pas vraiment le cinéma indien. Je vis à Londres, le cinéma que j’adore est européen, japonais… Vous avez en effet de nombreux films indiens qui présentent une version très triste de la réalité, et le plus souvent cela s’apparente à mon sens à une sorte de poverty porn. Je préfère appréhender les personnages comme des humains, indépendamment de leur classe sociale, m’intéresser à leurs névroses… C’était mon approche.
Le personnage féminin n’est pas une victime, au contraire. Elle devient même le prédateur…
J’ai laissé de côté les considérations de genre. Quand vous écrivez, c’est le personnage qui vous guide. Uma n’a pas de manuel pour l’aider dans cette existence, alors elle devient comme une bombe à retardement. Comme un animal, tout ce qu’elle fait relève de l’instinct et de l’intuition, sa vraie nature est déjà enracinée dans son corps.
Les films de vampire étaient une inspiration ?
Je n’aime pas spécialement ça en fait. En un sens, Sister Midnight était presque une réponse à ce genre de films : quand vous regardez ceux des 30-40 dernières années, ils sont devenus très mécaniques. Alors que si vous revenez à l’original, au vampire ultime, Nosferatu, c’est en fait l’outsider parfait, il mène une existence très solitaire. Et mon film parle de cela, de la solitude : je voulais me saisir de l’archétype du marginal et le traiter comme on ne l’avait jamais vu auparavant. D’ailleurs je n’aime même pas les films d’horreur, je n’y connais rien !

L’héroïne ne trouve pas sa place au sein de la société mais en revanche, vous savez exactement comment placer vos personnages dans le cadre. Comment avez-vous composé ces plans très travaillés ?
Je storyboarde tout. J’aime les plans dans lesquels les personnages et leurs mouvements font partie intégrante de la composition de l’image. Sister Midnight est un film sur un être qui est constamment déplacé, c’est amusant de devoir « encadrer » cela, comme si le personnage était observé au travers d’un microscope. Quelqu’un comme Jacques Tati parvient très bien, grâce à ses plans larges, à montrer des personnages bringuebalés dans leur propre existence.
La direction d’acteur est aussi très particulière, les corps sont animés par une sorte d’énergie burlesque. C’était une façon de vous affranchir des dialogues, très succincts ?
Absolument. J’essaie naturellement de faire des films avec le moins de dialogues possible. Quand on regarde Jacques Tati et Buster Keaton, on voit à quel point on peut exprimer une foule de choses par le corps, sans avoir besoin de mots. De par la simple posture d’un personnage, vous pouvez comprendre ses émotions, son énergie. J’espère vraiment un jour pouvoir faire un film sans dialogue du tout !
Pourquoi avoir choisi de filmer cette histoire à Mumbai ?
Parce que c’est une ville folle, tellement pleine de vie, de chaos, de contradictions… C’est une ville très séduisante. J’aime les films dans lesquels les villes deviennent des personnages, comme New York dans Taxi Driver, Paris dans À bout de Souffle… Et comme je ne suis pas de Mumbai, je pouvais apporter le point de vue d’un étranger. Filmer là-bas était dingue, mais l’Inde étant l’une des plus grosses industries cinématographiques du monde, les équipes de tournages sont très efficaces, même si nous avons dû trouver un langage commun, car les méthodes diffèrent beaucoup du Royaume-Uni… En Inde vous ne pouvez pas combattre le chaos, vous devez l’accepter !
Il paraît que vous avez écrit le film à la main ?
En effet, je n’aime pas les ordinateurs. Alors j’écris tout à la main, puis je tape à l’ordinateur ensuite. C’est peut-être parce que je viens de l’art (il est également artiste plasticien, ndlr) que j’aime tant ce qui est manuel… D’ailleurs, tous les effets visuels du film sont des effets mécaniques. Les animaux sont des marionnettes animées en stop-motion, la lune est fausse, filmée dans un mini studio. J’aime faire les choses de façon physique, j’écoute de la musique sur vinyle, ça me permet de ralentir, aujourd’hui tout va très vite et notre concentration est en permanence éparpillée.
Le cinéma va trop vite également ?
Je pense que la façon dont on nous présente le cinéma va trop vite, oui. Évidemment en France, vous avez encore une vraie culture du cinéma, chez nous il est compliqué d’amener les gens découvrir des films indés en salles, car ils sont trop vite spoilés par le streaming. J’aimerais que les films soient toujours projetés en 35 mm !
Vous pensez déjà à la suite ?
Oui, je suis en train d’écrire un très étrange western queer que j’espère tourner aux États-Unis !

Sister Midnight, en salles le 11 juin.