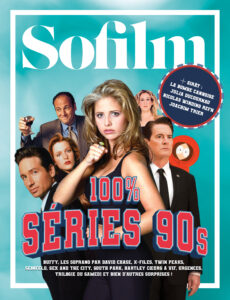Quatre nuits d’un rêveur de Robert Bresson
Par Jules Perret.
À ce niveau d’attente, ce n’est plus un film, c’est une rock star. Après une présentation à Cannes Classics 2024, sous les auspices de Paul Schrader, et un passage au Festival Lumière, voici que déboule en salles Quatre nuits d’un rêveur de Robert Bresson. Invisible depuis plus de dix ans suite à un conflit avec les ayants droit italiens, le film, enfin arraché à ses geôliers, a bénéficié d’un travail de restauration exceptionnel. Difficile de ne pas commencer par saluer le travail accompli par les équipes d’Éclair. Le deuxième film en couleur de Bresson brille désormais de mille feux, aussi grâce à la photographie de Pierre Lhomme (L’Armée des ombres, La Maman et la Putain, Le Sauvage…), qui retrouve tout son éclat. Unique association entre les deux artistes, le film touche à la pureté dans des scènes de nuit où leurs talents se conjuguent divinement, rappelant la symbiose Ingmar Bergman/Sven Nykvist que les Scandinaves auront, eux, poussée sur une quinzaine de films.
Et le style bressonien de se déployer
Elles sont ainsi quatre, ces nuits, au cours desquelles Jacques, un jeune peintre, rencontre Marthe. Ils échangent et, peut-être, tombent amoureux, alors que Paris tourbillonne autour d’eux. Bresson commence par filmer cela : la grande ville, bruyante, pressée, moderne, qui écrase et étouffe. Pour la dompter, Jacques en fait le décor de sa quête, celle de l’amour qu’il n’envisage qu’avec la femme parfaite, que jamais il ne rencontre. Alors il la peint, cette vision qu’il pourchasse, laissant son vague à l’âme guider sa main et son pinceau. Jacques ne structure ni son travail, ni sa pensée, ni lui-même : il entame tout mais ne finit rien, de son petit-déjeuner à ses toiles, de son évasion à ses déambulations, jusqu’à ce qu’il tombe donc sur Marthe, archange tombé du ciel (il le dit lui-même), que Bresson dessine en statue pieuse : cache-cœur boutonné, cheveux tirés, mine froide comme le marbre.
Tout le style bressonien, qu’on aime tant à qualifier d’austère et d’âpre, se déploie alors. Le film peut paraître rugueux : on déclame plus qu’on ne joue, on existe plus qu’on n’interprète, dans la droite lignée des enseignements des Réflexions sur le cinématographe du même Bresson. Alors oui, les sujets (les comédiens) sont et ne jouent pas, parfois dans un décalage étonnant. Mais l’essentiel n’est pas là. L’essentiel est dans la couleur, encore ; dans cette péniche qui traverse la scène comme la barque de Charon glisse sur le Styx ; dans ces groupes de musique qu’on regarde jouer. Il y a quelque chose de rare dans la filmographie du cinéaste, une vie différente, moins théorique, plus spontanée ; celle que visent les deux personnages. Mais comme tout doit finir mal, comme dans la nouvelle de Dostoïevski adaptée ici, Marthe s’éloigne de Jacques. Ne restera de cette idylle qu’une étoffe rouge qu’il lui aura offerte, et qu’il peindra – ou qu’il a déjà peinte ? –, figeant l’espoir de prendre la tangente de cette vi(ll)e. Quatre nuits d’un rêveur se dévoile alors pour ce qu’il est : un film magnifique sur la quête ; et sur la perte.
Quatre nuits d’un rêveur en salles le 19 février.