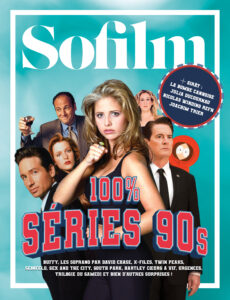Thomas Ngijol : « Ma colère, elle est là depuis des années »
Adaptant librement un documentaire de Mosco Levi Boucault (Un crime à Abidjan, 1997), Thomas Ngijol s’éloigne du registre comique auquel il nous avait habitué : Indomptables est un polar ultraréaliste, tourné entièrement au Cameroun. Le pari est plus que réussi, et le film sélectionné à la Quinzaine des cinéastes, à Cannes. Propos recueillis par Pierre Charpilloz
Le documentaire original se déroulait en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Indomptables se passe à Yaoundé, au Cameroun, le pays d’origine de vos parents. Vous en faites un portrait très violent, en montrant une société patriarcale rongée par la corruption…
Je ne sais pas si je fais un portrait « violent » du Cameroun. C’est certain que beaucoup d’enfants d’immigrés ont tendance à sacraliser le pays d’origine. De mon côté, je ne le sacralise pas, parce que je le connais depuis que je suis tout petit. J’y vais régulièrement. C’est un pays que j’apprécie, mais je sais être lucide. Je ne fantasme pas l’Afrique.
Vous souhaitiez faire un film sur le Cameroun ?
Disons que je ne projetais pas cette histoire en France, parce qu’elle allait avoir une résonance sociale complètement différente. On aurait parlé d’immigration, ce qui n’est pas le sujet du film. Et j’avais envie de parler de mes parents, de mon père. Je voulais me mettre à sa place, et donc chez lui. Et puis, c’est notre pays d’origine. Mes parents ne l’ont pas quitté, en fait. C’est comme des provinciaux qui seraient venus travailler à Paris. Moi, c’est mon pays, ce n’est même pas à discuter. Ce qui n’est pas du tout en opposition à mon identité et ma nationalité française. J’ai connu le Cameroun depuis l’âge de 5 ans, Tous mes frères sont nés là-bas, et mon père avait un métier qui nous permettait de faire pas mal d’allers-retours..
Le personnage que vous interprétez est complexe, torturé, en particulier dans sa relation à ses enfants. Il est pétri de bonnes intentions, mais aussi de préjugés…
J’avais envie que chacun se fasse son idée ; mais pour moi, ce n’est pas un personnage mauvais. Il appartient à cette génération de mecs comme nos parents, qui ont vécu beaucoup de choses. Avec tout ce qu’on connaît du passé de l’Afrique, de ses douleurs, de ses blessures qui ne sont pas guéries ou reconnues, ça crée des gens complexes. La violence, c’est la fin d’un chemin, mais pour la comprendre, il faut voir le background : comment ces hommes ont-ils grandi ?
Il y a une forte dimension réaliste ; et en même temps c’est un polar sombre, nocturne, dans une certaine tradition cinématographique…
Le grand public me connaît plus pour la comédie, les spectacles, mais en vrai je regarde bien plus de polars que n’importe quel autre genre de films. Je regarde très peu de comédies, en fait ! Après, je ne voulais surtout pas faire un truc fantasmé, façon flic ténébreux ou Clint Eastwood à Yaoundé.

On retrouve les traces du documentaire dont c’est adapté ?
Totalement. C’est un film que j’ai vu il y a longtemps, mais qui m’a profondément marqué, parce qu’il m’a rendu moins solitaire dans mon rapport à mon père. Quand j’ai vu ce mec-là, je me suis dit : tiens, en fait, papa, il n’est pas tout seul. Ils sont peut-être des millions comme ça, avec cette mentalité hyper pragmatique. Il faut avoir de l’amour pour ces gens-là, parce que malgré tout, ils ont fait avec les armes d’une époque. Maintenant, nous, notre travail, c’est d’avancer, de briser certains schémas qui sont castrateurs, négatifs. Mais il faut le faire avec humilité, avec une certaine tendresse, parce que moi, ces gens-là, je les aime. Ce sont eux qui m’ont élevé, qui m’ont donné beaucoup d’amour avec toute leur maladresse.
Vous n’avez pas peur de la réaction du public qui n’est pas habitué à vous voir dans des rôles « sérieux » ?
Non, je ne m’en fais pas. Ce n’est pas comme si j’étais un clown, je ne me force jamais à rigoler dans la vie. Je n’ai pas eu l’impression de faire un film plus « auteur », au final. J’ai fait un film plus intime que les précédents, ça c’est sûr. Et le côté dark, il est en moi, même si pendant longtemps, je n’ai pas osé le montrer. Ma colère, elle est là depuis des années.
Et convaincre des producteurs que vous, Thomas Ngijol, alliez faire un polar sérieux et réaliste au Cameroun, c’était simple ?
Honnêtement, non. Pour la plupart, c’était dur à comprendre. On m’a dit que c’était trop violent. Mais heureusement, Pascal Caucheteux (de Why Not Production, ndlr) a compris que ce qui m’intéressait, c’était l’intime. On n’allait pas faire Bad Lieutenant en Afrique – même si j’adore Bad Lieutenant. Mais un méchant flic qui bute un mec à la fin, je pense qu’on n’a pas besoin de ça sur le continent, actuellement. Je n’avais pas envie d’un film ultrastylisé ou à la violence cynique. Il n’y a pas de place pour ça en Afrique.
Prendre l’accent camerounais, c’était un défi ?
C’était dur, parce qu’autant prendre l’accent pour un spectacle, il n’y a pas de pression, c’est facile. Mais là, quand tu es entouré de Camerounais, au Cameroun, c’est autre chose. On apprend l’humilité. Parfois, sur certaines répliques, j’entendais Thomas de Maisons-Alfort et pas le commissaire Billong de Yaoundé. Il a fallu pas mal travailler, mais en même temps, c’est venu naturellement. Je me suis dit : ne réfléchis pas trop. Vis. Tu es là, tu es dans ton pays, celui de tes grands-parents, de tes ancêtres. Fonce. C’était un tournage très court, mais intense.
Comment avez-vous trouvé les comédiens qui vous entourent ?
Par un casting classique, au Cameroun. Thérèse Ngono, qui joue ma femme dans le film, je l’avais vue dans une fiction camerounaise. Je me suis dit, elle a un truc. Bien sûr, là-bas, ce n’est pas la même industrie. Elle n’avait pas eu l’occasion d’affirmer tout son potentiel. Ce qui est particulier quand j’ai rencontré ces acteurs camerounais, c’est qu’ils étaient souvent très introvertis, limite impressionnés, parce que quand tu viens de France, tu représentes autre chose. Mais je leur ai dit d’arrêter tout de suite. Je ne suis pas venu leur apprendre leur métier, on est au même niveau.
Vous auriez envie de faire d’autres films au Cameroun ?
Évidemment. En Afrique, au Cameroun, en France… La seule chose qui m’intéresse c’est les émotions, en fait. C’est marrant, parce que je suis très consommateur de foot ; mais mon équipe, qu’elle perde ou qu’elle gagne, je m’en fous. Ce que je cherche, c’est le frisson.

Ce qui explique le titre du film, qui rappelle les « Lions indomptables », le surnom de l’équipe national du Cameroun ?
Il y a de ça, et il y a la mentalité des personnages. Le film aurait pu s’appeler « Les Têtus » !
Dans ce cas-là, ça aurait été une comédie !
Effectivement ! Ce n’est pas vraiment un film de rupture par rapport à mes comédies, ce n’est pas le « film de la maturité », même s’il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c’était un film viscéral, en tout cas. J’ai refusé des choses pour faire ce film, parce que j’avais besoin de le faire à ce moment-là de ma vie.
Vous êtes père vous-même. Vous auriez pu faire le film si vous n’aviez pas eu d’enfants ?
Non. Si je n’étais pas père, j’aurais fait la version comique.
Indomptables, en salles le 11 juin.