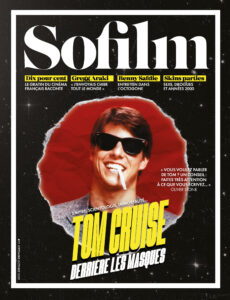La Forteresse noire de Michael Mann
Par Yohann Chanoir.
Qui se souvient que Michael Mann a connu un jour les affres du docteur Frankenstein ? Qui se souvient de ce film avec une créature maléfique inspirée en partie par l’horreur gothique de la Hammer ? Mais plus qu’un titre maudit, La Forteresse noire est davantage une création qui a échappé à son créateur. La mort soudaine du responsable des effets spéciaux Wally Veevers a obligé en effet le réalisateur à tourner de nouvelles prises mais aussi à imaginer une autre fin que celle prévue. Peu satisfait du résultat obtenu, Mann a décidé d’oublier son œuvre. Quasi-introuvable, La Forteresse noire avait tout d’un objet mort-né.
Un film de guerre qui tourne au film de genre
L’action se passe en Roumanie en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Les premiers plans rappellent un film de la Hammer. On découvre une forêt sombre, puis une route mal carrossée sur laquelle cheminent des soldats allemands. Ils parviennent à un village isolé dans les Carpates roumaines. Les habitants sont évidemment hostiles et mutiques. La mystérieuse place-forte noire qui écrase le hameau nourrit très vite une sensation de malaise. D’autant que les nombreux avertissements du gardien des lieux ne sont pas écoutés et que les soldats allemands s’installent malgré tout dans la forteresse. L’Histoire est davantage un prétexte qu’un contexte. On notera l’allusion erronée à la Shoah, en 1941, la conférence de Wannsee n’a pas encore eu lieu et les centres de mise à mort industrielle n’existent donc pas. Mais il existe bel et bien un autre mouroir, la forteresse. Le fait que celle-ci soit construite « à l’envers », manifestement bâtie pour empêcher quelqu’un (ou quelque chose) d’en sortir, plus que pour dissuader des personnes d’y rentrer n’inquiète pas le commandant de l’unité (interprété par un très bon Jurgen Prochnow). Or, dès la première nuit, un soldat disparaît. Chaque nuit, ensuite, voit la mort d’autres militaires. L’hécatombe, attribuée à des partisans, entraîne l’intervention d’une escouade SS. Dès la mort de la première victime, Mann abandonne les références à la Hammer pour s’inscrire dans le fantastique, symbolisé et incarné par un lieu : la forteresse.

Une forteresse et un village
Comme le titre le suggère, le vrai personnage, c’est la forteresse. Une construction étonnante et imposante qui barre le paysage. Elle est le lieu central de l’action. Tous les arcs narratifs en outre convergent vers elle. Elle attire les différents personnages, aussi bien un officier SS joué par Gabriel Byrne qu’un universitaire et sa fille ou qu’un mystérieux voyageur incarné par Scott Glenn. Ses couleurs froides, son aspect minéral, ses éléments tournés vers le dedans et non vers le dehors composent une signature visuelle atypique d’une place-forte médiévale. Il y a là un vrai travail de création qui montre tout le talent d’un jeune réalisateur associé à l’expérience d’un décorateur plus âgé (John Box). Cette construction monumentale d’une rare noirceur s’oppose au village d’une blancheur éclatante. Comme dans les films de la Hammer, il n’y a pas de château sans habitations peuplées de villageois. Il faut d’ailleurs relever l’incroyable réalisme de ce hameau, tant dans l’architecture ou les meubles des maisons, que les vêtements et les outils de ses habitants. Ce travail de reconstitution est d’une rare historicité. On sent déjà la patte d’un réalisateur perfectionniste, qui ne laisse rien au hasard et qui veut bâtir un univers crédible.
Entre fantastique et métaphysique
La bande-son, signée par le groupe Tangerine Dream, puise tour à tour dans des thèmes dissonants ou épiques. Elle fait peu à peu glisser le film du fantastique vers une œuvre métaphysique. La Forteresse noire offre de fait une réflexion sur la nature même du mal. Car le réalisateur ne se contente pas de filmer une créature maléfique. Il met en scène les âmes tourmentées des différents personnages : soldat allemand qui ne croit pas au nazisme, nazi païen prêt à invoquer Dieu pour sauver sa vie, universitaire prêt à un pacte faustien pour assouvir sa haine des partisans du Reich. On trouve déjà ces figures ambiguës qui seront récurrentes dans la filmographie du réalisateur. Dans cette réflexion, Michael Mann force toutefois un peu le trait. L’opposition entre soldats de la Wehrmacht et membres des SS, réfutée par de nombreux travaux, est caricaturale. Mais cette vision de l’Histoire est de nouveau un prétexte. Elle permet au cinéaste d’interroger la nature même de la créature et d’en faire le produit, voire le procès, de notre propre inhumanité. Une créature dont plusieurs critiques se moqueront. C’est faire injure au travail sur le paysage final du film, une grand-salle jonchée de soldats pétrifiés et de plusieurs amalgames de corps et de de métal, enveloppés de nappes de brumes. Plus qu’une faucheuse, la créature est le forgeron du mal et de ses accessoires. De toute évidence, la Hammer n’a pas été la seule référence mobilisée par Mann. Ce décor final est digne de Lovecraft.
La version restaurée 4K par Carlotta rend hommage à ce film, porté par un casting de grande qualité. Toutefois, La Forteresse noire n’est pas qu’une simple renaissance. Il s’agit d’une (re)découverte : celle d’un acte de naissance, celui d’un grand réalisateur.

La Forteresse noire, en salles le 14 mai.