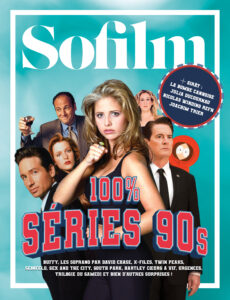Sven Bresser : « Le mal vient-il de nous ? »
Certains films sont des labyrinthes, remplis de portes donnant sur de nouvelles intrigues, des tiroirs à double-fonds et des chausse-trappes imparables. D’autres, au contraire, dessinent un motif unique, que le cinéaste, obsessionnel, revient interroger de scène en scène, comme un présage qui ne serait jamais tout à fait le même. Reedland appartient à cette dernière catégorie. Son réalisateur, le néerlandais Sven Bresser, semble n’être venu à Cannes, où le film est sélectionné à la Semaine de la Critique, que pour contaminer la Croisette de ces milliers de tiges de roseaux bruissants et inquiétants qui forment le décor énigmatique de ce premier film. Au milieu de ce paysage, Johan, coupeur de roseaux appliqué, découvre le corps inerte d’une jeune femme. Et le paysage agricole de basculer dans la peur. Par Benjamin Cataliotti.
Reedland est dédié à votre mère, laquelle, écrivez-vous dans le générique, vous a fait découvrir ces paysages. Vous n’aviez pas peur de l’effrayer en lui « offrant » un film marqué par une telle noirceur ?
J’ai grandi dans un petit village entouré de roselières, ces champs de roseaux qu’on voit dans le film. Ma mère est photographe. Une grande part de son œuvre est consacrée à ces paysages. Ses images sont donc inscrites dans ma mémoire à jamais. Ma mère m’a emmené voir les roselières quand j’étais enfant, les travailleurs la connaissaient bien. Mais depuis, ces endroits ont été détruits. C’est donc devenu important pour moi, par la suite, de travailler ces motifs disparus.
Quitte à les envelopper par les ténèbres ?
Oui, j’aurais du mal à vous expliquer pourquoi, mais je voulais les relier à la violence masculine. Quelque chose qui est aussi très important pour ma mère.
De fait, l’ouverture du film est très picturale, avec cet homme coupant et brûlant des roseaux au coucher du soleil. Est-ce la première image que vous aviez en tête ?
J’ai toujours eu une ou deux images en tête. La première, c’était ce rideau de roseaux, derrière lequel on verrait un homme, sans savoir s’il s’y cache ou s’il cherche à nous avertir d’un danger. L’autre image était assez semblable : celle du même homme, travaillant dans la roselière et sentant une présence inquiétante derrière son épaule. De la menace qu’il ressent, d’autres images ont peu à peu commencé à émerger.
L’intrigue policière se mêle à des plans très documentaires…
L’aspect polar n’est pas arrivé tout de suite. Une influence majeure, pour moi, c’est la notion de « paysage coupable », inspirée par le poète et artiste néerlandais post-Seconde Guerre mondiale Armando. C’était sa façon à lui d’évoquer les souffrances humaines. Cette idée d’un paysage coupable a changé ma façon de regarder ces endroits avec lesquels j’avais grandi. En les observant avec cet œil poétique, j’ai senti la violence qui pouvait y poindre.
Dans votre film, la peur ou l’inquiétude agissent comme des couleurs sur un tableau.
Oui, je n’arrêtais pas de me demander : comment rendre un paysage « coupable » ? Un paysage, ça n’est pas maléfique par essence. C’est un témoin silencieux. Moi, je voulais le perturber, changer sa nature. Le lier à cet homme tout en habitudes et en rituels. Et chercher à quel moment tous ces rituels pouvaient glisser vers quelque chose de plus dangereux. J’ai aussi été marqué par une série d’assassinats ayant eu lieu aux Pays-Bas pendant l’écriture du film. Non pas que ces meurtres m’aient fasciné, mais ils ont forcément déteint sur mon travail.

L’autre arrière-plan du film, c’est le libéralisme économique qui vient menacer cette communauté.
J’ai été dans ces territoires agricoles. J’ai donc participé à nombre de ces réunions entre paysans et représentants politiques, comme celle qu’on voit dans le film. J’ai pu voir à quel point les réformes politiques et économiques actuelles créent des bouleversements majeurs sur les paysages et les gens qui y vivent.
Vous liez ces bouleversements économiques à la violence présente dans le film ?
C’est une question fondamentale : le mal vient-il de nous ? Ou d’un contexte extérieur ? La communauté paysanne que dépeint le film est-elle menacée par la concurrence extérieure venue de Chine, ou par son propre gouvernement.
Est-ce ce questionnement qui vous a poussé à rester évasif quant à la nocivité réelle ou supposée de votre personnage principal ? On ne sait pas si c’est un fou, un tueur ou juste un brave grand-père en quête d’héroïsme.
Pour moi, l’enjeu ce n’est pas qui a commis ce crime, mais : comment cette violence contamine-t-elle le quotidien de ces hommes ordinaires ? Comment ce meurtre pénètre peu à peu leur corps ou leur âme. La culpabilité d’un seul individu devient l’affaire, plus complexe, de toute une communauté.
Alors, les hommes sont tous des prédateurs en puissance ?
Je serais plus nuancé. L’idée selon laquelle, de façon quasi-divine, chaque homme serait ontologiquement dangereux, me rend méfiant. Bien sûr, je ne considère pas que n’importe quel individu peut se transformer en violeur ou en tueur. Mais nous pouvons tous être hantés, à des degrés très divers, par des pulsions qui nous effraient. Cette cette violence insidieuse que je voulais explorer.
Parallèlement, le film distille des traits d’humour assez étonnants, comme cette scène assez grivoise dans la cuisine, où Johan et son gendre s’amusent de façon très régressive…
C’est vrai. C’est un moment de la vie ordinaire. Entre deux hommes qui se connaissent bien mais qui ne sont pas toujours à l’aise avec la communication. Pour eux, avoir des gaz, en rire, c’est leur façon de se parler.
On peut y voir une autre façon de dépeindre la communauté masculine, en enfants mal élevés et pas toujours très délicats.
Mais pour moi, ce qu’ils font n’a rien de dégoutant. Certaines personnes ont honte d’elles-mêmes, d’autres non. Ce sont des blagues du pays. Je ne le théorise pas plus que ça.
Comment avez-vous travaillé avec votre interprète principal, un véritable paysan coupeur de roseau ?
J’ai toujours été convaincu que je ne pourrais pas évoquer ces paysages avec fidélité sans être guidé par des gens véritablement ancrés dans ce territoire. Je me souviens de l’avoir repéré dans une réunion de travailleurs. Il était là, silencieux, à l’autre bout de la table. Il fixait ses mains. Je les fixais aussi. Il a tout de suite été très accueillant. Il m’a montré comment fonctionnent les machines pour travailler dans les roselières. Sa gentillesse a imprégné mon travail d’écriture. Ensuite, ça a été un long travail de mise en confiance.
Il est très juste dans le film, à la fois dans les moments en solitaire, mais aussi quand il agit en grand-père.
En fait, sur certaines scènes, il était si impliqué qu’il en devenait presque trop émotif pour le genre de film que je cherchais. La scène où il découvre son cheval, allongé dans l’herbe – il était très marqué. Pendant qu’on préparait des plans, il s’est mis à l’écart du tournage. Et quand je suis allé le chercher pour lui demander ce qu’il faisait, il m’a juste dit, avec beaucoup d’émotions : « Je repense à cette scène. »
Avez-vous vu Le Mal n’existe pas ?
(il rit) Oh oui, je savais qu’on me parlerait beaucoup de ce film, entre la séquence de la réunion, le thème du mal dans le paysage… La vérité, c’est que nous avions déjà commencé à tourner quand le film d’Hamaguchi est sorti. Au début, je ne voulais pas le voir. Et puis, dans un moment de doute durant le montage, j’ai finalement accepté. J’ai trouvé ça très beau. Je me suis même senti conforté dans ma propre démarche. Mais vous savez quoi ? Une amie m’a dit récemment qu’un autre film, turc cette fois, mais consacré à un coupeur de roseau, allait bientôt sortir. Il faut croire que nous sommes un certain nombre à être hantés par ces images.

Reedland, en salles prochainement.