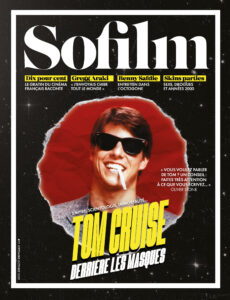Pauline Loquès (Nino) : « Je ne voulais pas faire un film qui irait plus loin que la première séance de chimio »
On n’est pas tout à fait redescendu de l’expérience aérienne que propose Nino (en salles le 17 septembre). Une sorte de Lost in translation post-covid, où le Japon serait remplacé par un Paris vaporeux, et Scarlett Johansson par un grand échalas trentenaire, Théodore Pellerin, en proie, cette fois-ci, à l’avènement d’une maladie qui pourrait bien lui dévorer la bouche. Une prestation auréolée par un prix de la Révélation lors de la dernière Semaine de la critique cannoise. Parce qu’elle a eu le courage – ou l’inconscience – d’affronter, le motif si piégeux du « film générationnel », on a voulu rencontrer Pauline Loquès, sa réalisatrice, dont c’est le premier long-métrage. Alors que, sur le chemin, on se demandait si elle serait aussi discrète que « son » Nino, Pauline nous parle, avec beaucoup de franchise, de son rapport aux acteurs, des vrais faux clichés sur le regard protecteur des réalisatrices, et de son besoin de pouvoir travailler « sans crier ». Entretien sur un temps donné.
Propos recueillis par Benjamin Cataliotti.
Plus encore que de la tendresse, la bienveillance est un mot qui revient beaucoup quand on pense à Nino. C’est un mot qui vous parle ?
Énormément. C’est mon premier film. J’ai trouvé qu’il avait mis du temps à être financé. Alors quand j’ai su que Nino allait se faire, je me suis promis de profiter de chaque minute de ce tournage. Je ne voudrais jamais faire un film qui m’amènerait ensuite à me dire que le tournage était galère, ou que les relations entre les gens y auraient été tendues. Je ne voulais pas que ça me ramène à des sensations négatives. Donc j’ai vraiment essayé d’insuffler quelque chose que j’ai peut-être en moi : une sorte d’atmosphère de travail, oui, bienveillante. Mais aussi parce que le sujet du film s’y prêtait. Il fallait faire preuve d’un peu de décence. On faisait quand même de la fiction à partir de la maladie. Je me suis dit : « Évitons les caprices démesurés. »
Quels genres de caprices « démesurés » craigniez-vous ?
Tout le monde m’avait dit : « Tu verras, le cinéma, c’est tant de stress. Faire son premier film, c’est tellement angoissant ! » On peut aussi partir dans des états d’angoisse, de colère. J’ai essayé de préserver le film de ça. Et j’ai choisi des personnes en conséquence. J’ai voulu travailler avec des gens qui se sentiraient particulièrement touchés par le film. Pas forcément dans un aspect larmoyant. Simplement, des gens qui seraient prêts à donner un peu d’eux dans l’intimité, et à qui le film parlerait à des endroits divers. Parfois, c’était un lien à l’amitié, parfois au deuil, ou à la maladie.
Cette exigence de communion avec le sujet s’arrêtait-elle au casting, ou aussi à l’équipe technique ?
À tout le monde. Acteurs, techniciens… Techniciennes, surtout, d’ailleurs, puisque l’équipe était très féminine. Déjà, je me suis dit qu’il fallait que je puisse travailler sans crier. Pour pouvoir amener tout le monde dans l’atmosphère du film. Je ne sais même pas si c’est de la tendresse. On n’était pas non plus là à tous se faire des câlins. Mais il y avait une certaine recherche, je ne sais pas, de noblesse. On se disait : « Attention, on fait un film sur la maladie. Il faut rester humbles ».
Au risque de ne pas oser affronter le sujet de front ?
C’était un des risques. Je me rappelle, le troisième jour, ma cheffe opératrice m’a dit « Si tu me parles trop gentiment, je ne vais pas me dépasser. » Mais je lui ai répondu : « Oui, mais moi, je ne vais pas te crier dessus. Donc il faut trouver une autre manière de travailler. » Mais je comprends. Ce sont des processus très ancrés. Encore plus pour les techniciennes, qui ont été habituées à devoir la ramener encore plus que les hommes. Moi, j’ai toujours été très attentive à ça. Je regarde si les chefs de poste parlent bien à leurs assistants. J’ai lu tellement de choses effarantes sur les tournages. Je disais à mon équipe : « On va toutes se dépasser mais dans… l’amour. » (rires). C’est peut-être naïf, mais j’ai quand même l’impression que les gens ont moins de limites quand ils se sentent très aimés. L’idée, ce n’est pas de se dépasser parce qu’on a peur, mais parce qu’on sent qu’on a la place pour le faire.

C’est quand même un comble de se dire que la révolution, c’est de travailler dans le respect de chacun·e !
Mais oui ! Même pour Théodore (Pellerin, l’acteur principal, ndlr), les choses n’étaient pas évidentes au début. Il y avait beaucoup de réflexes à déconstruire. On naviguait parfois à vue. On ne savait pas si on était juste là pour profiter d’un tournage « sympa », ou si, en allant chercher l’humanité de chacun, on allait atteindre une vérité. Sans tomber pour autant dans le film « bisounours », hein.
Au risque de sauter à pieds-joints dans le cliché de la réalisatrice « maternante », vous diriez que le fait d’être une femme vous rend plus attentive, voire plus protectrice ?
Pour moi, ce n’est pas forcément un cliché. Par contre, je ne sais pas si les acteurs le ressentent comme ça. Je ne pense pas que Théodore ou les autres pensent que je suis leur maman. Mais d’ailleurs, ce ne sont pas des acteurs qui ont vraiment besoin d’être maternés. Ils sont très autonomes, très solides. Pas le genre à vous demander « Heu… mais… c’est bien ce que j’ai fait ? » En revanche, moi, je les aime beaucoup. Et je le leur dis. Parce que j’ai énormément d’empathie pour les acteurs et pour ce qu’ils doivent produire. Je me dis que s’ils ne sont pas soutenus a minima, ça va être une vraie souffrance pour eux. Après, le côté maternel, il faut s’en méfier aussi. Ça peut être toxique, la toute puissance maternelle.
Vous disiez que Théodore Pellerin avait pu sembler un peu déstabilisé par cette approche ?
Théo, je lui ai dit : « T’as rien à faire ! » Forcément, il m’a regardé, genre : « Mais moi, j’adore travailler, comment je vais me débrouiller ? » Mais je lui répondais : « Je vois déjà tout ce qui est en toi et que je vais prendre. Alors : épure, épure, épure. » Nino, ce n’est pas un personnage qui doit être gouverné par des intentions. Théo, je trouvais qu’il avait déjà un tel charisme. Je lui ai dit : « Surtout, n’en rajoute pas, autrement, ça va être trop. » Après, comme je disais, je demande un peu d’eux-mêmes aux acteurs. Par exemple, qu’ils me parlent de leur vie. Ça, c’était plus dur pour Théo. C’est un garçon secret. Ce n’est pas un acteur qui va débarquer sur le plateau et dire : « Moi, je suis comme ça dans la vie. » Ça lui a un peu coûté de se dévoiler.
Ce qui va bien avec le caractère très rétif de Nino dans le film…
Oui, mais Théodore, lui, n’en avait pas du tout conscience. Quand je lui disais : « Vous êtes assez proches quand même, » lui me répondait : « Ah non, non. Pas du tout ! » (rires). Théodore a déjà une belle carrière aux Etats-Unis et au Québec. Mais peut-être plus dans des rôles de composition. Là, il fallait qu’il s’autorise à un véritable dénuement. Et aussi, qu’il se laisse porter par les autres acteurs. Il est québécois, Théo. Il ne savait qui c’était, William Lebghil, Camille Rutherford… Après les répétitions, il est venu me dire : « Ok, en fait t’as raison, j’ai rien à faire. Il faut juste que je m’appuie sur les autres. »
D’où vient cette épure qui caractérise Nino ?
Je ne savais pas grand-chose de lui. Je connaissais sa manière de s’habiller, de parler. Je voyais ses déplacements dans la ville. Mais je ne savais rien d’autre. Et ça m’allait très bien comme ça. Si j’ai tout compris, à quoi bon réaliser le film ? Après, quand Théo est arrivé, tout s’est mélangé. Je n’arrivais plus à faire la différence. Je ressentais une affection débordante pour lui, mais aussi pour le personnage. Puis quand le tournage était terminé, j’ai dû découvrir un autre Nino, qui ne vivait que dans les images. J’ai dû faire le deuil de la présence physique de Théodore, qui était réellement parti, puisqu’il était retourné à Montréal. Moi, je devais remettre toute mon énergie dans le montage, pour retrouver le Nino qui était à l’écran. Pas celui que j’avais imaginé, ou que j’avais aperçu sur le plateau, mais celui qui ne pouvait jaillir que du montage.

Puisqu’on en parle, est-ce que ce rythme très legato, presque en latence, du personnage et du film, a été fixé au montage ?
On l’a découvert avec Clémence Diard, la monteuse. En tant que spectatrice, j’accepte très bien la chronique. Si c’est bien joué, je peux rester dans la même scène pendant longtemps. Je ne suis pas obsédée par l’avancement du récit. Nino aurait pu être encore plus long mais on a un peu « musclé » le film, tout en abandonnant certaines péripéties qui auraient pu sembler artificielles. À force, le film a gagné en rythme avec le montage. Alors qu’à l’écriture, j’avais pas mal de retours de gens, qui se disaient touchés par le texte mais qui trouvaient qu’il ne se passait… pas grand chose, quand même !
Vous avez eu peur de rebuter vos spectateurs avec un rythme trop passif ?
J’avais peur de les ennuyer. Ou qu’ils décrochent. On a beaucoup travaillé la scène d’introduction. On se disait : si les gens s’attachent à ce qu’il est en train de vivre, on le suivra partout. On a un peu galéré, honnêtement. Il y a beaucoup d’informations à assimiler. Parfois des gens me disent, généralement des spectateurs un peu plus âgés : « Oh la la, je n’ai rien compris à la première scène… »
A contrario, vous pouvez comprendre que pour certains spectateurs, certains traits scénaristiques puissent sembler un peu appuyés ? Comme la symbolique du taiseux à la gorge malade, le fait de rester à la porte de chez soi…
Je me rappelle, à la fin de l’écriture du scénario, m’être beaucoup dit : « Attention aux grandes phrases. Attention aux grandes idées métaphysiques. » Finalement, on a pas mal épuré le récit. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si je garderais tout, avec le recul. Mais j’avais tellement peur que les gens ne comprennent pas ! Qu’ils passent à côté et regardent juste un mec déambuler pendant je ne sais combien de temps. Après, sur certaines métaphores… Franchement, je n’ai pas écrit en me disant : « Il va avoir un cancer de la gorge parce qu’il a du mal à exprimer ses sentiments. » Pour moi, c’était très concret. J’ai pensé : papillomavirus = gorge. Je voulais un cancer qui se soigne quand même plutôt bien. Mais oui, il y a peut-être des symboles un peu forts.
Peut-être est-ce l’accumulation de ces symboles qui peut finir par les rendre trop visibles ? Le fait que le motif de la procréation apparaisse presque comme un MacGuffin, que Nino, poussé par ce but, soit invité dès les premières minutes à congeler ses spermatozoïdes, « pour ne pas insulter l’avenir » ?
Oui, mais typiquement, quand pendant la préparation du film, Théodore m’a dit que pour lui, c’était d’abord un film sur la parentalité, j’ai été vraiment surprise. Il me disait : « Mais si, il n’y a que ça. » Ailleurs, quelqu’un m’a dit : « Regarde, les pères sont tous absents ! » Je n’avais même pas réalisé. Je crois qu’on projette aussi à partir de nos propres obsessions et de notre inconscient.
Cela dit, il n’y a pas tant de fictions françaises qui abordent cette question de la parentalité dans les nouvelles générations.
Il y a des scènes que je voulais montrer. La fille qui se fait des injections en pleine fête, c’est quelque chose que j’ai déjà vu. Pourquoi on ne le montre jamais ? On en parle trop peu. Au cinéma, souvent, on considère que les histoires de parentalité, ça va forcément être pour parler d’enfants super chiants, ou de parcours de vie compliqués. J’avais envie qu’on disserte un peu là-dessus.
Vous diriez que Nino est un film post-covid ? Au sens où il évoque aussi une génération particulièrement déphasée, mise sous cloche par cette présence sourde de la maladie.
C’est un peu l’état dans lequel j’étais moi-même. Cette quête de sens. Ce repli sur soi… Sans pouvoir nommer quelque chose de très concret. Moi je n’arrêtais pas de me répéter : « Les gens ne vont pas très bien… Ils ne vont vraiment pas très bien… ». Pour Nino, je me disais qu’il ne fallait pas se moquer de tous ces personnages qu’on aperçoit dans le film et qui, non, ne vont pas très, très bien en fait. L’histoire de cette fille qui veut partir à Montréal. Ce mec qui consomme des podcast mais explique qu’il ne faut pas trop s’écouter soi-même… C’est peut-être propre à la trentaine, mais oui, ça me touche, cette quête de réponses qui n’arrivent pas forcément. Vous savez, dans le film, Nino, ce n’est pas forcément le personnage que je plains le plus.
Vraiment ?
Oui, parce que malgré tout, cette maladie lui donne une petite direction. Un combat. Il sait où il va mettre son énergie. Je me rappelle que pour La guerre est déclarée, Valérie Donzelli répétait beaucoup ça. Au moins, face à la maladie, on a un peu les doigts dans la prise. Je comprends cette idée. On trouve un adversaire concret. Je me souviens aussi d’une scène de Girls comme ça, où Lena Dunham se retrouvait à passer des tests pour le dépistage du sida. Elle est là : « Bon, au moins, si je l’avais, je n’aurais pas à trouver un taff… ». Nino, ça lui tombe dessus, c’est terrible. Mais au moins, ça lui donne une certaine grandeur.
La comparaison avec Girls est intéressante. Comme dans la série de Dunham, Nino fait jongler problèmes personnels et angoisses générationnelles.
J’étais ébahie par les actrices de Girls. Et par les dialogues. Elle a réussi à sonder son époque à travers le prisme d’une génération et d’un milieu urbain. Ça me touchait.
Le film a toujours été pensé dans cette temporalité réduite sur trois jours ?
Mon point de départ, c’était un refus de faire un film qui irait plus loin que la première séance de chimio. Je ne voulais pas montrer comment la maladie peut s’attaquer au corps, mais ce qu’elle fait à l’intériorité, à la psyché. On avait pensé à commencer plus tôt, à montrer la routine de Nino avant ce premier rendez-vous. Mais la vérité, c’est que moi, je ne sais pas écrire des films sur de plus longues périodes. Écrire un récit qui se déploierait sur six mois, j’en serais incapable. Ce rythme resserré, pour moi, c’est la réalité. Je me colle à ce qu’il vit en temps réel. Moi, je n’ai pas fait de formation de scénariste. Me dire : à la vingtième minute, il faudrait une ellipse, ou je ne sais quoi, j’en suis incapable. Je me rappelle d’une masterclass de Richard Linklater, qui disait que lui non-plus n’arrivait pas à raisonner comme ça. Il disait : « En revanche, un film a toujours besoin d’une structure. Donc, le temps, c’est ma contrainte. »
Un peu comme les gens qui ont besoin de deadline pour finir ?
Oui, voilà. J’ai écrit une deadline pour Nino. Pour moi, c’est plus organique. Tu te dis : « Ok, samedi matin, que fait-il ? Et samedi soir ? Et dimanche matin ? » Il faut remplir les trous. C’est du temps passé sur du réel.
Nino, en salles le 17 septembre.