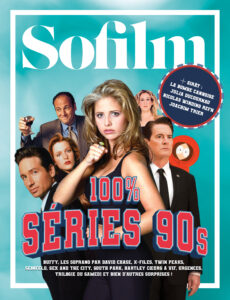Bo Widerberg : « Je trouvais que la plupart des films suédois étaient vraiment nuls ! »
Par Laurie-Anne Alfero.
Il est devenu l’un des plus grands cinéastes suédois, par simple esprit de contradiction. Au croisement d’images d’archives, de témoignages intimes et d’extraits de film, le documentaire Being Bo Widerberg (actuellement en salles) dessine l’histoire d’un enfant de Malmö devenu un réalisateur incontournable du XXe siècle dans son pays. Un parcours marqué par la rébellion, la passion et la douleur.
Dès ses débuts, Bo Widerberg se distingue par une colère tenace. Fils du milieu modeste de Malmö, il commence comme écrivain puis critique, mais surtout comme spectateur d’un cinéma national qu’il juge étouffant : « Je trouvais que la plupart des films suédois étaient vraiment nuls ! » confie le cinéaste dans le documentaire Being Bo Widerberg, qui lui est dédié. Plus qu’un simple goût de la provocation, cette prise de position révèle un désir profond d’authenticité et de modernité. Quand arrive la Nouvelle Vague française, Widerberg découvre Les 400 coups de François Truffaut, une expérience qui le marquera profondément. Enfin un cinéma qui l’implique et le concerne. Il se doit à son tour, à l’image de Truffaut, mais aussi de Rivette, Demy, ou Godard, de créer un cinéma vivant, sensible et libre. Dans les années 60, c’est son compatriote Ingmar Bergman qui capte toute l’attention en Suède et à l’international. Et malgré des œuvres reconnues comme Le Septième Sceau ou Les Fraises sauvages, Widerberg les juge trop détachées de la réalité : « Personne ne travaille dans les films de Bergman ». Dans son premier long métrage, Le Péché suédois, présenté à la Semaine de la Critique du festival de Canne en 1963, il présente « sa vérité », celle d’une classe populaire, dans son jus, charmante et contradictoire. Plus qu’un projet esthétique, Widerberg s’engage sur le plan politique, en sortant « filmer la réalité ».

La Nouvelle Vague suédoise
À l’origine du documentaire, Jon Asp et Mattias Nohrborg ne se contentent pas d’ériger Bo Widerberg en génie solitaire, mais l’inscrivent dans un vaste mouvement de révolution sociale et artistique qui touche toute l’Europe des années 60. Nourri d’une envie d’expérimenter et d’un besoin viscéral de renouveau, Widerberg traduit à l’écran cette énergie collective et la volonté de briser les carcans d’une société des classes encore rigide. Dans Elvira Madigan ou Ådalen ’31, il met en scène des personnages en lutte pour leur liberté, des jeunes femmes ou des ouvriers cherchant à s’affranchir d’un destin tracé. Avec ses caméras, il montre une chose qui ne concerne pas simplement Malmö, mais toute la Suède : l’annonce d’une nouvelle ère. Bien qu’il déteste le « manque de sensualité de l’extrême gauche », son cinéma se trouve guidé par une sensibilité politique marquée et une fascination pour la liberté. Widerberg y trouve un exutoire pour aborder toutes sortes de sujets dont il se sent concerné, notamment par la volonté de « montrer à quel point c’est difficile d’aimer la mauvaise personne » dans Elvira Madigan, inspiré tout autant d’une histoire vraie et de sa propre passion extraconjugale. Beaucoup de ses films portent la trace de ses choix amoureux, familiaux ou sociétaux. Incapable d’exprimer ses angoisses et ses contradictions dans la vie quotidienne, il les projete à l’écran avec une sincérité brute qui donne à son cinéma cette force presque douloureuse. « Ses films sont très autobiographiques, confie son fils, si l’on regarde avec un œil nouveau en sachant ce qui se passait dans la famille, on le retrouve à l’écran ». Being Bo Widerberg explore ainsi le paradoxe d’un homme qui intègre ses proches à son œuvre tout en mettant en péril l’équilibre familial. C’est précisément son impossibilité à s’exprimer dans la vraie vie qui rend les émotions si claires et percutantes dans ses films. Toujours en quête de perfection pour les représenter au mieux, il était régulièrement empreint d’excès colériques et très exigeant avec ses équipes ; un perfectionnisme et une tension permanente qui le mèneront jusqu’à la dépression. Les voix de cinéastes contemporains comme Ruben Ostlund, Roy Andersson, Tarik Saleh, Olivier Assayas ou Mia Hansen-Løve enrichissent ce portrait d’un fauteur de trouble complexe, anticonformiste et profondément humain. Entre lumière et ombre, liberté et responsabilité, Widerberg apparaît comme un artiste habité, dont la violence intérieure est indissociable de la beauté et de la sincérité de son œuvre.

Being Bo Widerberg, actuellement en salles.