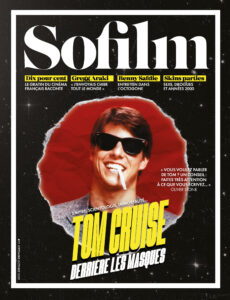Dos veces bestia de Luis Esguerra Cifuentes
Par Tara Canillac
Dans une forêt appelée « La Zone », pousse une mousse toxique. Un groupe d’amis qui fréquentent le lieu malgré les restrictions et les avertissements, témoigne des conditions particulières de cet espace et des événements qui s’y déroulent. Après quatre courts-métrages, dont Tú me hicister ver el cielo (2023), Luis Esguerra Cifuentes signe son premier long avec Dos veces bestia présenté au Panorama du cinéma colombien (13ᵉ édition, du 14 au 19 octobre 2025, à Paris). Le film se distingue par son approche hybride, entre fiction et documentaire. Sa singularité ne réside pas tant dans son sujet que dans la manière dont il est traité. En mêlant les corps au paysage, le cinéaste fait naître un souffle commun, où la nature respire avec l’humain autant qu’elle l’engloutit. « La Zone », complètement personnifiée par des éléments sonores et visuels, devient de façon inéluctable le personnage principal du film. Au travers de divers plans de verdure, agrémentés de battements de cœur, de bruits acouphéniques, bucoliques, voix off mais aussi des effets visuels : zooms, grains, gribouillages, flous, cette forêt devient très organique, presque palpable. Et en périphérie, tous ses visiteurs, ces personnalités atypiques, en composent le récit. Le format, alternant entre numérique et 16mm, s’impose comme repère au-delà de servir la structure du film. Un plongeon dans l’intimité, au cœur d’un réel qui semble presque irréel.

La Zone en personne
Le film s’ouvre sur des visages face caméra, comme pris en plein interrogatoire. L’ambiguïté s’installe : qui parle, et à qui ? Le dispositif évoque d’abord une enquête, comme si ces personnages avaient commis une faute. Peu à peu, les questions laissent place à des confidences, et la fiction se délite au profit du réel. Le film glisse alors vers le documentaire, sans jamais rompre avec la mise en scène. Autour de cet espace, gravitent des voix multiples : une mère et son fils, un couple homosexuel, une femme trans… Chacun témoigne de son rapport à ce lieu, de la distance qui le sépare de « La Zone » et du moment de sa dernière visite. Tous affirment n’avoir ressenti aucun symptôme malgré la toxicité supposée de la mousse : un signe que cette zone « malade » pourrait être leur espace de guérison. Pour cette communauté queer, la forêt devient un territoire d’émancipation, une réappropriation de la nature, et de leur propre nature. Un endroit où s’exhiber, se révéler, s’aimer, hors du cadre social. Loin d’être un simple refuge, il agit comme un révélateur. Il accueille ces corps marginaux, les protège autant qu’il les confronte à eux-mêmes. À travers les témoignages se dessine une topographie du désir : chacun y cherche un fragment de vérité, une part d’eux qu’ils n’osent montrer ailleurs. Le film avance par couches, entre confidences et silences, jusqu’à brouiller la frontière entre l’intime et le collectif. Car cet endroit n’appartient à personne, et pourtant, chacun y projette sa propre histoire, ses blessures, ses manques. Cette fusion entre les corps et le paysage transforme Dos veces bestia en expérience sensorielle : un cinéma qui touche autant par ce qu’il montre que par ce qu’il suggère. En écho à cette diversité, la chanson La Luna d’Ana Gabriela ponctue le film comme un rappel : « La lune brille pour tous, mais elle n’éclaire pas de la même façon. »
Dos veces bestia, diffusé le 17 octobre au cinéma Reflet Médicis à l’occasion du Panorama du cinéma colombien