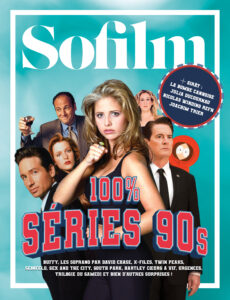Grand Tour de Miguel Gomes
Par Faustine Saint-Geniès.
C’est une grande roue, de nuit, au milieu des feux d’artifice et des lumières, quelque part en Asie. Pendant que certains déambulent et s’amusent dans cette fête foraine, d’autres se contorsionnent pour activer les mécanismes de l’attraction. Ils sont pieds et mains nus, font tourner la roue, lui donnent son élan. Cette séquence – la première et l’une des rares en couleur – annonce au spectateur le pacte cinématographique proposé par le réalisateur : le film est à l’image de la roue, le spectateur va s’y installer, décoller et faire lui aussi ce « grand tour », quitte à éprouver parfois un sentiment de vertige.
L’histoire de ce long-métrage de Miguel Gomes est inspirée d’une anecdote dans un livre de voyage de l’écrivain britannique Somerset Maugham. En 1918, en Birmanie, Edward, fonctionnaire de l’Empire britannique, s’enfuit le jour où il devait épouser sa fiancée Molly. Déterminée à se marier, elle part à sa recherche et le suit tout au long de son « grand tour », avec toujours un train ou un bateau de retard. La première moitié de ce road movie est contemplative et suit les pérégrinations d’Edward de Rangoon à Singapour, puis à travers la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, le Japon et enfin la Chine. Le film gagne en énergie et en humour avec l’irruption de Molly, tout droit échappée d’une screwball comedy, ces comédies américaines des années 30 et 40. La mélancolie du héros est évacuée par les fous rires de l’héroïne, la lâcheté de l’homme contrebalancée par l’opiniâtreté de la femme.
Un film en forme de machine à remonter le temps
Récit initiatique, roman d’aventure, carnet de voyage ou un peu tout cela à la fois, le film se joue du temps et des contrastes. Dans un dégradé de noirs, de blancs et de gris, il mêle le destin de nos deux héros à des images issues d’un travel doc contemporain. Le tout intercalé de spectacles de marionnettes sur le thème de l’amour. Le passé se fond dans le présent, le sacré dans le profane, l’histoire intime des personnages dans le brouhaha urbain et l’immensité du monde. Comme pour brouiller encore davantage les pistes, le récit donne à entendre une incroyable diversité de langues : portugais, anglais, français, vietnamien, thaï, birman, chinois, japonais. La beauté et la poésie de ce film résident justement dans sa capacité à réunir des éléments aussi disparates et créer une ligne directrice. Et peu importent les anachronismes qui affleurent.
C’est une habitude, le cinéma de Miguel Gomes surprend, désarçonne, interpelle et en profite pour remonter le temps du septième art. La roue de la séquence d’ouverture rappelle les toutes premières projections de cinématographe. On retrouve là la magie de Tabou (2012) et le côté foutraque des Mille et Une Nuits (2015), mais aussi une réflexion sur le champ des possibles du cinéma. Les registres changent sans cesse (voix off, sous-titres, dialogues, scènes muettes, cinéma chanté, fiction, documentaire) sans pour autant se confondre. Sixième long-métrage du réalisateur et prix de la mise en scène à Cannes, le film est une aventure dont on ne revient pas indifférent. Comme le résume Miguel Gomes dans son journal de bord lors du tournage : « Nous avons parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour filmer, mais le véritable grand tour de ce film, c’est celui qui relie ce qui est séparé. »
Grand Tour, en salles le 27 novembre.