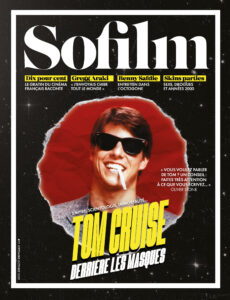Hlynur Pálmason (L’Amour qu’il nous reste) : « Je suis très mal à l’aise sur le tapis rouge »
Salué pour sa fresque historico-poétique Godland en 2022, l’islandais Hlynur Pálmason est de retour avec un film autrement plus intimiste sur la famille et le temps qui passe, à travers le quotidien d’un couple et de leurs enfants confrontés au divorce. Tout en plans fixes et en instantanés sublimes des paysages volcaniques, L’AMOUR QU’IL NOUS RESTE captive et nous engloutit pendant 1h48. Propos recueillis par Alice de Brancion. Photo : Dransi
Aviez-vous à cœur de faire un film radicalement différent après Godland ?
C’est ce que tout le monde me dit. Je comprends, c’est vrai que c’est une autre ambiance. Beaucoup de personnes auraient peut-être souhaité que je poursuive sur quelque chose de grandiose, et j’ai voulu faire l’exact inverse, aller vers l’intériorité, vers l’intime. On essaye à chaque fois de créer un monde, et j’espère que mes films sont très différents. C’était une évolution logique dans mon travail de faire quelque chose de nouveau. Ça s’est juste passé naturellement.
Comment le sujet de la rupture s’est-il imposé ?
Pour commencer, je ne voulais pas que ce soit un film tragique. La vie n’est pas allée dans le sens que ce couple voulait. L’humain est complexe, il fait parfois des choses qu’il n’a pas envie de faire. Je voulais que le film transcrive ce va-et-vient des émotions, en évitant de me concentrer sur une seule subjectivité. Par ailleurs, ce film n’est pas seulement l’histoire d’une rupture. C’est un film sur la fuite du temps et sur les moments passés avec ses proches. Je me demande comment les souvenirs sont créés ? C’est un film très personnel.
Certaines scènes ont-elles été inspirées de votre propre vie ?
Plusieurs images sont effectivement tirées de ma vie. Les scènes qui se passent dans la nature sont des endroits où je vais cueillir des baies avec ma famille. Mon film s’ouvre sur un toit arraché sur une grue. J’ai tourné cette scène en 2017 parce que je la trouvais très triste et belle. Mon studio de travail s’est fait démanteler et cela m’a profondément attristé. C’était des images importantes pour moi et quand on a développé les pellicules, je me suis rendu compte qu’elles avaient un réel impact, qu’elles pouvaient résonner pour d’autres personnes. Faire un film c’est attraper ces moments et commencer un processus de réflexion et de sensorialité autour d’eux. Je me promène avec une caméra, que j’ai en permanence dans ma voiture. Et c’est souvent ces images capturées sur l’instant qui sont les points de départ de mes films. Je veux qu’une certaine improvisation se fasse sentir dans la réalisation : on n’a pas de scènes à la Dolly, pas de trucs chics, le cadrage se partage essentiellement entre plans fixes et panoramas.

Imaginez vous tourner avec un autre budget ?
C’est une bonne question. Je ne pense pas que je ferais de meilleurs films. Mon budget a un impact énorme sur mon processus de création : je ne crée jamais de décor, je fais appel à des gens de ma ville natale, je tourne dans ma propre voiture, même mes enfants sont dans le film. Quoi qu’il advienne, je ne me vois pas faire de films sans souffrance, sans sortir exténué du tournage. Mais c’est vrai qu’en tant que cinéastes, on a toujours besoin d’argent. Il y a eu des coupes budgétaires énormes dans le monde de la culture en Islande. C’est la merde. Je ne sais même pas comment nous allons continuer à faire des films. La France est vraiment unique sur le sujet, il faut que vous vous battiez pour préserver cette chance.
Votre présence à Cannes doit tout de même vous aider à avoir de la reconnaissance et donc des financements ?
C’est vrai. Je suis extrêmement chanceux d’avoir ma place ici, et que les films soient montrés aux côtés de ceux d’autres cinéastes que j’admire. Le cinéma, à Cannes, c’est du sérieux. Même si j’avoue que je suis très mal à l’aise sur le tapis rouge. Je n’ai jamais rêvé d’être une grande star, je veux juste continuer à pouvoir travailler sur les projets que je veux faire, c’est le plus important.
Le film se déroule sans sous texte, sans explication, ni flashback. Vous semblez avoir une totale confiance en vos spectateurs ?
Les films doivent être des dialogues. En tant que spectateur, j’ai besoin qu’on me respecte mes émotions et mes interprétations, pas qu’on me donne la becquée. Avec mon équipe, nous voulons faire des films qui soient des expériences à la fois psychologiques et physiques. On ne doit pas sentir la construction. Tout doit se dérouler de manière naturelle. Même lorsque je filme de longues scènes de dialogue, ce n’est pas tant pour faire avancer l’intrigue, c’est plutôt un besoin d’entendre parler mes personnages.
Qu’en est-il de cette « statue » de chevalière qui revient tout au long du film ?
Je l’appelle Jeanne d’Arc et je l’ai filmée pendant trois ans. Au départ, ce n’est qu’un épouvantail qui s’est transformé en une magnifique chevalière à la longue chevelure. Je ne sais pas trop expliquer sa présence, elle s’est comme imposée à moi. Et puis je me suis mis à imaginer qu’elle se réveillait, j’ai été moi-même surpris. Encore une fois, je ne fais que réagir aux images qui entourent le film. C’est un extérieur et un intérieur qui sont constamment en dialogue. C’est à ça que sert le cinéma. La vie traverse les films et les films permettent de pénétrer nos espaces intérieurs, qui sont infinis. C’est un pouvoir énorme.

L’Amour qu’il nous reste, en salles prochainement.