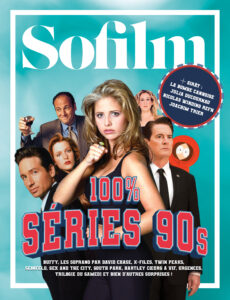MARTIN EDEN de Pietro Marcello
– LE FILM DE LA SEMAINE : MARTIN EDEN –
Si l’œuvre de Jack London a toujours fasciné le cinéma, personne n’avait encore osé adapter son monumental chef-d’œuvre, Martin Eden (1908), sorte d’autobiographie désespérée et l’une des plus fortes descriptions de la violence sociale et culturelle jamais écrites. Pietro Marcello ose le faire et s’en tire gagnant avec le Prix de la meilleure interprétation masculine à Venise pour Luca Marinelli dans un film absolument singulier. À tel point que plus il s’éloigne de son modèle dans la forme, plus il s’en rapproche dans l’esprit.
Quiconque a lu Martin Eden aura forcément peur en entrant dans la salle. Son poids esthétique et politique, la précision du processus vital de son héros, la belle description de l’apprentissage autodidacte, celle du travail, aussi, que ce soit dans l’écriture du jeune homme ou dans ses terribles tâches alimentaires, où London parvient comme rarement dans l’histoire de la littérature à décrire l’usage et la déchéance que le corps et l’esprit d’un être humain peuvent subir quand il devient force de travail… Difficile de penser qu’un film de deux heures puisse reproduire tout ça. Tout comme la violence avec laquelle London décrit sans le nommer le parcours « transclasse » de son protagoniste (ouvrier fasciné par la culture qu’il lie à la bourgeoisie, la même dont il s’éloignera pour écrire dans la pauvreté, la même qui le fêtera quand il sera célèbre) et qui ferait pâlir la prose française contemporaine qui se remplit la bouche de ces notions. Impossible donc de ne pas trouver vertigineux le rythme forcément syncopé, elliptique et furtif qu’imprime Pietro Marcello à son adaptation. Pourtant, ça s’arrête là. Autrement dit : les limites du film sont celles de toute adaptation littéraire. Pour des questions de temps, il doit trouver des solutions somme toute assez classiques (fusion de quelques personnages dans un seul, suppression de quelques passages similaires…). Pour le reste, plus le film s’éloigne du roman, plus il lui est fidèle. Voici le miracle, politique et esthétique, de Marcello. Explications.

En quoi le film s’éloigne-t-il du roman ? Il prend ses distances d'abord dans l’espace (filmé à Naples, et pas Oackland) et ensuite dans le temps (filmé, logiquement, en 2018). Sauf que Marcello ne dissimule ni l’un ni l’autre, Naples sera toujours Naples, même si les dialogues n’y font pas forcément trop référence, et s’il situe l’action du film au début du XXe siècle, il ne cache pas des morceaux de présent. Le brouillage de pistes va plus loin encore : filmé visiblement en pellicule, l’image a ensuite été traitée, rendant parfois particulièrement confuse l’insertion d’images d’archives où l’on voit des pêcheurs, des travailleurs ou des gens paumés du Sud de l’Italie, sans qu’on puisse toujours savoir si ces images-là sont de vraies images d’archives venues d’outre-tombe ou des plans documentaires filmés par Marcello aujourd’hui.
En quoi tout cela « rapproche » film et roman ? Ce qui rend le monde inhabitable pour le Martin Eden de London, c’est exactement ce qui lui donne envie d’écrire : que certaines choses ne changent jamais, que la nature humaine fait qu’il y aura toujours des dominants et des dominés, et que ce sont les histoires de ces derniers qui doivent se retrouver dans les pages des livres. Peu de villes au monde auraient pu transmettre comme Naples ce sentiment, que ces histoires sont toujours là, immuables, qu’il faut toujours les raconter, reliant alors le projet de London à celui de Marcello, qui s’était déjà immergé dans le lumpen génois dès son remarquable premier long documentaire, La Gueule du loup. Si cette adaptation d’un « grand roman » peut sembler modeste (nous sommes loin des décors pharaoniques à la Bertolucci), on se tromperait radicalement. Peu de films participent d’une si grande ambition, presque révolutionnaire : on avait toujours cru que le cinéma était l’art de capturer la mort au travail, de figer dans le temps ce qui était éphémère. Avec ses images manipulées, incertaines, qui mélangent temps et textures, Marcello nous montre que c’est le contraire : l’art nous montre ce qui ne change jamais. Rien de plus londonien. Fernando Ganzo