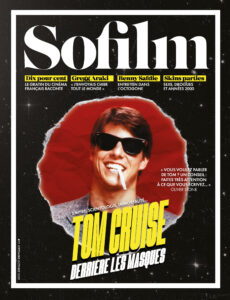Nicolas Winding Refn : « La paternité est le fondement même de la trilogie Pusher »
Pour la ressortie et la restauration 4K de sa trilogie Pusher, dont le premier film est sorti en 1996, Nicolas Winding Refn revient sur ses débuts derrière la caméra, lançant une carrière atypique entre Los Angeles et Copenhague. Bien avant sa collaboration avec des acteurs hollywoodiens et l’explosion de Drive, le Danois jouait avec les codes du film de gangsters pour livrer une œuvre nihiliste, brute et radicale, à redécouvrir d’urgence.
Propos recueillis par Adrien Roche.
Êtes-vous particulièrement fier de vos œuvres de jeunesse, trilogie Pusher comprise ?
Faire des films, c’est un peu comme avoir des enfants. Certes, on en garde des souvenirs très tendres et on les aime beaucoup. Mais parfois… on les déteste et on a un peu envie de les tuer (rires). Voilà ce que je ressens à propos de ces films, c’est une relation d’amour-haine. En y repensant, je me dis surtout que j’ai eu beaucoup de chance quand j’ai commencé. J’ai pu faire ce que je voulais. C’est un vrai privilège. Et puis ensuite, on veut toujours protéger ce qu’on a accompli.
Vous avez donc apprécié le processus de restauration ?
Absolument. Dieu merci, j’ai tourné sur pellicule. On m’a dit que beaucoup de films numériques du début des années 2000 avaient mal vieilli à cause de la technologie et que leur restauration était difficile. Mais comme j’ai utilisé de la pellicule, on a pu retourner au négatif et faire ça correctement. Je suis très content du résultat !
Comment en êtes-vous venu à réaliser un film, alors que ce n’était pas votre métier ?
J’étais déjà dans l’industrie du divertissement. Je travaillais pour mon oncle qui avait une société de distribution et un cinéma à Copenhague, où il projetait en avant-première des films d’auteur. Il bossait déjà depuis de nombreuses années et m’emmenait tout le temps à Cannes, où j’essayais de trouver des films pour sa société. C’était au début des années 90, à une époque où on était encore forcés d’aller physiquement aux projections. On courait dans tout Cannes pour voir des films toute la journée. C’était la meilleure période, pour un cinéphile comme moi. Et à force de voir des films, je me suis mis en tête que moi aussi je pouvais en faire un.
Avez-vous rencontré des difficultés particulières pendant la production ?
Franchement, tout s’est plutôt bien passé. Je veux dire, on n’avait que six semaines, peut-être même cinq, pour faire le premier film de la trilogie. Beaucoup de choses auraient pu mal tourner, mais il n’y a eu aucun problème. Pour les suivants, c’était encore plus facile : tout le monde a accepté de revenir, y compris Mads Mikkelsen que j’ai eu juste avant qu’il fasse Casino Royale. On avait un planning et un budget plus tranquilles, c’était plus détendu.

Pourquoi les gangsters ?
À cette époque, même si le genre au sens large n’était pas encore à la mode, les films d’action et les films policiers se vendaient très bien. C’est ce qui m’a amené à me dire que je devais faire un film de gangsters. En plus, à cet âge-là, quand on est en quête de sa propre masculinité, il y a quelque chose de très séduisant dans le monde du crime. C’est comme ça que le film est né, mais je me suis vite rendu compte que ce milieu était rempli de tristesse : tout n’est que destruction et nihilisme. Ça a été une expérience très profonde de réaliser que ce que l’on projette comme étant du divertissement n’a en fait rien d’amusant — et encore moins de séduisant — dans la réalité.
Pusher a une dimension documentaire, caméra tremblante à l’épaule, et une approche très brute. Était-ce à cause d’une contrainte financière ou d’un choix esthétique ?
Dans le premier Pusher, tout devait paraître très réel. C’était un choix esthétique, dès le départ. J’étais complètement fasciné par ce parallèle entre fiction et réalité.
Quant aux suites, elles sont venues à vous un peu par défaut, puisque vous aviez de gros problèmes financiers…
Oh que oui, absolument (rires) ! À la base, quand une grosse boîte de prod danoise, qui connaissait ma situation, m’a proposé de faire un autre Pusher, j’ai répondu : « Hors de question ! » Mais après y avoir réfléchi et pensé à ma situation financière, je suis revenu vers eux : « Bon, je ne ne vais pas en faire un… Je vais en faire deux ! » (Rires) Ça s’est révélé être une très bonne décision, j’adore ces films.
Comment vous êtes-vous réinventé, alors que vous pensiez en avoir terminé ?
Déjà, quand j’ai fait le premier Pusher, ce genre de films ne se faisaient pas vraiment en Europe. Il y avait des inspirations américaines, mais très peu d’exemples européens. Quand j’ai commencé à travailler sur Pusher 2 et 3, Les Soprano venait d’arriver sur HBO. Cette série a changé la télévision à bien des égards, mais ça montrait aussi le champ des possibles à partir de l’univers que j’avais créé. Je me suis donc mis à considérer Pusher comme un série télé, et j’ai adoré utiliser des personnages déjà établis pour en faire les protagonistes des suites.
Ces personnages sont parfois un peu ridicules, loin des barons du grand banditisme du Parrain ou des Affranchis…
Et c’est normal ! C’est ça, la réalité. Il n’y a pas de « gangster chic » ou de crime joyeux. Je ne voulais pas suivre de grands mafieux, je trouvais la rue plus réelle, avec plus de désespoir. On y vit toujours sur le fil, c’est là que la vie et la mort se croisent chaque jour. Dans ce monde, tout tourne autour de la violence, de la misogynie et de la peur permanente de tout perdre. C’est pas vraiment un endroit dans lequel on voudrait vivre. On peut se laisser séduire par ce milieu dans la fiction, mais c’est parce qu’on en a une vision altérée. En vérité, moi je trouve ça très triste et parfois ridicule. Mais je n’ai jamais voulu juger mes personnages : ils ont des codes moraux qui leur sont propres, éloignés des nôtres, mais qu’ils sont obligés de suivre pour survivre.
En parlant de codes moraux, dans les deuxième et troisième films, la paternité occupe une place centrale. À quel point ce thème était-il important pour vous ?
C’était vital. Ce thème est le fondement même de ces films. On voit très clairement que quand j’ai fait le premier Pusher, je n’avais pas d’enfant. Chose qui a changé quand j’ai fait les suivants. Forcément, j’ai beaucoup puisé dans mon expérience personnelle pour raconter ces histoires. Le deuxième film parle de quelqu’un qui devient père, avec tous les bouleversements que ça implique, tandis que le troisième parle d’un homme qui est déjà père — et qui est presque vu comme un roi. Et pourtant, il reste totalement responsable de sa fille… qui, finalement, se révèle être bien pire que lui.

Vous avez choisi de terminer chaque film sur une note ambiguë : on ne sait jamais vraiment ce qui arrive au personnage principal. Une habitude que l’on retrouve aussi dans Drive.
Je n’ai jamais aimé les fins dans les films — ou dans quoi que ce soit, d’ailleurs. J’ai toujours trouvé les fins étranges. Pourquoi ne pas laisser une porte ouverte ? Pourquoi s’arrêter là ? Au contraire, ça devrait continuer indéfiniment dans la tête des spectateurs, même après avoir quitté la salle.
Votre trilogie est aussi connue pour ses introductions de personnages, avec ces cartons de noms au ralenti. Comment vous est venue cette idée ?
Je l’ai abordée presque comme une pièce de théâtre, comme une tragédie grecque, où les personnages que vous allez suivre sont introduits avec leur image et leur nom. Ça donnait une dimension théâtrale au monde qu’on créait. Parce qu’au fond, je crée des illusions. Je ne suis pas un documentariste.
Le premier film se déroule sur une semaine, le troisième sur une seule journée. Vouliez-vous créer un sentiment d’urgence, transformer vos films en comptes à rebours ?
On peut dire que les trois films partagent une structure similaire. Ils commencent tous par une série de séquences assez éparses – presque comme un documentaire, parce que je plonge le plus profondément possible dans la vie des gens, on les voit manger, aller aux toilettes, dormir… – et puis, après environ 45 minutes, tout tourne autour d’une seule nuit. Ça crée une sorte de compte à rebours, qui accentue la dimension dramatique de l’œuvre.
Dans Pusher 3 – et, dans une moindre mesure, dans les précédents aussi –, on remarque un mélange de nationalités. Il y a des Serbes, des Albanais, des Arabes… C’était important pour vous de montrer différentes cultures ?
Oui, bien sûr. Je pense que toute société moderne bénéficie des interactions multiculturelles. Ayant grandi à New York, j’ai été façonné par le mélange des langues. L’Europe, c’est un peu la même chose. Mais le premier Pusher date des années 1990. Le Danemark n’était pas aussi inclusif qu’aujourd’hui. Donc montrer ce multiculturalisme, c’était encore assez inhabituel.
Cela peut faire penser aux films de gangsters américains, notamment ceux avec des personnages italo-américains. Aviez-vous des influences précises ou des modèles ?
Non, pas vraiment. J’ai juste passé beaucoup de temps avec de vrais truands. D’une certaine manière, ils étaient mon inspiration. Leur présence donnait de l’authenticité et une tonalité particulière aux films. J’ai toujours cherché à coller à la réalité, tout devait sembler réel. Je ne pouvais me fier qu’à ce que je voyais vraiment.
Vous évoquiez votre enfance à New York. À quel âge êtes-vous arrivé là-bas ?
Je suis arrivé aux États-Unis à 8 ans, et j’y ai vécu jusqu’à mes 17 ans. Donc ça fait partie de mon identité, mais Copenhague était l’endroit idéal pour moi à ce moment-là. C’était le bon moment pour faire un film comme ça, dans un endroit qui n’avait jamais vu éclore de films de gangsters. Et puis Hamlet se passe au Danemark, donc vous savez…
Quelle a été la réaction des spectateurs danois au moment de la sortie du film, eux qui n’avaient jamais vraiment vu ce type d’œuvre tourné chez eux ?
Ils ont très bien accueilli Pusher, Dieu merci ! J’ai eu beaucoup de chance, le premier film est arrivé au bon moment, et puis, personne n’avait d’attente. Ça a surpris tout le monde et je crois que sans le savoir, c’est exactement ce que je voulais.
Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ?
Pas du tout ! Le simple fait qu’il sorte en salles était une réussite. Aujourd’hui, il y a tellement de pression… À ce moment-là, j’étais au contraire très naïf et d’une certaine façon, ça m’a donné beaucoup de liberté. L’arrogance de la jeunesse, c’est puissant (rires).
Avez-vous un film préféré parmi les trois ?
J’aime vraiment les trois, c’est difficile d’en choisir un. Mais ce que j’adore dans le troisième, c’est le personnage de Milo. Je l’ai toujours trouvé très intéressant. Dans le premier, Frank est tellement autodestructeur et nihiliste… Dans le deuxième, Mads Mikkelsen est très impulsif, il réagit sans réfléchir, sans comprendre les conséquences de ses actes. Tandis qu’avec Milo, il y a tellement plus de complexité. C’est un roi et un père. C’est probablement celui vers lequel je suis le plus attiré. Quand j’ai terminé le troisième, j’ai en quelque sorte eu le sentiment d’avoir accompli ma mission.

Mission accomplie, mais il y a quand même eu des discussions pour un quatrième Pusher, qui n’a jamais vu le jour…
J’ai en effet eu beaucoup d’idées pour d’autres Pusher, et plusieurs fois eu l’occasion de continuer. Mais après le troisième, je n’ai plus voulu en faire. Ma vie a changé et je suis passé à autre chose. J’ai toujours su que j’aurai envie d’y revenir, sans trop savoir comment. Et ce n’est que lorsque j’ai créé Copenhagen Cowboy pour Netflix que j’ai réalisé que, d’une certaine manière, c’était mon retour à Pusher. C’est presque Pusher 4, en fait, avec quand même quelques éléments de science-fiction par-ci par-là, mais c’est un détail (rires) !
Vous êtes daltonien. Dans quelle mesure cette particularité influence-t-elle votre manière de travailler ?
(Rires) Eh bien elle ne l’influence pas du tout, puisque c’est quelque chose que j’ai découvert après le premier Pusher. J’ai tout tourné sans être conscient de cette spécificité. Je n’ai jamais perçu ça comme un handicap, mais comme une opportunité, parce que ça signifiait que je voyais le monde d’une manière différente.
Imaginons le pire : vous avez de nouveau besoin de réaliser un nouveau Pusher pour rembourser vos dettes. À quoi cela ressemblerait-il ?
Il faudrait vraiment que mes finances soient dans un état catastrophique et que je sois dans une situation désespérée pour que j’en arrive là (rires) ! La vérité, c’est que je ne planifie quasiment rien. Je filme ce que je vois sur le moment, et c’est très dur pour moi de savoir à l’avance à quoi va ressembler mon film. Et je suis incapable de dire à quoi ressemblerait Pusher 4 parce que je n’ai vraiment aucune envie d’y revenir. Quand je réalise, je me demande simplement : « Qu’est-ce qui pourrait être intéressant dans cette situation ? » J’ai rarement une idée précise en tête.
Trilogie Pusher, en salles le 9 juillet.