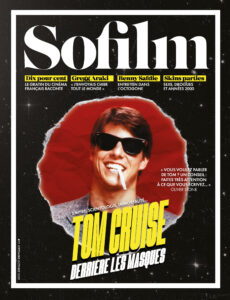Patrice Chéreau : ceux qui l’aiment prendront le train
Patrice Chéreau a monté les pièces de Genet, Marivaux, Müller, Tchekhov, Shakespeare, est devenu le directeur légendaire du Théâtre des Amandiers, avant de se lancer dans la réalisation de dix longs métrages. Cinq d’entre-eux – Judith Therpauve, L’homme blessé, Hôtel de France, Ceux qui m’aiment prendront le train et Gabrielle – ressortent en salles ce mercredi 5 novembre. Retour sur l’évolution de son cinéma, entre ancrage théâtral et mouvements de plus en plus assumés.
Par Tara Canillac
Il y a chez Patrice Chéreau une manière singulière de faire dialoguer théâtre et cinéma, cadre et corps, silence et mouvement. La rétrospective qui sort le 5 novembre 2025 permet de revoir cinq films essentiels, de Judith Therpauve à Gabrielle, et de mesurer à quel point son œuvre n’a cessé de chercher comment capturer les corps et leurs déplacements. Metteur en scène de renom, il choisit aussi de porter son intérêt vers le cinéma. Ses premiers longs métrages sont encore trop empreints de son sens de la théâtralité, qu’il parviendra à dompter. Au fil des années, sa caméra s’affranchit, son découpage s’accélère, son montage devient une respiration nerveuse. Ce parcours, tout en continuité, révèle un artiste hanté par la question du cadre : que doit-il contenir ?
Chez Chéreau, le cadre est d’abord une cage, un dispositif de mise en scène hérité du théâtre. Judith Therpauve en porte encore la trace avec des plans fixes, une distance respectueuse : tout semble ordonné, dominé, comme le personnage principal incarné par Simone Signoret, veuve d’un résistant, rappelée à la direction d’un journal en déclin. Le cadre fonctionne ici comme un théâtre où chaque déplacement devient événement. Judith observe, juge, puis se retire ; la caméra, elle aussi, reste à distance. Mais dans ces compositions d’apparence figées, une faille s’ouvre : des paroles hésitantes, des gestes qui débordent… Le désordre commence à se frayer un chemin. Ce cinéma-là n’est pas encore libéré, mais porte déjà en lui une fougue spécifique aux films de Chéreau. Cinq ans plus tard, L’Homme blessé rompt le pacte de stabilité. Le cadre se dérègle, la caméra se rapproche, le corps envahit l’image. Henri, adolescent fasciné par un inconnu plus âgé croisé dans une gare, devient le vecteur de cette mutation : la caméra n’observe plus, elle s’abandonne. Le cadre n’est plus un espace d’observation, mais un territoire du désir, parfois du danger. Chéreau installe cette lutte entre observation et incarnation, entre mise en scène et débordement des affects. Mais il ne regarde plus, il accompagne. Il filme la passion jusqu’à l’épuisement. Et si Judith Therpauve parlait de maîtrise, L’Homme blessé explore sa perte : celle d’un adolescent, celle d’un cinéaste qui s’aventure dans les marges, à la recherche d’une vérité physique, viscérale.

Dans la langue de Chéreau
Dans Hôtel de France, adaptation de Platonov, la caméra glisse entre les convives, entre les corps et les conversations ; dans Ceux qui m’aiment prendront le train, elle traverse le train, longe les quais, se faufile dans la foule. L’énergie du théâtre se heurte au cadre cinématographique. Chéreau filme la jeunesse de l’époque : bruyante, perdue, déjà condamnée. L’un des traits les plus puissants de son cinéma est la manière dont il filme le collectif. Des troupes, des familles, des groupes en crise. Partout, des liens qui se nouent et se défont. Dans Hôtel de France, la fête est déjà une fin du monde. Dans Ceux qui m’aiment prendront le train, la communauté se défait au rythme effréné du montage. Ce qui relie ses personnages, ce ne sont pas les mots, mais les mouvements : on s’aime, on se fuit, on se retrouve. La parole reste importante, mais elle n’est plus souveraine : elle devient souffle, fragment, écho. La caméra, elle, est à hauteur de peau. On retrouve la fidélité du cinéaste à ses acteurs – Pascal Greggory, Valeria Bruni Tedeschi, Vincent Perez – devenus les corps mêmes de son cinéma. C’est par le désir que la caméra s’anime, par le contact qu’elle se transforme. Il ne filme pas le corps pour le regarder, mais pour le toucher. Comme s’il tentait de retrouver, par la mise en scène, le frisson du théâtre, celui du geste vivant. Et Gabrielle (2005) en est la synthèse. D’après une nouvelle de Joseph Conrad, le récit met en scène un couple bourgeois dont la femme quitte le domicile conjugal, avant de revenir quelques heures plus tard. Le cadre redevient théâtral, mais habité par toute l’expérience que Chéreau a acquise. Il reprend le théâtre pour mieux en faire du cinéma. Les passages muets, les cartons, le grain du noir et blanc rappellent les origines du 7e art, comme si le cinéaste en faisait l’hommage. Gabrielle agit comme une réconciliation entre les origines et la modernité, entre la scène et l’écran. Le film parle d’un amour sans issue, d’une passion étouffée par les conventions, mais aussi du cinéma lui-même : comment filmer la distance ? Comment cadrer ce qui se dérobe ? La caméra, cette fois, ne fuit plus. Elle regarde, patiemment. Chéreau a retrouvé le cadre, mais un cadre qui respire, conscient de sa propre beauté et de sa propre limite.

Revoir ces films aujourd’hui, c’est assister à la construction d’un langage. De la fixité à la mobilité, du théâtre au cinéma, du collectif à l’intime, Chéreau n’a cessé d’inventer une forme pour dire la passion, la blessure, la parole empêchée. Ses acteurs forment une famille fidèle, ses décors un territoire de bruit et de silence. Le parcours de cette rétrospective raconte une quête : celle d’un regard qui, toujours, cherche à filmer la vie au moment où elle échappe.
Rétrospective Patrice Chéreau, cinéaste – ressortie en salles le 5 novembre