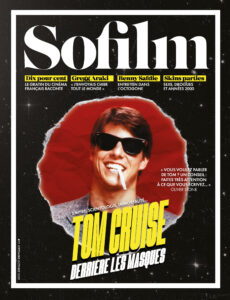Tout ira bien de Ray Yeung
Cinq ans après Un Printemps à Hong-Kong, le cinéaste hongkongais Ray Yeung s’intéresse à nouveau à l’homosexualité au sein d’un couple âgé, prenant cette fois-ci l’angle de la famille. Au croisement de problématiques sociales et économiques, Tout ira bien dessine les lignes de fracture d’une société qui se dit moderne et tolérante. Par Pierre Charpilloz
Voilà trente ans que Pat et Angie filent un parfait amour. Toutes d’eux d’origine modestes, elles ont fait fructifier leur petite entreprise et sont à l’aise financièrement. Mais si elles ne la cachent pas, elles ne font pas pour autant tapage de leur réussite sentimentale et financière. Angie a tout à fait sa place dans la grande famille de Pat. Elle a vu les enfants de sa belle-famille grandir. Dans leur grand appartement hongkongais, Angie et Pat accueillent souvent des repas de famille, et n’hésitent pas à être généreuses, aidant l’un à payer sa voiture, l’autre à trouver du travail. Le conte banal que nous offre Ray Yeung au début de son film est beau et tendre. Pour une fois, l’homosexualité n’est pas un sujet et l’acceptation se fait sans bravade, mais de la façon la plus ordinaire qui soit.
Tout aurait pu durer ainsi. Mais un jour, brutalement, Pat meurt. Progressivement, et sans qu’elle ne s’y attende, Angie est rejetée par sa belle-famille. Derrière son voile de lumière, Ray Yeung laisse entrevoir une face plus sombre de l’enclave libérale de la République populaire de Chine. La tolérance à ses limites. En public, Angie est présentée comme « la meilleure amie » de Pat, et elle n’a pas le droit aux oripeaux du deuil, seuls réservés à la famille, dont elle est de facto exclue. Et lorsque l’héritage s’en mêle, les veilles rancœurs et la jalousie se réveillent. Mais à nouveau, les personnages et les situations développés par Ray Yeung sont loin d’être simplistes. Angie n’est pas la victime irrésolue d’un système impitoyable et indifférent. Pat aurait pu préparer un testament, elles auraient pu se marier à l’étranger. Mais elles ont cru en la bonté du monde, et n’ont pas su voir la misère dans laquelle leur famille s’était engluée. La mise en scène sobre de Ray Yeung le souligne par des détails : dans les scènes extérieures, le son de la ville paraît étouffé, comme si les personnages vivaient dans une bulle. Plusieurs plans nous laissent entrevoir une scène depuis un grillage ou un ornement, à la fois proche et lointain, visible mais séparé. Il faut dire que le Hong Kong que nous dépeint le cinéaste voit la richesse côtoyer la grande pauvreté, dans ce qui peut sembler une parfaite harmonie, tant que l’on reste du point de vue des riches. Passé du côté de cette belle-famille, si on ne va pas jusqu’à l’approuver, on peut comprendre l’avidité soudaine pour l’héritage, seule solution pour se sortir de la détresse financière qui se transmet sur plusieurs générations.
Malgré tout, Angie ne se laisse pas faire. Seule, d’abord, puis avec l’aide d’amies, une sororité lesbienne qui lui apporte tant une aide affective qu’un conseil juridique. Des personnages de femmes de plus de cinquante ans qui n’ont pas peur d’affirmer leur homosexualité, encore trop rares dans le cinéma asiatique. Mais qui disent aussi, comme à l’époque des grandes luttes pour les droits LGBT, que les vraies familles sont celles que l’on se choisit.

Tout ira bien, en salles le 1er janvier.