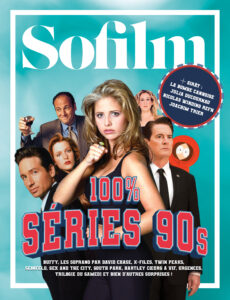Tyler Taormina : « Je voulais parler de souvenirs qui fonctionnent comme des décos de Noël »
Tyler Taormina, nouvelle tête du cinéma indé avec son collectif Omnes Films, retourne dans Christmas Eve in Miller’s Point à sa banlieue natale de Long Island pour une comédie familiale. Sous la forme d’un conte scintillant entre tendresse et nostalgie présenté à la Quinzaine des Cinéastes, il explore la classe moyenne américaine en la poussant à saturation. Par Romain Daum.
Votre précédent film, Ham on Rye, revisitait le genre du teen-movie. Qu’est-ce qui vous a amené à écrire une comédie de Noël ?
On voulait parler des souvenirs d’une famille et assez tôt dans l’écriture du film, nous avons découvert avec les scénaristes que les fêtes de Noël étaient un angle d’approche fécond. On décore vraiment beaucoup nos intérieurs aux États-Unis. C’est presque excessif. Je me demandais quelle était l’utilité de faire ça et je crois qu’on le fait comme une preuve étrange de notre croyance en la vie qu’on mène. Les décos de Noël sont comme les petites zones d’excès qui réaffirment notre besoin de célébrations. Et même nos souvenirs sont comme ces décorations finalement, ces gri-gris too much qui rendent la vie riche et belle alors qu’elles ne sont que des petits détails, rien de plus. On s’est appuyé visuellement sur les peintures de Thomas Kincaid, des images de boites de biscuits qui évoquent une romance kitsch et hivernale. Une imagerie qu’on a aussi cherchée du côté de Tout ce que le ciel permet (Douglas Sirk, 1955) ou encore Maman j’ai raté l’avion (Chris Columbus, 1990). Il y a quelque chose dans la connexion entre les souvenirs et les décorations de Noël qui s’est révélé parfaitement adapté au film.
Ici encore vous faites d’un collectif le personnage principal : qu’est-ce que le groupe permettait d’évoquer ?
Ce qu’on a eu envie de développer, c’est ce moment où la famille devient cette sorte de zone de confort qui demande de savoir à quel stade de notre vie on en est. Quitter la famille ou non ; rester ou tenter de partir. Dans ma génération, c’est de plus en plus courant de rester chez ses parents dans la vingtaine, voire trentaine – ce qui était très rare dans la génération précédente. À la fois ce phénomène augmente et c’est en même temps une source de honte. Et je crois que partir ou rester est le thème dans les deux films mais que, paradoxalement, Miller’s Point qui est une histoire de Noël réfléchit plus précisément au départ. Que ce soit un départ littéral, quand Emily et ses amis explorent la nuit ; ou figuré, avec Kathleen la mère, qui avait pris ses distances avec la matriarche et qui revient. Partir et revenir : c’est ce cycle qu’on a voulu étudier.
Il y a cette scène à la fin du film où un personnage lit un extrait de poème à toute la famille réunie, un texte qui parle du moment où l’on se rend compte qu’on est enfermé dans sa vie…
Lorsqu’on a commencé à rêver aux personnages qui seraient dans le film, j’ai été inspiré par quelqu’un de ma propre famille, un oncle, qui avait passé 10 ans à écrire un livre en secret, à côté de son boulot à la banque. C’est à moi qu’il a décidé d’en parler. C’est une des expériences les plus bouleversantes de ma vie, de voir combien les gens autour de moi qui ne mènent pas une vie créative, ont ces élans en eux vers une exploration spirituelle – je pense que la spiritualité est inhérente à la créativité -, dans notre société américaine pourtant tellement non-spirituelle. Donc c’était naturel, l’idée que la créativité réprimée de ces hommes retombe accidentellement sur le reste de la famille. Et que celle-ci doive s’y confronter se goupillait particulièrement bien avec le casting d’ensemble composé de toutes ces lignes de séparation, ces compartimentations entre les uns et les autres. Ce qui m’intéresse, c’est lorsque ces lignes sont franchies. Personne ne sait comment recevoir l’autre. Et cette aliénation est inhérente à l’être humain, particulièrement dans le capitalisme tardif.

Le sentiment de désenchantement et de désillusion est particulièrement marqué dans la seconde partie du film, malgré son atmosphère magique. D’où vient cette émotion ?
Ce que je peux dire est que le type de films que je fais est caractérisé par les hauts et les bas de ma vie, ceux qui sont très hauts et très bas. Les moments où un peu de magie arrive dans la vie et où je me sens heureux d’être vivant sont… ce ne sont pas des moments très fréquents ! Je pense que mes films reposent sur cette expérience.
Comment avez-vous fait le casting ?
Pour moi le casting est extrêmement long et méticuleux. On a cherché sur le site Backstage parmi des acteurs new-yorkais, parcourant plus de 100 000 profils. Tout ce qu’on se demandait était si ils avaient cette petite magie à l’intérieur d’eux et on s’arrêtait quand on avait trouvé la perle : quelqu’un qui soit vulnérable, beau, qui nous fasse réagir physiquement. Ensuite, on a aussi appelé nos amis et on leur a demandé : « Savez-vous qui pourrait jouer la grand-mère, même un proche, même et surtout quelqu’un de non-professionnel ? » Sawyer Spielberg, Maria Dizzia ou Francesca Scorsese sont arrivés comme ça.
Votre collectif Omnes Film, qui se revendique artisanal et collaboratif, vient à la Quinzaine avec deux films : le votre et Eephus, mis en scène par Carson Lund, votre chef op…
Ce qui nous fédère est un certain type de cinéma qu’on estime fortement, qui selon nous n’est pas défendu aux États-Unis – d’ailleurs, beaucoup de nos premières se font en Europe. On raconte des histoires américaines sur une sorte de déclin culturel, mais dans des formes pas forcément américaines. Nous sommes plus inspirés aussi par la nouvelle vague taïwanaise, le slow cinema et le cinéma d’art des années 60. Mais faire un film Omnes, c’est avant tout travailler avec mes meilleurs amis, dans un espace intime et safe. Accoucher d’une œuvrequi ne soit pas purement transactionnelle, mais qui se vive comme une naissance collective.
Christmas Eve in Miller’s Point (Quinzaine des Cinéastes), prochainement.