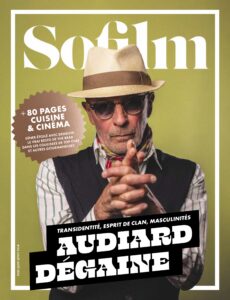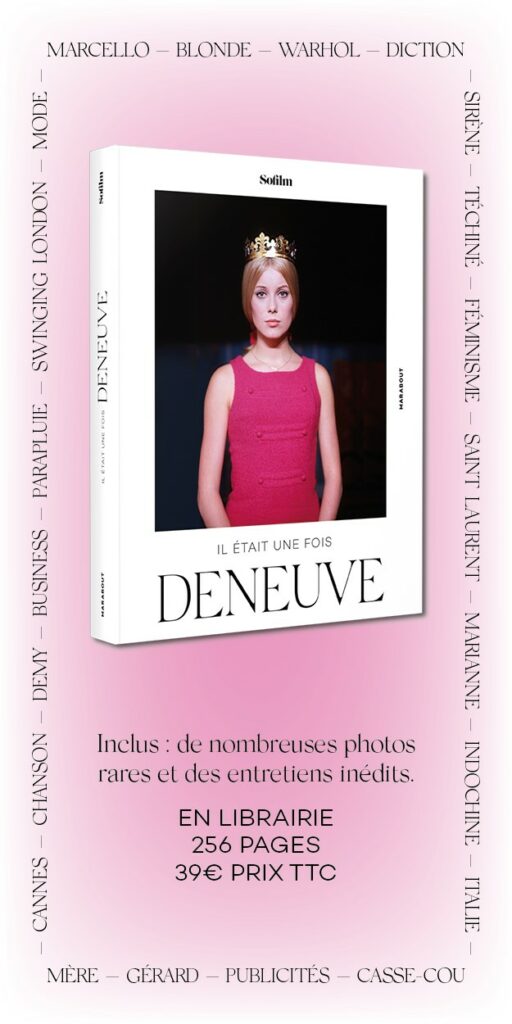EAT THE NIGHT de Caroline Poggi & Jonathan Vinel
Pablo et sa sœur Apolline s’évadent de leur quotidien en jouant à Darknoon, un jeu vidéo qui les a vus grandir. Un jour, Pablo rencontre Night, qu’il initie à ses petits trafics, et s’éloigne d’Apolline. Alors que la fin du jeu s’annonce, les deux garçons provoquent la colère d’une bande rivale… Par Eric Vernay.
Délaissés par leurs parents, Pablo (Théo Cholbi) et Apolline (Lila Gueneau) trouvent dans les paradis artificiels une échappatoire. Pablo est un dealer de MD homo et « indé » qui n’hésite pas à défier la concurrence sur sa moto avec ses produits bio. « Apo », la petite sœur ado de ce descendant havrais d’Omar Little (The Wire), est pour sa part traversée par une mélancolie profonde, car Darknoon, un jeu vidéo en réseau auquel elle s’agrippe depuis des années, va s’arrêter. C’est une question de jours, le final promet d’être flamboyant. Dans cette ambiance pré-apo rythmée par un cinglant compte-à-rebours 2.0 en lettres d’acier, Caroline Poggi et Jonathan Vinel naviguent à vue entre cyber teen-movie, polar (sous) stupéfiants et mélo queer pétaradant, sans craindre les glitchs informatiques dans les virages. On retrouve l’esthétique émo-geek du duo, déjà développée dans leurs courts-métrages puis un premier long (Jessica Forever) plus inégal.
Montée hallucinogène
Avec Eat the night, sélectionné à la Quinzaine des cinéastes 2024, leur moteur hybride carbure encore à plein régime. Dans la première moitié du film, la plus réussie, les deux alchimistes français coupent adroitement l’exploration du monde vidéoludique par Apolline avec un fascinant tuto de fabrication des cachetons produits par son grand frère, sur fond de relation fraternelle semi-incestueuse. L’amant de Pablo, Night, complète ce ménage à trois. Pour parfaire le mélange, Poggi et Vinel n’hésitent pas à tenter des choses, avec un sens de la fulgurance minimaliste dont ils ont le secret : ici, un avatar féminin hypersexué qui, en se faisant égorger 1000 fois d’affilée, figure l’état mental dépressif de la gameuse fan d’heroic fantasy. La scène, aussi virtuelle que saisissante, est plus puissante que n’importe quel morceau doloriste à base d’auto-mutilation en plan-séquence. Plus loin, un colossal porte container traverse lentement le port du Havre, tandis que Night écoute une chanson des Gladiators : la séquence est toute simple, presque anodine, mais loin des habituels fish eyes et autres filtres fluos censés nous faire ressentir la montée psychédélique d’un protagoniste. La stase rasta couplée au jeu d’échelles avec les damiers multicolores au second plan injecte une douce et tenace montée hallucinogène.
Les cinéastes maîtrisent un peu moins la suite, une embardée narco-thriller plus prévisible dans son déroulé tragique et moins crédible dans son interprétation, à l’instar du baron de la drogue local, joué par un blanc-bec dégarni en imperméable beige qui flirte avec le comique involontaire dans son impeccable phrasé Sciences Po. Mais si les greffes stylistiques ne prennent pas toutes, et que certains câbles de branchement semblent parfois court-circuiter le trip, Eat the night maintient sa puissance de trouble jusqu’au bout de la nuit, en hackant méticuleusement les balises sensorielles. Ainsi les pixels du jeu Darknoon ne sont pas accompagnés de musique (contrairement aux séquences IRL) mais finement sound-designés, laissent respirer le vent et palpiter le souffle des avatars mutants, dans de saisissantes accalmies qui paraissent plus « réelles » et crues que le décor urbain, envisagé comme un open world déshumanisé en voie de vitrification. Le règne digital.
Eat the night (Quinzaine des Cinéastes), en salles le 17 juillet.