Euzhan Palcy : « Les histoires de Noirs n’intéressaient personne »
« Donnez un livre à un enfant et vous changerez le monde.» Cette phrase n’a jamais été aussi vraie qu’au moment où la mère d’Euzhan Palcy lui a confié le roman de Joseph Zobel, La Rue Case-Nègres. Elle avait 12 ans. En faire un film est alors devenu une obsession. Première femme à obtenir le Lion d’argent à Venise, première réalisatrice à recevoir un César il y a exactement 38 ans, première femme produite par un studio américain, première (et seule) femme à diriger Marlon Brando, dans Une saison blanche et sèche… Encore trop méconnue dans son propre pays, Euzhan Palcy a pourtant enfoncé de nombreuses portes censées être fermées à double-tour. Avec toujours la même conviction. Mais aussi parfois l’aide de « parrains » comme François Truffaut ou Robert Redford.
Vos films – Rue Cases-Nègres, Une saison blanche et sèche, Siméon – continuent d’être montrés fréquemment à un public qui les découvre pour la première fois. Quelles sont les réactions, en général ?
Le public découvre une culture qu’il ne connaît pas, ça n’a pas changé. Rue Cases-Nègres (1983) fait toujours le même effet. Surtout le personnage du vieux Médouze (interprété par l’acteur sénégalais Douta Seck, ndlr). Le film est entré dans le programme du CNC, « Collégiens au cinéma », en 1984. Et dans les textes des gamins, leurs dessins, leurs interventions, le personnage qui revenait à chaque fois, c’était Médouze. Cet homme africain a fasciné les gamins français des années 80. Certains se sont même mis à reproduire la petite statue africaine qu’il fabrique dans le film !
Rue Cases-Nègres, a été adapté du livre du romancier martiniquais Joseph Zobel. Vous dites souvent que sa découverte a été une révolution ?
Au moment où ma mère me met ce livre entre les mains, j’ai 12 ans. À cette époque, j’étais une enfant turbulente, qui posait beaucoup trop de questions aux adultes. Je m’ennuyais avec les enfants de mon âge, je me sentais à l’aise avec les personnes âgées, surtout avec ma grand-mère. J’avais un cousin de 15 ans qui venait manger chez nous. Il lui arrivait parfois de monter sur la table pour réciter des poèmes entiers d’Aimé Césaire, j’aimais beaucoup. Alors ma mère m’a donné à lire Rue Cases-Nègres, ce qu’elle a fait en partie pour que je tienne en place et que je ne les emmerde pas. Pour moi, c’était un choc culturel. Et puis, c’était en créole aussi, cette langue qu’on nous interdisait à l’école à l’époque de ce que l’on appelait la « carte créole ».

La « carte créole » ?
C’était un rectangle en bois vernis, avec «carte créole» marqué dessus. Chaque matin, en arrivant à l’école, le responsable de classe devait la récupérer. S’il entendait un élève parler créole, il lui donnait la carte. Celui qui avait la carte, devait trouver quelqu’un d’autre qui parlait créole pour la lui passer. Résultat : l’élève qui se retrouvait, le vendredi en fin d’après-midi, en possession de la carte créole, était puni et devait venir à l’école samedi avec pour punition d’écrire cent fois « je ne dois pas parler créole ». Ridicule ! J’ai fini une fois avec la carte créole et, du coup, j’ai pris trois stylos avec la même main pour écrire « je ne dois pas parler créole ». Ça allait trois fois plus vite ! Le pire, c’est qu’avec cette mesure, les parents parlant créole à la maison étaient convaincus qu’en présence des adultes il fallait parler français. Je me souviens d’une fois où je jouais avec une gamine et j’ai dit quelque chose en créole. La fille est allée chercher sa mère : « Maman, maman ! Elle a dit quelque chose en créole ! » Sa mère m’a amenée dans une pièce et m’a laissée seule devant un Christ sur le mur. Et elle m’a dit : « Si tu parles créole, le petit Jésus va te punir. » Il paraît qu’elle m’a surprise devant le Christ, les mains sur les hanches en train de dire : « Petit Jésus, je te parle créole en face, alors punis-moi ! » J’étais terrible!
Et avec Universal, tout s’est bien passé ?
Oui. Tant que Brad Pitt, Bruce Willis et Madeleine Stowe étaient d’accord avec moi sur le montage du film, le studio ne pouvait rien dire. C’est aussi simple que cela. Je m’assure toujours que mes acteurs principaux et moi-même sommes satisfaits du travail accompli. S’ils ne sont pas de mon côté, alors les studios peuvent en profiter.
Qu’est-ce que vous faisiez pour vous amuser avant que votre mère ne vous donne La Rue Cases-Nègres ?
Notre jeu préféré avec ma sœur et mon frère, c’était de faire des costumes pour nos animaux avec des journaux et des défilés de mode ! On déguisait les cochons, les oies, les chiens… Surtout, je posais beaucoup de questions aux adultes, on m’appelait « mademoiselle Pourquoi ». Pour le cinéma, mes parents m’amenaient à la salle paroissiale du village où nous habitions. Le dimanche, après la messe, il y avait des séances pour les enfants. Si tu avais été sage, on te laissait y aller, mais pour moi ce n’était pas suffisant. Je voulais aussi voir les films que mes parents allaient voir quelques fois en semaine après dîner. Ils se mettaient sur leur trente-et-un, avec le parfum de ma mère, les chaussures bicolores de mon père… et on nous envoyait au lit, nous laissant avec Michelle, une fille plus âgée que mes parents avaient adoptée. Sauf que je m’enfuyais et les suivais. Une fois à mi-chemin, je me faisais voir. Ils étaient très fâchés, mais ils ne pouvaient plus me ramener à la maison, ils auraient raté le film. « Tu viens mais ce n’est pas un film pour les enfants ! » Dans la salle, il y avait monsieur Maurice, qui louchait et déchirait les billets. Comme il aimait beaucoup mon père, il me laissait rentrer alors que j’étais mineure. Assise entre mes parents, c’est comme ça que je regardais les films. Et s’il y avait un baiser, ma mère me cachait les yeux !

Il y a un film qui vous a particulièrement marquée, enfant ?
Je me rappelle d’un des Docteur Mabuse de Fritz Lang et, en particulier, cette scène où une voiture avance à toute vitesse. À un moment donné, la voiture passe par-dessus l’écran, ça faisait un effet extraordinaire. Aujourd’hui je sais que c’est très simple : on fait une tranchée, on met la caméra, et la voiture roule par-dessus. Mais pour l’enfant que j’étais, c’était fascinant ! Je me suis levée et j’ai dit à mes parents : « Mais comment ils ont fait !? » J’aimais les histoires des films, mais je voulais comprendre la technique, les trucages… Sauf qu’il n’y avait pas d’école de cinéma, rien, personne ne savait comment l’expliquer.
C’est la lecture de La Rue Cases-Nègres qui vous a donné envie d’en faire un film, ou vous vouliez déjà faire du cinéma ?
À dix ans, je savais que je voulais faire ça, je ne savais pas si ça s’appelait être réalisateur ou quoi, mais je disais : « Je veux faire ça. » Ma famille me répondait : « Mais tu veux être actrice ? » Et moi : « Mais non ! Je veux FAIRE ça ! » Les gens se moquaient de moi. L’année avant mon bac, une journée a été organisée avec des représentants de tous les métiers, pour qu’on puisse discuter. Mais moi, je n’y trouvais personne qui pouvait me parler de cinéma. J’avais mon scénario adapté de Zobel, je me faisais envoyer des livres sur le cinéma depuis Paris. Quand on annonçait à la radio que des stars venaient présenter un film à la Martinique, j’allais voir. Une fois, j’ai appris qu’un technicien et réalisateur qui enseignait à l’IDHEC et avait écrit un livre dans la collection « Que sais-je ? » sur les techniques du cinéma, Vincent Pinel, venait présenter un film. Je suis allée le voir et je l’ai attendu dans la cour. Je lui ai dit « Excusez-moi, monsieur, je veux faire du cinéma mais je ne sais pas comment faire. Quel conseil pouvez-vous me donner ? » Je lui ai parlé du roman, de mon scénario. Il m’a demandé mes coordonnées pour m’envoyer son livre et m’a donné les siennes : « Quand tu iras à Paris, tu me préviens et je te guiderai. » J’ai lu ce livre et c’est là que j’ai acquis des connaissances techniques sur l’écriture et la mise en scène. Et j’ai changé mon scénario, prévu comment le filmer. Le film était alors enfin dans ma tête.
Plus qu’une vision, on parle d’une obsession, non ?
Oui, à tel point même que je dormais avec le livre! Plus tard, quand le scénario a obtenu l’avance sur recettes à l’unanimité, je n’avais pas de producteur, rien. Et même avec l’avance, personne n’en voulait ! Ma copine de chambre à Paris, qui allait à l’ENS, me dit un jour : « Tu sais, dans ma classe il y a Laura Truffaut, la fille du cinéaste, je vais te la présenter ! » Elle savait que Truffaut était pour moi comme un mentor spirituel. Bref, un jour elle fait venir Laura dans notre résidence pour qu’on se rencontre, celle-ci me de- mande le scénario : « Je vais le donner à François. », – elle appelait son père François. Un jour, je reçois un coup de fil de Suzanne Schiffman, la partenaire d’écriture de Truffaut : « Monsieur Truffaut veut vous voir. » Je vais aux Films du carrosse et je vois cet homme, pas très grand, avec des yeux perçants qui me demande de m’asseoir et me dit : « Mais vous avez adapté ce livre merveilleusement, il y a une grande maîtrise, on voit les personnages, l’avance sur recettes est méritée. » Je lui ai dit : « Merci beaucoup mais sachez que personne n’en veut. » Il m’a donné deux-trois contacts. Ces gens m’ont reçue grâce à sa recommandation mais m’ont tous dit : « Bon, dommage, c’est une histoire qui n’est pas pour nous. » Je suis revenue voir Truffaut pour lui communiquer ces refus. Et je me suis rendu compte en voyant son visage qu’à ce moment même, il venait de comprendre pour la première fois ce qu’était le racisme. Il a alors accepté de faire pour moi quelque chose qu’il avait toujours refusé : figurer en tant que « conseiller technique ». Ça a été décisif pour que le film existe.
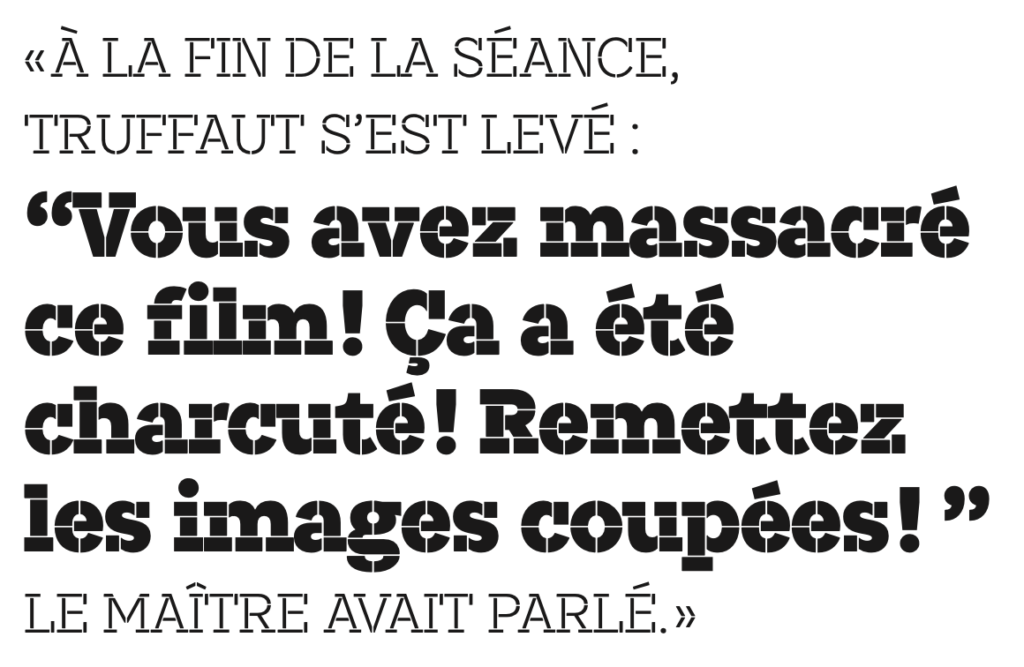
Il a aussi suivi le travail après le tournage ?
Il m’a même été très utile ! Un des producteurs, un vrai tordu, voulait couper le film. Avec notre monteuse Marie-Josèphe Yoyotte, grande monteuse qui était antillaise, on était arrivées à un montage qui faisait 1 h 46 et ce producteur voulait encore réduire la durée du film à 1 h 30. On a été obligées de le faire. Mais à ce moment-là, j’ai appelé François Truffaut. Il a exigé une projection, en présence du producteur, du distributeur, de Yoyotte et de moi, pour voir le nouveau montage. À la fin de la séance, Truffaut s’est levé : « Vous avez massacré ce film ! Ça a été charcuté ! Remettez les images coupées ! » Le maître avait parlé. On s’est regardées avec Marie-Josèphe, on était ravies!

Quel souvenir gardez-vous de la première fois où votre famille a lu « réalisé par Euzhan Palcy » sur un grand écran ?
Évidemment, le sourire de mon père ! Surtout qu’il avait toujours été là, il croyait en moi, il venait au tournage. Il disait à ses collègues : « Ma fille est partie parce qu’elle veut faire des études du cinéma », et on lui répondait : « Mais tu es fou ? Elle va être actrice ? », « Mais non, elle va réaliser des films ! – Ça va être dur, elle va sûrement devoir coucher avec tous les Blancs à Paris pour y arriver. – Non, ma fille elle ne couche pas ! » Mon père m’a toujours dit qu’il s’en serait voulu toute sa vie s’il m’avait empêchée de partir, et que me soutenir a été un acte militant pour son pays.
Le film a aussi été très important pour Darling Légitimus, qui joue le rôle de la grand-mère, M’mam Tine, et qui a obtenu le Prix de la meilleure actrice à Venise, à 76 ans.
Elle avait joué dans 152 films. Toujours de petits rôles de bobonne, de cuisinière, de prostituée, de danseuse, de concierge, par exemple, dans Le Dernier Tango à Paris. Après le festival, on est allées à l’émission d’Elkabbach, et on parlait justement de ça, quand Jean-Claude Brialy (qui avait dirigé Légitimus dans Églantine, ndlr) est passé par hasard sur le plateau. Ils se sont souvenus du tournage, puis Elkabbach a demandé à Brialy : « Et quel rôle jouait-elle ? » Brialy : « Eh bien, elle jouait Lolo, la nounou. » Et là, le grand froid ! Il était mal le pauvre, il ne s’était jamais posé la question. Darling, tout le monde l’adorait. « Elle a du talent Darling ! Elle est bien sympa ! Elle sait chanter en espagnol, elle danse sur les plateaux ! » Mais elle a eu un rôle, un seul, le 153e, qui lui a donné sa consécration. Après, on voulait l’engager pour plein de rôles. Mais elle ne pouvait pas, elle était trop vieille, elle ne pouvait pas marcher. Et c’est resté son dernier rôle. Le bouquet : quand elle est décédée en 1999, on a oublié de la mettre dans les hommages à la cérémonie des César ! Alors qu’elle était la doyenne des comédiens disparus !
Le poète martiniquais Aimé Césaire a également eu une grande influence sur ce film. Comment êtes-vous entrée en contact avec lui ?
Eh bien, j’étais jeune et culottée, alors je suis allée le voir à la mairie de Fort-de-France. Pour faire la queue, je me suis pointée là à 4 heures du matin. Quand je suis arrivée devant lui, je lui ai dit : « Vous ne me connaissez pas, mais je connais vos poèmes. C’est grâce à vous que je vais partir faire du cinéma, un certain type de cinéma. » Et c’était vrai : quand je lisais sa poésie, je sentais dans ses mots cette rage, cette révolte, ce combat… Le volcan qui était en moi. J’avais déjà tourné mon premier film, La Messagère (1976), que j’ai fait avec l’aide de ma famille, qui joue dedans, et il l’avait vu. « Maintenant, j’ai tout à apprendre, alors je vais partir, mais pas avant de vous avoir dit merci de m’avoir nourrie, philosophiquement, intellectuellement, politiquement, humainement. » Quand j’ai eu fini, j’ai vu de petites larmes qui coulaient de ses yeux. Il m’a dit : « Attendez », et il m’a fait un chèque. Je lui ai dit que je n’étais pas venue pour ça. « Acceptez, je vous en supplie. On n’est jamais trop riche quand on est étudiant à Paris, j’en sais quelque chose ! » Ce chèque, je l’ai gardé pendant des mois et des mois, comme une relique. Et je suis partie avec en France. J’ai intégré l’école Louis-Lumière, et mon père a insisté pour que je m’inscrive aussi en même temps en lettres à la Sorbonne, parce que si j’échouais, au moins j’aurais un plan B. En plus, ça pouvait m’aider pour mon écriture. Un jour, il y a eu une grosse grève et tous les chèques et mandats qui arrivaient par courrier étaient bloqués. Dans ma résidence universitaire, on était quatre Antillaises. Comme mes amies étaient très inquiètes, je leur ai dit : « Écoutez, on a de l’argent, on va encaisser le chèque ! » Et il nous a nourries toutes les quatre pendant la durée de la grève. Quand j’ai raconté ça à Césaire des années plus tard, il ne se souvenait même pas de ce chèque ! Par la suite, il a fait voter le conseil municipal pour ajouter au budget du film les 400 000 francs de l’époque qui manquaient. Sans ça, je n’aurais pas pu tourner.

Vous avez senti une ouverture après le succès du film en France ?
J’ai vu comment on ne voulait pas du scénario de Rue Cases-Nègres, comment Cannes n’a pas voulu du film, comment Venise l’a accepté et comment on y a remporté quatre prix dont le Lion d’argent (ainsi que la Coupe Volpi de la meilleure actrice pour Darling Legitimus, ndlr). Le premier acheteur intéressé était japonais. Quand le film sort, c’est un carton, on le considère comme un classique. Je suis contente, je me dis que c’est une porte qui s’ouvre. Je suis naïve. Évidemment, tous ceux qui m’avaient refusée viennent vers moi, sans aucune gêne, pour essayer de capitaliser dessus. Vous imaginez ? Ils se disaient : « Il y a un tocard qui a accepté de prendre des risques, maintenant on va surfer sur cette vague. » J’ai dit « niet ». Et les nouveaux projets que je proposais étaient refusés. Tout le monde voulait en gros un Rue Cases-Nègres 2. Moi, je leur disais : « Mais, c’est pas Dallas ! » Je me suis dit qu’il n’y avait plus d’espoir. Quelqu’un de la télévision française – je ne dirai pas qui – a dit à un producteur canadien qui s’intéressait à un de mes projets qu’il devait laisser tomber : « Quand les gens voient un visage “bronzé”, ils zappent. » Et pourtant, à chaque fois que je raconte ce genre de chose, on me dit : « Mais, vous exagérez, vous êtes parano. » Donc maintenant je ne parle plus de ça, j’agis.

Est-ce que c’est pour agir, comme vous le dites, que vous partez à Hollywood pour faire Une saison blanche et sèche ?
À l’origine, Warner m’a envoyé cinq lettres pour me demander de venir tourner chez eux. Au début je ne voulais pas, je disais que j’étais occupée. Je n’osais pas dire la vérité : Hollywood me faisait peur. Surtout, j’étais très marquée par le récit de Diane Kurys qui, après le succès de Diabolo menthe, est partie travailler là-bas pour revenir folle de rage un an plus tard, et qui racontait que leurs méthodes de travail n’étaient pas compatibles avec les nôtres.
Vous parliez de l’importance de François Truffaut pour votre carrière. Peut- on considérer que Robert Redford a aussi été l’un de vos « parrains » ?
Oui, quand il a sélectionné Rue Cases-Nègres pour représenter la France à Sundance. Il avait une gamine, Amy Redford, 15 ans à l’époque, présente à chaque projection. Paul Newman, Karl Malden, Mike Nichols et Morgan Freeman – qui n’était pas la star qu’il est aujourd’hui – ont aussi vu le film grâce à Redford. De cette période, je garde une photo, où je suis entre Newman et Redford qui me tiennent par la taille : les deux blonds, les deux chouchous d’Hollywood, et moi au milieu avec mes nattes ! Redford l’a fait encadrer dans son bureau. Le film avait touché beaucoup de gens aux États-Unis, et certains venaient me proposer de faire des dons pour aider des gamins comme celui du film. Moi je leur répondais : « Vous savez ? Il y en a beaucoup comme lui à Harlem ! »

L’engouement américain qu’a connu le film n’a-t-il pas creusé un fossé encore plus grand avec la frilosité que vous ressentiez en France ?
Le problème c’est qu’à Hollywood, ils me voulaient mais pour faire leurs films à eux ! J’ai dû refuser quelque chose comme 200 scénarios ! Spielberg m’avait proposé un film qui aurait pu me plaire, My Child Is Lost, un projet « black », mais j’étais en train de tourner ma série sur Césaire, qui m’avait laissée rentrer dans son intimité, et je ne pouvais pas arrêter ça. Pendant deux mois, je me suis fait un ennemi en la personne de mon agent, qui ne comprenait pas : « Mais comment tu peux dire non à Spielberg pour aller faire un truc avec… comment il s’appelle déjà ? Aimé “César” ! » Je disais non à tous les projets, mais bon, c’étaient toujours des projets de Blancs !
Vous êtes malgré tout la cinéaste française qui a eu la plus longue relation avec les studios américains, même si plusieurs de vos projets de films ne se sont jamais tournés. Pour quelles raisons ?
Cela tient certainement à cette particularité des studios là-bas : ils changent constamment de responsables. Quand une nouvelle direction arrive dans un studio, ils changent tous les meubles, littéralement, dans leurs bureaux. Et ils font pareil avec les scénarios, ils ne veulent surtout pas porter un projet de l’ancienne équipe. Ça m’est arrivé quatre fois. Mais ça, c’est Hollywood. À part ça, j’ai réussi à imposer mes méthodes avec les cinq studios avec lesquels j’ai travaillé. Et je mentirais si je disais que mes films faits là-bas sont moins miens, que ceux que j’ai faits en France. En tout cas, j’ai toujours obtenu le final cut et tout ce que j’ai demandé.
Que s’est-il passé avec votre projet de biopic sur Bessie Coleman (pionnière de l’aviation, première Afro-Américaine à détenir une licence de pilote, ndlr) ?
On me disait : « Mais elle a vraiment existé ? – Mais oui, voilà des photos, des preuves. – Oh, mais c’est incroyable cette histoire ! Extraordinaire ! » Et quand je dis : « Alors, on a un deal ou pas? », on me rétorque : « C’est un peu dur, les gens n’iront pas voir ça parce que le personnage principal est une femme noire. » L’exécutif qui m’a sorti ça était juif, je lui ai demandé comment il se sentirait s’il avait un projet de film et qu’on lui disait : « Oui, mais ce personnage juif, ça ne va pas marcher… » Cela lui a permis de prendre la mesure de l’humiliation que peut res- sentir tout un peuple incapable de se voir sur les écrans du monde juste à cause de la couleur de sa peau. Vous imaginez si on inversait les rôles ? On se poserait la question de savoir si l’histoire d’un homme blanc va marcher auprès du public afro ou latino? Ils savent pourtant que s’ils font un bon marketing et si le film est bon, il marchera. Mais malgré ça, les histoires de Noirs n’intéressaient personne.
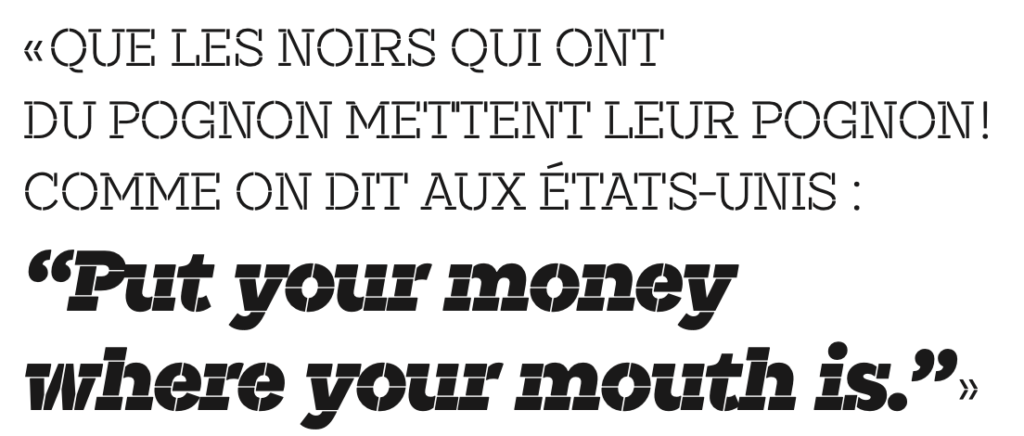
Quelle serait la solution ?
Que les Noirs qui ont du pognon mettent leur pognon! Comme on dit aux États-Unis: « Put your money where your mouth is. » Il faut arrêter d’attendre que cela vienne des Blancs. Il faut créer les choses, arracher des choses, les réinventer. Et d’abord tous les milliardaires noirs américains devraient soutenir leurs créations. Dans les années 80, je suis allée voir Quincy Jones, Eddie Murphy, Bill Cosby, ceux qui avaient de l’argent. Je leur ai dit : « Vous devriez mettre votre pognon, avec d’autres comme Oprah, acheter un studio, il y en a vingt en vente ! » Bill Cosby m’a dit : « Mais non, c’est compliqué, si on achète un studio, les Blancs ne vont plus vouloir travailler avec nous. – Mais vous seriez les patrons ! Vous ouvrirez les portes aux Blancs, vous serez les producteurs ! »
Votre idée, c’était de créer une sorte de United Artists afro ?
Exactement, et j’ai fait toutes les villes, dans les années 80, j’ai parlé à ces messieurs. « Vous préférez rester assis dans les couloirs, à at- tendre qu’ils vous appellent, qu’ils en acceptent un, le pressent pendant vingt ans, et quand il sera has-been, qu’ils disent “next !” ? » Ils avaient Eddie Murphy, quand ils en ont eu marre, ils ont créé Will Smith. Et quand Will Smith a commencé à fatiguer, eh ben ils ont eu Michael B. Jordan. J’ai essayé d’analyser la raison pour laquelle Hollywood procède de cette manière, pourquoi ils n’ouvrent pas carrément les portes à tous ces talents. Parce que c’est con ! À chaque fois qu’ils ont un acteur noir dans un film, ça cartonne! Ils font de l’argent! Et ils adorent ça, l’argent !
À juste titre, vous êtes reconnue par des figures-clés du cinéma afro-américain contemporain, comme Ava DuVernay.
Elle me fait rire, quand on lui parle de moi elle dit : « Don’t even talk about The Goddess ! » J’aurais aimé en avoir d’autres avant moi, qu’on m’ouvre la voie, mais je suis toujours reconnaissante quand j’entends ça de sa part, comme de la part de Amma Asante (réalisatrice de Belle, ndlr), de Julie Dash (Daughters of the Dust), de Shonda Rhimes (showrunneuse de How to Get Away with Murder, Grey’s Anatomy, ndlr)… Quand on me dit : « Si on existe, c’est parce que tu as existé, toi»… Mais c’était pénible. J’ai toujours eu l’impression de prêcher dans le désert : « Elle est bien sympa, mais bon, ce cinéma de Noirs… »
Ce système-là, serait-il en train de changer ?
À mon avis, l’arrivée des plateformes comme Netflix, Amazon, Hulu est en train de faire tout péter. Leurs décideurs ont besoin de content, et ils s’en foutent de la couleur de votre peau, de votre genre ou de votre religion. Si l’histoire est belle, ils donnent de l’argent, ils s’en fichent : ils inondent le monde avec. Le résultat de ce changement, c’est que les studios sont devenus un peu moins arrogants. C’est la quantité qui fait changer les choses, parce qu’il y a tellement de films afro qui marchent ! Avant on pouvait dire « bon, c’est un accident ! », mais quand ils en ont eu cinq, six, sept, dix dans les dents, la même année, que ça marche et qu’ils voient les plate- formes arriver, ils se rendent compte qu’ils vont perdre de l’argent s’ils n’ouvrent pas les portes. Et avec la révolution des femmes, de Time’s up, la suite des scandales Oscars So White, Oscars So Old, tout ça ensemble a eu un effet. Ils ont déjà licencié 80 % des mecs qui étaient à la tête des studios pour les remplacer par des nanas.
C’était le refus de vos films personnels de la part des studios américains qui vous a été le plus pénible ?
Ce qui m’a fait le plus de mal, c’est que les gens ne comprenaient pas que je dise non aux projets qu’ils me proposaient ! Je me di- sais, intérieurement : « Donc vous me voulez, mais vous ne voulez pas de mon bébé, et, en plus, vous voulez que j’allaite le vôtre ! » Ça me fait d’au- tant plus mal que je viens d’un pays censé être le pays des droits de l’homme. Lors d’une conférence de presse, ici, à Paris, on m’a posé cette question : « Mais, écoutez, quand est-ce que vous allez faire de vrais films? » Je vous le jure. J’ai dit : « Pardon ? » « Oui, enfin, je veux dire faire aussi des films avec des Blancs, pas juste avec des Noirs. » J’ai répondu : « Vous avez demandé à Akira Kurosawa ou à Satyajit Ray quand est-ce qu’ils vont faire des films avec des Européens ? Vous ne vous le permettriez jamais ! » Il y a plein de sujets qui sont tabous pour nous. On ne m’a jamais donné les moyens de faire mon film sur Toussaint Louverture (ancien esclave devenu chef de la révolution haïtienne, première république noire en 1804, ndlr) mais je le ferai de toute façon. Et un jour, on s’étonnera que la France ne l’ait pas produit…
Vous regrettez d’être rentrée en France après Une saison blanche et sèche ?
Je suis revenue parce que je voulais faire des choses en France, maintenant que j’avais fait mes preuves. Mais quand j’ai sollicité une aide pour un scénario sur la Seconde Guerre mondiale racontée du point de vue des Antillais, on m’a refusé l’aide à l’écriture. Pas l’avance sur recettes, ce qui peut arriver, no problem. Mais l’aide à l’écriture ! Parce qu’on estime qu’on « ne voit pas la Grande Histoire dans la petite ». Ça, c’est horrible ! Ça dit tout. On n’existe pas. Notre histoire, il ne faut pas en parler. Quand je vis des choses comme ça, ça me fait mal, parce que nous aimons tellement cette France, mais elle nous blesse. J’ai ressenti la même chose à 10-15 ans, quand j’allais au cinéma : la salle plongeait dans l’obscurité, le rideau s’ouvrait et le film, que j’adorais, nous excluait. Il fallait que j’en fasse quelque chose, que cette colère soit créatrice, que je ne devienne pas raciste. Avec ma caméra, j’ai essayé de réparer les conneries de l’histoire, modestement. Regardez Une saison blanche et sèche. Au départ, j’étais censée faire ce film avec la Warner. Sauf qu’après la sortie de Cry Freedom (Richard Attenborough, 1987), la Warner a décidé que deux films sur l’apartheid, c’était trop. Je leur ai demandé : « Combien de films vous produisez chaque année sur la guerre du Vietnam ? » J’ai dû me battre pour arracher le scénario et le faire produire par la MGM.

C’était la première (et dernière) fois que Marlon Brando était dirigé par une femme.
Donald Sutherland non plus n’avait pas été dirigé par une femme. Et après il ne voulait qu’être dirigé par des femmes ! Brando, il a joué gratuitement. Il a signé le contrat, et il a demandé à ce que son cachet soit attribué à cinq associations anti-apartheid une fois le film amorti. Et c’est exactement ce que le studio a fait.
Vous avez fait le film aussi parce que vous étiez choquée par la situation de Nelson Mandela ?
Au moment de faire le film, il était en prison, et je tenais vraiment à me battre contre cette injustice qu’était l’apartheid. Même si je ne suis pas Sud-africaine, je suis une militante des droits de l’homme, je suis contre tous les « ismes ». Je ne peux pas être témoin d’une injustice et rester sans rien faire. En tant que cinéaste, je pouvais en faire quelque chose. Mais si j’avais vécu par exemple à l’époque de la Shoah, j’aurais fait un film pour dénoncer cet autre crime contre l’humanité. Ceci dit, je discutais une fois avec des Juifs et j’ai dit que l’apartheid et l’esclavage étaient des crimes contre l’humanité. Et on m’a dit : « Bon, attention, ce n’est pas la même chose, vous on vous a simplement déportés. » J’ai répondu : « Écoutez, on ne va pas voir qui a les bobos les plus grands. » On ne peut pas quantifier les souffrances, ce sont des crimes contre l’humanité. Des familles arrachées, des gens jetés à la mer parce qu’ils vomissaient et qu’il ne fallait pas qu’ils contaminent la cargaison entière. Ça a duré six siècles ! Je suis désolée, mais l’Afrique a été vidée de ses forces vives. Je suis métissée, mais de tous mes métissages, celui qui me bouleverse le plus, c’est mon côté africain. Parce que c’est le plus méprisé, le plus occulté. Quand l’Afrique se comporte mal, ça me blesse, mais quand son génie s’exprime, je le crie haut et fort. Je me battrai toujours pour elle et contre l’afro-pessimisme, « l’afro-dénigrement » comme disait Césaire.
Comment avez-vous été accueillie par les Sud-africains ?
Bon, déjà, je n’ai pas tourné là-bas, parce qu’on m’aurait tuée. J’ai tourné au Zimbabwe et à Londres, dans un studio, pour les scènes du tribunal avec Brando. Le tournage a été un peu secret, pour protéger la vie des Sud-Africains qui jouaient dans le film. Quand il est sorti, il a évidemment été banni immédia- tement là-bas. Après, Mandela est sorti de prison et a été élu, en 1994. Le jour de son premier anniversaire comme président, il m’a reçue dans son pays. Il était vraiment surpris que quelqu’un ne venant pas d’Afrique du Sud et n’ayant pas vécu ce qu’ils avaient vécu ait fait un film si précis. Je suis restée une semaine, pendant laquelle on a beaucoup rigolé. Je lui ai posé des tas de questions, mais il s’est éclaté ! J’avais vraiment l’impression au bout de plusieurs jours qu’il se lâchait. Pendant ce séjour, j’ai filmé une demi-heure d’entretien avec lui. J’en ai tiré un tout petit film, d’à peine deux minutes et demie, sur le rôle de la femme. Ma question était très simple : « Est-ce que vous souscrivez à l’idée selon laquelle quand on éduque un homme, on éduque un individu, mais quand on éduque une femme, on éduque une nation ? » Mandela développe ça de façon magistrale, en à peine deux minutes.
Coco la Fleur de Christian Lara (1979) et votre film Rue Cases-Nègres sont respectivement les deux premiers longs métrages de Guadeloupe et de Martinique. Quelle évolution du cinéma aux Antilles notez-vous depuis ?
Il faut une volonté politique pour former ces gens qui veulent faire du cinéma, qui partent dans l’Hexagone, mais n’y arrivent pas parce qu’ils n’ont pas d’argent. Résultat : ils finissent par faire autre chose parce qu’il faut bouffer. Il faut leur permettre de travailler avec des professionnels. Pour l’instant, je leur dis : « Partez, cherchez la connaissance là où on veut de vous. Mais souvenez-vous d’où vous venez, qui vous êtes. Et revenez, formez d’autres gens, partagez ce savoir acquis. » C’est ce que j’ai fait, par exemple, avec Moly Kane. Moly était un garçon qui a cherché à me rencontrer lors d’un passage au Sénégal. Il est unijambiste, personne ne lui donnait sa chance, mais il voulait faire des films. Pour lui, le handicap n’était pas dans son corps mais dans le regard de l’autre. Il m’a dit exactement ce que j’attendais d’un jeune : « Je veux apprendre. » Je l’ai envoyé, aux Antilles, à l’université, et je l’ai emmené avec moi voir des films, discuter, je l’ai formé. Il écrit ses scénarios, il a déjà fait quatre courts métrages et développe son premier long. Ce garçon aujourd’hui a créé le premier festival du court métrage à Dakar. Je le considère comme mon fils spirituel. Il n’avait rien. La première fois qu’il est venu à Paris, je l’ai gâté, il est parti avec trois valises de vêtements. Une fois au Sénégal, il a tout distribué ! « Mais garde au moins ton costume de Cannes ! » Le problème c’est qu’il a grandi depuis ! Alors il va offrir ça à quelqu’un de plus petit que lui. Qu’il puisse venir aussi à Cannes.
Cannes a justement révélé Ladj Ly avec Les Misérables (Prix du jury 2019 ex-æquo, ndlr), représentant la France aux Oscars, et nommé dans plusieurs catégories des César 2020. Votre César du meilleur premier film pour Rue Cases-Nègres, en 1984, c’était un moment pionnier, non ?
Oui, je suis la première femme à avoir reçu un César. Première femme, point barre, pas « femme noire »… Avant qu’il y ait une seule réalisatrice blanche césarisée, il y avait Euzhan. Mais personne ne le sait ! C’est le CNC qui l’a rappelé l’année dernière pour l’anniversaire du film. « Hommage à la pionnière… » Mais on ne m’a jamais invitée aux César pour remettre un prix à quelqu’un, hein… Pour Les Misérables, c’est fabuleux. J’es- père surtout que ça servira à faire prendre conscience à ceux qui ont le pouvoir et l’argent que ces cinéastes sont là, et qu’ils existent. •
Entretien à retrouver dans Sofilm n°77 !


