Fabrice Arfi : « Il y a parfois plus de vérité dans une œuvre de fiction que dans un document. »
Woerth-Bettencourt, Karachi, Sarkozy-Kadhafi, Cahuzac… Autant de grandes affaires qui n’auraient peut-être pas éclaté sans Fabrice Arfi, coresponsable du service enquêtes de Mediapart. Et il serait présomptueux de vouloir le prendre en défaut sur les grandes œuvres qui racontent « ce que peut le journalisme ». De The Wire aux Hommes du président en passant par Spotlight… Décryptage au cordeau, dans le respect du secret des sources bien entendu.
Votre livre-enquête sur l’arnaque à la taxe carbone (D’argent et de sang, paru au Seuil en 2018) est adapté par Xavier Giannoli en série, sur Canal + le 16 octobre. Comment s’est passée la collaboration ?
En fait, quand j’ai commencé à écrire sur l’histoire du carbone pour Mediapart en 2016, Xavier Giannoli a souhaité que l’on se rencontre. On a sympathisé et on a pris l’habitude de déjeuner ensemble de loin en loin. On avait en commun l’amour du cinéma de Scorsese dont le côté moral et un peu chrétien rejoint, je crois, son cinéma. Et c’est lui qui m’a fait découvrir le journal de John Boorman (édité par Actes Sud / Institut Lumière). À un moment, Boorman parle des Affranchis et livre une théorie hyper intéressante que je cite en clin d’œil à Xavier à la fin du livre (« Le scénario s’acharne à démontrer que les personnages sont dépourvus de vertus rédemptrices, qu’ils sont cruels, implacables, impitoyables, brutaux […]. Pour le public, il en résulte un certain malaise. Devant une telle réussite, on ne peut être que séduit. Nos jugements moraux s’effondrent. On s’identifie. Mais Goodfellas va plus loin encore : on devient ces personnages et on commet leurs crimes […]. Le malaise profond que l’on éprouve lorsque l’on s’identifie à un scélérat vient de ce que l’on se rend compte qu’on n’est pas l’abri de semblables scélératesses », ndlr). Scorsese nous montre une réalité fascinante, mais c’est comme s’il appuyait parfois sur le bouton pause pour nous dire : « Ah, ah ! Regardez ce que vous aimez ! »
Est-ce que l’écriture de la série a changé votre regard sur l’affaire ?
La série m’a permis de découvrir ce que peut la fiction vis-à-vis du journalisme, ce qui n’est pas forcément évident quand on passe sa vie à essayer de raconter les choses telles qu’elles se sont le plus « réellement » passées. Ça m’a convaincu, en ayant les mains dans le cambouis, qu’il y a parfois plus de vérité dans une œuvre de fiction que dans un document ou un essai. Quand on lit un livre, on a l’impression que l’auteur s’adresse à soi parce qu’il touche à des vérités intimes. J’ai vu cette transposition-là : comment, à partir d’un travail d’enquête, on peut arriver à toucher toutes sortes de vérités. Et pour cela, il a fallu créer un personnage total, celui du patron de la douane judiciaire incarné par Vincent Lindon, qui court après les méchants et qui n’existe pas en tant que tel dans la réalité. C’est un mélange de plein de personnes réelles : de magistrats, de mon propre travail d’enquête, etc.

Vous avez vu le docu Les Rois de l’arnaque de Guillaume Nicloux pour Netflix (sur le même sujet) ?
Oui, je l’ai vu aussi. Ça a donné une notoriété à Marco Mouly complètement dingue. Je l’ai revu après la sortie et les gens l’arrêtent dans la rue… L’équipe de Belleville, ce sont des gens qui ont arrêté l’école très tôt, qui ont très vite compris que leur vie allait s’écrire en dehors des limites fixées par le code pénal et à partir de là, ils sont devenus les scénaristes et les réalisateurs de leur propre existence. Marco Mouly n’a jamais cessé d’être l’acteur de sa propre existence. C’est pour ça que c’est génial de pouvoir rendre à la fiction des gens qui se sont inventé des vies. Ils ont connu la prospérité grâce à des escroqueries qui reposent sur le mensonge et le faux. Le carbone, c’est l’escroquerie des escroqueries : ils ont réussi à vendre des quotas, de l’immatériel pur par le biais de sociétés fictives… Du vent + du faux, ça a fait des milliards qui ont été détournés au nez et à la barbe de l’État, mais avec des vrais cadavres, de vraies tragédies à la fin. Il y a quelque chose d’assez naturel de rendre ça à la fiction, même si on participe à l’écriture de leur légende.
Vous avez un penchant naturel pour les grands films d’enquête ?
J’adore ça et j’ai une grande frustration par rapport à la France, qui n’a pas la culture cinématographique de montrer le journalisme pour ce qu’il peut et parfois pour ce qu’il est. Peu de choses ont été faites : Thierry de Peretti est un des derniers à avoir montré une salle de rédaction (dans Enquête sur un scandale d’État, ndlr), il y a eu un film sur le combat de Denis Robert contre Clearstream (L’Enquête en 2014, ndlr) et… pas grand-chose en fait. En France, quand il s’agit d’histoires un peu faits divers, on y arrive mais sur le politique, quasiment pas ! À Mediapart, on se dit qu’on a raconté quinze, vingt histoires qui auraient déjà été déclinées en fictions aux États-Unis : Bettencourt, Cahuzac, les financements libyens… D’ailleurs, c’est une stratégie que l’on développe, on veut réfléchir à des partenariats intelligents pour des documentaires ou des fictions. C’est fascinant de voir que la culture américaine est capable de digérer très vite son histoire contemporaine par rapport à la France qui est un pays nécrosé incapable de regarder son histoire dans le miroir qu’elle lui tend. Ça dit quelque chose de l’histoire politique de ces deux pays : la démocratie américaine est indissociable du journalisme, de la naissance de la presse de masse, de la culture du fait. C’est aussi un pays qui a besoin de se construire une histoire, avec une Constitution en partie rédigée par des journalistes, notamment Benjamin Franklin. Ça donne des films comme Spotlight ou Les Hommes du président, qui a très bien vieilli je trouve.

Quelles leçons en avez-vous tirées ?
C’est un film qui m’a fait comprendre mille choses sur ce que peut ce métier de journaliste. Et en même temps, c’est aussi un film qui montre comment on peut se tromper, quand Dustin Hoffman interprète mal une réponse d’un magistrat par exemple. Bien sûr, c’est l’histoire de Bob Woodward et Glenn Greenwald, deux jeunes journalistes qui vont faire tomber Nixon. Mais la force de l’histoire du Watergate, c’est que ça raconte une mécanique du journalisme fascinante. Il y a une scène où Robert Redford et Dustin Hoffman se prennent la tête, et je ne sais plus lequel dit à l’autre : « Si tu regardes par la fenêtre avant de te coucher, qu’il n’y a pas de neige sur le trottoir, tu te couches, tu dors, tu te réveilles et il y a de la neige dehors… Tu n’as pas vu tomber la neige, mais tu peux en conclure qu’il a neigé. » Ça, c’est une leçon journalistique absolument géniale qui vaut tout ce qu’on peut apprendre en école. Déduction, intelligence des situations…
Quels sont vos autres films de chevet dans cette lignée ?
Les Trois Jours du Condor et Serpico, deux autres films dans lesquels le journalisme est la solution. Ça dit quelque chose d’une forme d’état d’esprit démocratique. À la fin des Trois Jours du Condor, on voit Robert Redford rentrer dans les bureaux du New York Times pour raconter son histoire. Et le moment-clé pour Frank Serpico, c’est quand il va parler à un journaliste encore une fois du New York Times. Puis il sort du métro avec la Une dans ses mains, et c’est la vraie Une de l’histoire. C’est un lanceur d’alerte qui sortira du bois au moment d’une commission d’enquête municipale avant de devenir une légende. Je ne dis pas qu’il faut mythologiser le journalisme, bien sûr qu’il faut critiquer les dérives médiatiques, mais je trouve que ça raconte quelque chose.
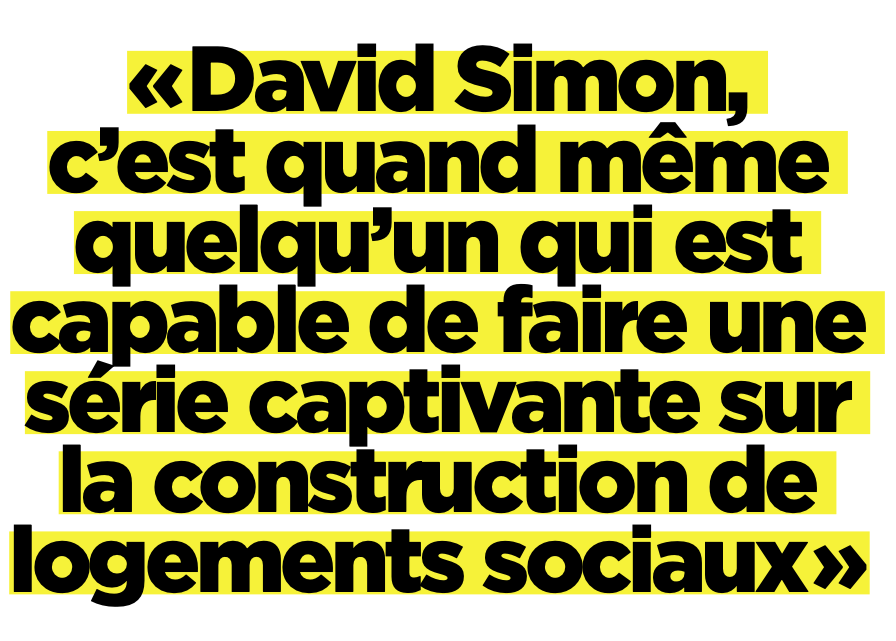
Quel film montreriez-vous à des aspirants journalistes ?
Spotlight, dont je parle souvent dans mes interventions auprès des étudiants. On y apprend mille fois plus de choses sur le journalisme que dans n’importe quel cours à l’école. Deux scènes sont fondatrices : celle où Mark Ruffalo discute avec cet avocat d’origine arménienne, qui est réprouvé par le milieu du barreau de Boston et qui défend un certain nombre de victimes. Il est présenté comme un mec pas crédible, fou, etc. Mais Ruffalo montre que le boulot de journaliste consiste à aller parler à tout le monde, tout le temps car, comme le rappelle la phrase de la fin de La Règle du jeu de Renoir : « Ce qui est terrible sur cette terre, c’est que chacun a ses raisons. » Notre boulot, c’est d’aller chercher ça. L’autre scène, c’est quand le mec qui dirige une association de victimes revient voir l’équipe de Spotlight. Il a l’air fou, brisé, comme on peut voir des lanceurs d’alerte qui ont été humiliés par leur histoire. En fait, il laisse passer une forme de lumière qu’il faut savoir saisir. Il dit qu’il est venu les voir il y a quinze ou vingt ans et il met le journal face à ses propres manquements. Ces deux scènes disent qu’il ne faut pas se boucher le nez quand on fait du journalisme. Après on trie, on vérifie… On voit.

Et The Wire, alors ?
Ah, je fais partie de la secte de ceux qui considèrent que c’est une série imbattable, un opéra urbain dans lequel on peut avoir de la sympathie pour tous les personnages, c’est extraordinaire. Mais la dernière saison de The Wire est très violente sur le journalisme ! We Own This City, c’est l’adaptation extrêmement fidèle du livre d’un journaliste, Justin Fenton (La ville nous appartient, paru aux Éditions Sonatine, ndlr), qui est l’un des successeurs de David Simon au Baltimore Sun. D’ailleurs, on voit Fenton à la fin dans une conférence de presse, il pose une question au patron de la police. Façon de rappeler que tout ce qu’il raconte dans la série, c’est grâce au travail de ce journaliste. David Simon, c’est quand même quelqu’un qui est capable de faire une série captivante sur la construction de logements sociaux (Show Me a Hero, ndlr)… Je trouve ça remarquable.
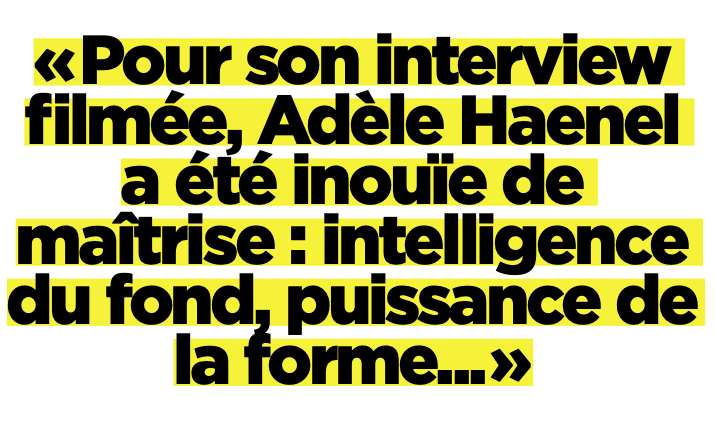
Mediapart a été à l’origine de l’affaire Adèle Haenel. Comment avez-vous vécu ce moment ?
On doit tout au travail exceptionnel de Marine Turchi – digne d’un Ronan Farrow au New Yorker – pour cette affaire qui a eu une longue traîne dans le cinéma français jusqu’aux César. Marine avait déjà travaillé sur Luc Besson et elle connaît un peu l’hubris de ce milieu, notamment sur ces questions- là. Pour son interview filmée, Adèle Haenel a été inouïe de maîtrise : intelligence du fond, puissance de la forme… Elle a été très impressionnante. Je n’aime pas cette expression, mais ça a été un « moment ». Dans l’histoire du journal, il y a un avant et un après. Mais en fait, cette émission n’a été possible que parce qu’il y avait l’effet de souffle de l’enquête de sept mois, longue et âpre. Marine l’avait prévenue, elle lui a dit : « Si j’enquête, ça va être dur, parce que je vais tout vérifier. » De mémoire, il y a 37 personnes qui parlent dans son papier.
Les coulisses de votre rédaction ont été filmées par Naruna Kaplan de Macedo pendant la campagne présidentielle de 2017 (Depuis Mediapart, sorti en 2019). Il vous en reste quoi ?
C’était très inhabituel pour nous et c’est un défi compliqué. Car pour ce qui relève de la partie enquête, ce n’est pas montrable, en fait. On ne peut pas se permettre de laisser tourner certaines choses, on ne peut pas prendre un centième de risque de dévoiler une source. On aimerait être le plus transparent possible et en même temps, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas l’être. Mais ce qui était très intéressant, c’était le propos de Naruna, qui se demande comment « son » journal se comporte, c’est un cinéma documentaire à la première personne qui ne triche pas sur le point de vue.

Que pensez-vous de la scénarisation des séries documentaires à gros budget que l’on trouve notamment sur Netflix ?
C’est le danger de ce mode narratif : faire du réel une télé-réalité. Il y a un risque à ne réfléchir qu’en termes de « ups and downs », de cliffhangers, de personnages qui portent l’histoire… Car cela nous soustrait à la nuance, à la complexité, à la prise de hauteur. D’ailleurs, il y a eu une grosse polémique dès la première grande série documentaire Netflix, Making a Murderer, avec un très long papier dans le New Yorker remettant en cause la rigueur de l’œuvre… Il y avait un besoin d’arches, de conflits intimes… Tout ce qui fait les bons ressorts du scénario. Pour autant, je ne suis pas pour jeter le bébé avec l’eau du bain : je trouve ça bien que le journalisme et le documentaire réfléchissent à leur narration. Et il ne faut jamais s’empêcher d’avoir un regard ou un propos sur ce qu’on raconte ; toujours parier sur l’intelligence des spectateurs. Je me souviens qu’à la télé française, ce que j’ai beaucoup entendu, c’est : « Holala, c’est trop compliqué ! » Non, ce n’est pas compliqué, c’est complexe. Heureusement qu’il y a Cash Investigation et Complément d’enquête qui montrent qu’il y a une audience pour ça en prime time. Les gens sont très loin d’être cons et puis ça leur appartient tout ça, donc ce serait peut-être bien qu’on les caresse dans le sens de leur intelligence… •
L’entretien est à retrouver dans Sofilm n°93


