RICHARD KELLY : « Il y a un peu de la Bible dans tous mes films »
– RICHARD KELLY : « Il y a un peu de la Bible dans tous mes films » –
Le plus grand fiasco du Festival de Cannes depuis The Brown Bunny. Voilà comment Roger Ebert avait décrit la projection de Southland Tales à la Croisette en 2006. S’il avait réussi à conjurer l’échec en tournant The Box, voilà dix ans que Richard Kelly n’a pas tourné un seul plan. Un nom de plus à ajouter à la longue liste de créateurs maudits ? Peut-être qu’il n’y a plus de place dans le cinéma pour des histoires paranoïdes comme les siennes. Pourtant, Donnie Darko reste toujours culte, vingt ans après sa sortie. En conséquence, Richard Kelly y croit toujours. Par Fernando Ganzo / Photo : Alexandre Isard (paru dans Sofilm n°72, été 2019)
Vous dites avoir toujours voulu faire du cinéma mainstream. Pourtant, Donnie Darko n’a fait que 500 000 dollars de recettes en salles aux États-Unis quand il est sorti en 2001, pour un budget de 4,5 millions…
Bon, mainstream, c’est un terme relatif… Quand je dis ça, pour être honnête, c’est pour dire que je veux faire des films qui puissent générer des recettes. Il y a des cinéastes qui ont trouvé un moyen pour faire des films provocants et artistiques tout en gagnant de l’argent. Et ça reste la clé. Regardez Christopher Nolan, par exemple. Ou Jordan Peele. Dans tous les projets sur lesquels je bosse maintenant, je m'efforce de m'adresser à une audience très large pour justifier les dépenses. Savoir combien un film devrait coûter et donc combien il devrait gagner… Bon, c’est la réalité de l’industrie, quoi.
À l’époque, vous pensiez que Donnie Darko pouvait toucher ce public assez large ? Oui, on croyait faire un film mainstream. On s’attendait à avoir une grosse distribution, avec plein d’actions de marketing. Ça devait être un joli coup, comme on dit. Malheureusement, il y a eu beaucoup d’obstacles. Déjà, il est sorti pile un mois après le 11-Septembre. Il y a eu zéro marketing, le distributeur n’y croyait pas du tout… C’était une sortie assez triste, mais regardez : le film est toujours vivant ! Ça aurait été cool que toute cette excitation soit arrivée tout de suite, certes. Et c’est pour ça que je mets tant de temps à faire un prochain film : je veux être sûr que ça va se passer ainsi.
Quelle est votre stratégie exactement ? L’idée, c’est d’avoir plein de projets en cours et trouver celui qui marchera à coup sûr, pour déclencher un effet domino et pouvoir alors passer entre dix et vingt ans à réaliser tous ces films d’affilée. Nous sommes en train de voir lequel pourrait permettre d’avoir les meilleurs éléments de calendrier, casting, budget… pour devenir celui qui marchera. C'est un Rubik’s cube qui doit faire clic… On verra. Et, oui, ça sera mainstream, mais d’abord je veux plaire à ceux qui ont aimé et apprécié l’univers que j’essaie de créer. Je veux leur donner quelque chose d’excitant.

Pour rester en activité certains cinéastes acceptent des commandes commerciales pour ensuite revenir à des projets plus personnels. Pourquoi n’avez-vous pas choisi ce chemin-là ? En vérité, j’ai flirté avec quelques trucs dans ce genre… Surtout, j’ai eu l’occasion de faire des films au budget bien plus petit que ce à quoi j’étais habitué. Mais j’ai choisi de rester concentré sur l’écriture. Surtout par respect envers tous ces gens qui ont aimé mes premiers films, leur ambition, ce que je tentais de faire. Je ne veux pas revenir avec un film qui ne soit pas un vrai challenge et que les gens se disent : « Oh, après toutes ces années, il a juste fait un truc un peu basique. »
Vous avez passé quatre ans à écrire Southland Tales, une grosse machine sans doute difficile à gérer, que certains voient comme un équivalent, en termes de démesure et d’échec, des Portes du paradis de Michael Cimino. Qu’est-ce qui vous a amené à ce film ? En fait, tout le projet était une réponse aux événements du 11-Septembre. À cette époque, je pensais souvent à ce qui pourrait nous guetter, et pour moi la réponse était on ne peut plus claire : nous allions vers une troisième guerre mondiale, le gouvernement allait prendre le contrôle d’Internet pour tous nous espionner, il y aurait une police d’État orwellienne. Je voyais même la pop culture et le culte autour des célébrités en pleine explosion comme une façon de nous distraire du cauchemar… Les gens devenaient fous avec Britney Spears, avec le début des Kardashian. Tout ça alors qu’on partait en Irak et Afghanistan. J’ai voulu mettre tout ça dans un film. Pour moi, Southland Tales c’était comme une façon de libérer la colère, l’émotion.
« Ma plus grande fierté ? Avoir mis The Rock sur le tapis rouge de Cannes »
Le casting de ce film est quand même assez étonnant puisqu’on y retrouve The Rock, Sarah Michelle Gellar, Justin Timberlake, Amy Poehler, Kevin Smith. D’où vient cette envie de faire cohabiter des personnalités aussi différentes ? Pour moi, on avait rassemblé le plus grand cast de l’histoire du cinéma ! Vous ne verrez plus jamais un casting comme ça. À l’époque de Robert Altman c’était peut-être possible, mais maintenant ? Si j’ai tellement aimé Altman, c’est aussi pour ça : devant ses films vous aviez l’impression d’être invité à un grand cocktail où n’importe qui pourrait se pointer sans que cela soit planifié. Tout a commencé avec Dwayne Johnson et Seann William Scott. Après, tout s’est naturellement mis en place autour d’une idée : diriger des personnalités venant de la culture pop, du Saturday Night Live, du stand-up, des comédies sexy à la télé, de la musique… Et l’avantage c’était qu’aucun membre du casting ne snobait le propos du film : pour eux, déconstruire la culture pop, comme je voulais le faire, c’était même quelque chose de naturel. Des acteurs plus conventionnels n’auraient pas accepté ça. Le film avait des moments de comédie, des sketchs absolument ridicules, des moments où l’on devait se déguiser. Franchement, c’était un tournage très amusant ! Si on ne s’était pas pris le mur à Cannes, ça aurait été une expérience parfaite.
Cette descente en flamme du film lors de sa présentation à Cannes, comment l’avez-vous vécue ?
Ça a été quelque chose de très brutal… On arrivait extrêmement excités. On savait que le film n’était pas fini, mais nous sommes allés aussi loin qu’on le pouvait, parce qu’être en compétition à Cannes, pour ce film, pour moi, pour Dwayne Johnson, c’était vraiment un big deal. Il fallait y être avec la meilleure version possible, quitte à ne pas finir le montage ni les effets spéciaux. Et après, la projection de presse à 8 h 30 du matin qui précédait l’officielle est arrivée. Bon, une petite partie de l’audience a aimé, mais la grande majorité l’a vraiment détesté. Le pire c’est qu’ils ne nous ont même pas hués. On les voyait juste se barrer de la salle. En silence. C’était traumatisant. On nous disait qu’on avait battu le record de journalistes sortis de la salle pendant une projection cannoise. À partir de là, vous pouvez imaginer la difficulté à se concentrer et à garder la tête froide quand nous sommes arrivés avec Dwayne et Sarah (Michelle Gellar), et d’autres membres de l’équipe à la projection officielle au Grand Théâtre Lumière. Le soir, nous sommes allés faire la fête, mais on était tous comme engourdis. Mais vous savez quoi ? Je n’ai pas de regrets d’avoir accepté de montrer le film là. On était en compétition à Cannes ! Le moment dont je suis le plus fier de ma vie, c’est d’avoir mis The Rock sur le tapis rouge.

Tourner The Box, une adaptation de Richard Matheson, très inspiré de la télé et de la série B, c’était une autre tentative casse-gueule ?
Ce film était une équation très difficile à résoudre : l’histoire originale de Matheson, Button Button, qu’il avait lui-même adaptée dans The Twilight Zone, était parfaite et faisait six ou huit pages. Moi, je devais ajouter tout un monde autour de ça qui soit cohérent avec les intentions du personnage qui offre la boîte aux protagonistes, lier ça aux missions sur Mars, à notre existence. J’avais des discussions théoriques sans fin à l’époque. J’ai passé des nuits à parler avec des gens de la NASA, avec les acteurs. Ça devenait de plus en plus long, je n’arrêtais pas d’ajouter des scènes. Le montage dépassait de 40 minutes la durée prévue. J’ai dû couper des décors entiers, immenses, de la version finale. C’était censé être un hommage à The Twilight Zone, mais aussi aux thrillers politiques de conspiration des années 70, le tout mélangé avec mon appareillage métaphysique et psychédélique, présent dans tous mes films. Les portes liquides de voyage temporel, par exemple.
Les deux protagonistes principaux sont inspirés de vos parents. Est-ce que votre fascination pour la science-fiction vient du travail de votre père au sein de la NASA ? Même après, quand il a quitté la NASA, il a travaillé dans l’industrie robotique, donc son travail a toujours été technique, scientifique. Mais ma mère m’a mis dans une école d’art pour faire de la peinture, elle poussait toujours du côté de la création, et elle a voulu que je devienne écrivain. J’avais la science d’un côté, et de l’autre l’art, l’écriture, la peinture. À la base, je suis un fan de Stephen King. Ensuite, à l’époque de mes études, je me suis mis à lire de plus en plus : L’Étranger de Camus, La Métamorphose de Kafka, Dostoïevski, Jane Austen… L’éducation publique en Amérique n’était vraiment pas mal. Et du côté du cinéma, ce que je voyais à l’époque, c’était les gros blockbusters : James Cameron, Steven Spielberg, Robert Zemeckis… C’est seulement un peu plus tard que j’ai découvert David Lynch, grâce à Twin Peaks. Et à partir de là, je me suis aussi pris de passion pour le cinéma de John Hughes, des frères Coen, de David Fincher…
On a aussi parlé de David Cronenberg à cause de la présence constante dans vos films de cicatrices et de blessures. C’est un cinéma qui vous parle ? Pas dans ce sens-là. Je dirais que dans mes films, c’est surtout lié à l’idée de la blessure, chez les personnages. Mais je ne sais pas d’où ça vient chez moi. Peut-être du catholicisme, comme des stigmates ? Dans le cas de The Box, et du pied déformé de Cameron Diaz (dans le film, on apprend qu’après une chute à ses onze ans, son pied est resté trop longtemps dans une machine à rayons X, ce qui a détruit le tissu de ses orteils, ndlr), c’est tout simplement ce qui était vraiment arrivé à ma mère. Et mon père lui a fait une prothèse avec du matériel de la NASA, comme le personnage du film. Rien de tout ça n’est inventé. Dans mon cinéma il n’y a rien de fétichiste, c’est quelque chose de plus émotionnel.
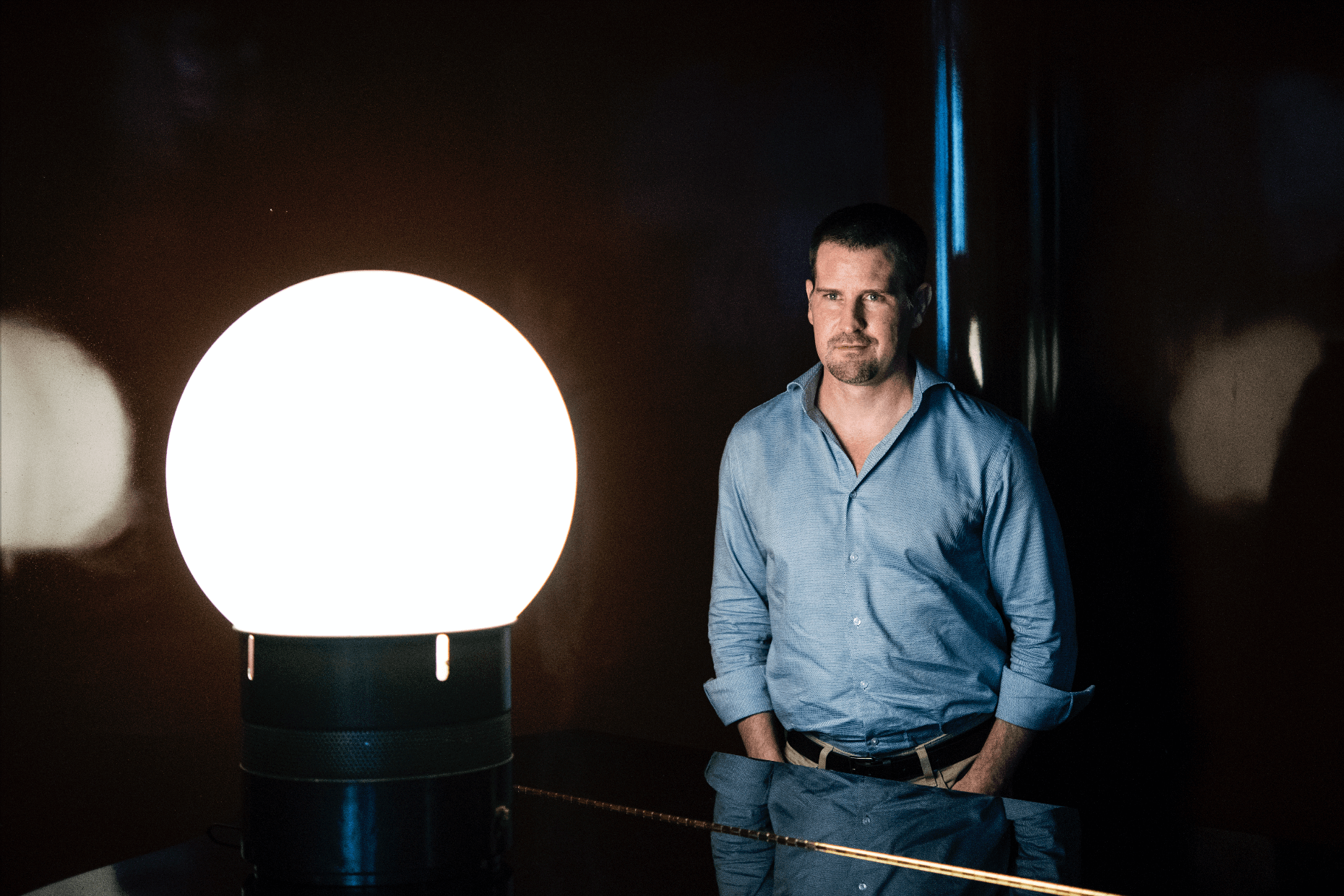
Est-ce que vous faites attention aux interprétations des fans au sujet de vos films ? Par exemple, il y en a qui plaquent sur Donnie Darko une lecture ultra-catholique. Ah oui, il y a un truc catholique dans le film, même si je n’ai pas du tout eu une enfance catholique ! J’ai plutôt été élevé dans le culte méthodiste, surtout du côté de ma mère, qui vient du Texas, d'une famille très chrétienne. On allait souvent à l’église. Mais en cours de production, des choses nous ont fait changer ça dans le film. À cause des localisations qu’on a trouvées, on a fini par situer l’histoire dans un lycée jésuite, et ça nous arrangeait de mettre un uniforme à tous les étudiants pour économiser en costumes. On voit une croix dans l’école, un des personnages était une nonne qui avait quitté l’église, et quand Donnie va au cinéma, il y a La Dernière Tentation du Christ à l’affiche… Ça a évolué comme ça et pour moi ça faisait sens. Sauf que je ne m’attendais pas à ce que le film soit aussi suivi et souvent projeté par des institutions catholiques. Je suis d’accord avec ça, en même temps. Après, Southland Tales est comme un décryptage de l’Apocalypse, tandis que The Box est peut-être plus proche de l’Ancien Testament, avec le bouton rouge comme pomme de la Tentation. Bref, je pense qu’il doit y avoir des composantes bibliques dans tous mes films.
« Rentrer dans la salle de montage et sentir que ça part dans tous les sens.
Cette angoisse-là, je ne veux plus la sentir. »
Maintenant que le « traumatisme » Southland Tales est passé, certains voient dans ce film une vision du futur, disons, assez plausible. C’est aussi votre cas ?
C’est pire que ça. Tous les jours quand je me lève, je lis les journaux et je me dis : « Wow, on dirait du Southland Tales ! » À vrai dire, je ne me sens pas très à l’aise avec la tournure que prennent les événements. Je pense que les gens sont très fâchés aujourd'hui. En tout cas, de mon point de vue, ils le sont beaucoup plus qu’en 2006, où le film pouvait avoir l’air trop en colère. Aujourd’hui, il suffit de décrypter les discours politiques sur les réseaux sociaux : la société est bien plus énervée que le film. De ma vie, je n’avais jamais vu notre pays aussi divisé. Le pire ? Nous ne sommes pas l’exception aux États-Unis. Regardez le Brexit en Europe, le retour du suprématisme blanc, tous ces crimes de haine dans certains pays du monde, le terrorisme…

Qu’avez appris de l’échec de Southland Tales ? Qu’il faut vraiment boucler un scénario avant de tourner. À l’époque, j’ajoutais des détails et des dialogues en permanence. J’ai même envisagé que ce film se divise en six chapitres et que les premiers soient publiés sous forme de BD. Le spectateur aurait pu les lire avant ou après le film. Bref, je me suis aussi attelé à ces BD en même temps que je tournais et que je montais. Depuis, j’essaie de rendre mon écriture plus propre et efficace. Plus jamais de ma vie, je ne veux rentrer dans la salle de montage et sentir qu’il n’y a pas de plan détaillé, que ça part dans tous les sens, ne pas trouver la forme de mon film.
Vous avez beaucoup remonté le film ? À un moment donné, on croyait tenir le bon montage. Puis il y a eu la projection de Cannes qui nous a rendus fous, on est revenus en salle de montage et on a tout remonté. Récemment, j’ai participé à une projection au Musée d’art du comté de Los Angeles pour montrer le montage cannois. Et vous savez quoi ? Ça a marché d’une façon incroyable. Les gens sautaient et hurlaient. On se serait crus dans un concert de rock. Écouter enfin des gens rire et applaudir ce film, ça a été l’un des moments les plus beaux de ma vie. En le voyant, je me suis rendu compte que c’était beaucoup mieux comme ça. Plus long, certes, mais le film en avait besoin. Il y a des douzaines de personnages et ils ont besoin de temps et d’espace pour respirer. La vraie leçon a donc été d’apprendre que parfois les films vous échappent, mais qu’heureusement, ils peuvent toujours ressusciter.


