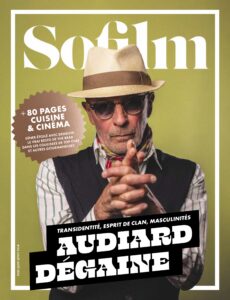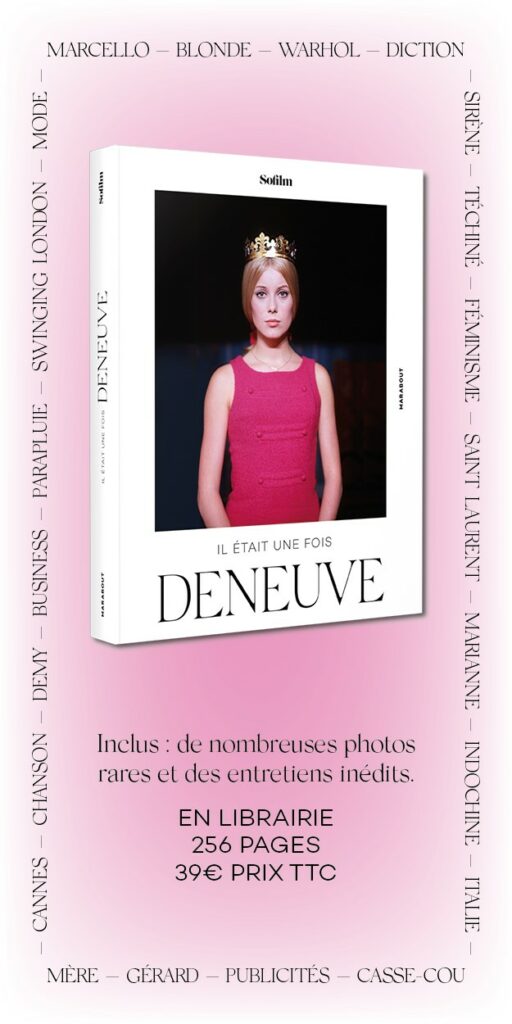Mo Harawe (The Village next to Paradise) : « On ne connaît que certains aspects de la Somalie »
Né en Somalie, Mo Harawe a fait des études d’art avant de partir en Autriche où il a commencé à réaliser des films en autodidacte. Pour son premier long-métrage, The Village Next to Paradise, il filme le quotidien de trois personnages dans un petit village côtier. Leur force tranquille paraît bien loin des attentats terroristes qui minent le pays, une manière de prendre à revers l’image qui colle à la peau de la Somalie depuis plusieurs années : le pays serait l’un des plus dangereux du monde. Rencontre avec le cinéaste autour de ce film d’une élégance majestueuse. Par Léo Ortuno.
Quel est ce village, Paradis, que l’on voit dans le film ?
On peut dire que ce village est comme une métaphore du pays entier. La Somalie est un très beau pays, avec sa population, ses îles qui sont les plus belles de l’Afrique de l’Est, l’Océan Indien et son eau magnifique… Sauf qu’à cause de nombreux problèmes, on est très loin d’être un réel paradis. Il y a un potentiel donc, d’où ce next to paradise dans le titre du film.
Pourquoi avoir situé l’action du film dans un petit village, et non pas une grande ville en Somalie ?
Dans un village, il y a comme un aspect originel qui m’intéresse. On revient aux racines en quelque sorte. C’est un petit espace par rapport à des villes plus grandes et comme j’avais cette idée d’en faire une métaphore du pays, le village était un bon moyen de représenter la Somalie ; un espace réduit, un peu isolé comparé au reste du monde.
Vous travaillez donc beaucoup à partir de métaphores.
Oui parce que quand on veut raconter une histoire, on ne veut pas aller droit au but. Tout ne doit pas être directement donné. Sinon je ne ferais pas des films mais des discours plus explicites. C’est le cas pour les dialogues mais aussi pour les scènes ou les personnages. Je veux que les spectateurs se posent des questions. Quel est le sens de cette scène ? De ce son qu’on entend ? Du titre ? D’ailleurs si Paradise avait été trop évident, vous ne m’en auriez pas parlé, ça vous aurait peut-être moins intéressé.
Justement j’ai eu un doute sur le fait que ce village existe réellement. J’ai donc cherché sur internet et le premier résultat sur lequel je suis tombé, c’est un article disant que le pays était le plus dangereux du monde.
C’est pour cela que j’ai fait le film et montrer une autre perspective. Il y a beaucoup d’endroits, peut-être comme le site dont vous venez de parler, qui n’ont pas vraiment d’idées de comment ça se passe concrètement en Somalie, ou alors ils connaissent certains aspects seulement. J’avais justement envie de démarrer le film par une séquence d’un journal TV occidental. Ce sont des images qui placent le spectateur dans ces conditions, comme dans l’article, en ne montrant qu’un point de vue partiel. Ensuite, le film va au-delà de ces images et montre à quoi la réalité ressemble.

Pourtant, la violence et la dangerosité sont aussi présentes dans le film, mais souvent en hors-champ. Comment avez-vous travaillé sur ce qui est montré ou non ?
Ça s’est fait de manière très intuitive, toujours en essayant d’écrire de façon subtile et de ne pas être trop direct. Je n’avais pas besoin de tout montrer et parfois ce qui se passe hors-champ a plus d’impact que si on le voyait directement. Par exemple, il est beaucoup question de drones de combat dans le film. C’était écrit au scénario et il y a des scènes dans lesquelles c’est abordé frontalement mais le plus gros du travail a été fait en post-production. Pendant le montage, on a été très attentif au sound design pour que les sons de drones soient régulièrement présents, en arrière-plan.
C’était le cas pendant le tournage ? Il y en avait souvent ?
Il n’y avait pas d’explosion en tout cas. Ce n’est pas comme si ça se passait tous les jours, mais ça peut arriver et ça rend la chose encore plus dangereuse. Quand on sait que ça peut arriver, la menace reste en permanence dans ton esprit. La tension est là et ne redescend jamais. Les sons dans le film permettent aussi d’insuffler cette tension permanente au récit.
Il est aussi question du khat, que plusieurs personnages fument. Cela donne lieu à une séquence onirique dans laquelle on peut voir un des rares mouvements de caméra du film, alors que l’essentiel est fait à partir de plans fixes.
Le khat est une drogue légale du pays et dans l’Afrique de l’Est plus généralement, un peu comme l’alcool. Tout le monde n’en prend pas bien sûr mais en Somalie, il y a peut-être 20% de gens qui en consomment. Dans le film, le personnage en fume dans une séquence où il se sent un peu coupable. Il veut oublier et s’évader. Il y a quelques zooms avants et arrières dans d’autres scènes mais ici c’est l’occasion d’un long zoom qui termine très proche de son visage. Comme c’était un rêve, je me suis sentie plus libre, avec l’impression de pouvoir faire ce que je voulais.
Quel a été l’environnement de production du film ? Comment avez-vous réuni l’équipe technique, le casting ?
Je voulais que le tournage du film dure environ 3 mois, pendant une période de l’année où il y a beaucoup de vent en Somalie. J’avais aussi envie que l’équipe soit 100% africaine. Il y a 70% de Somaliens et pour le reste, ce sont des personnes venues d’Egypte ou du Kenya. Le casting s’est fait simplement en parlant à des gens dans la rue et en demandant s’ils connaissaient d’autres personnes qui pouvaient être intéressées par le film. Le seul moment où on a fait un « vrai » casting dans une salle, c’était pour le personnage féminin, Araweelo. Ce jour-là, on a pris une caméra et on a filmé les cinq personnes qui étaient présentes. Axmen Cali Faarax, qui joue finalement dans le film, était la dernière. On ne lui a pas demandé de jouer ou de faire un essai, on a simplement parlé pendant une heure et on a compris que c’était elle.
Toutes les personnes de l’équipe avaient déjà travaillé sur un plateau de tournage ?
La plupart d’entre eux m’accompagnait déjà sur mon précédent court-métrage, Will My Parents Come to See Me, et d’autres personnes se sont ajoutées sur ce film. Sur un plateau, beaucoup de tâches peuvent être réalisées par des gens qui n’ont jamais fait de cinéma. Je ne parle pas de la caméra bien sûr, mais tout ce qui tourne autour de l’organisation par exemple. Si quelqu’un est motivé, il peut le faire. Il faut juste lui donner plus de temps et être patient. C’est un apprentissage collectif.
The Village next to Paradise (Un Certain Regard), prochainement.